


| Auteur | Carole Dagher et Myra Prince |
| Editeur | Geuthner |
| Date | 2020 |
| Pages | 417 |
| Sujets | Relations extérieures France Liban Coopération culturelle Liban 20e siècle |
| Cote |
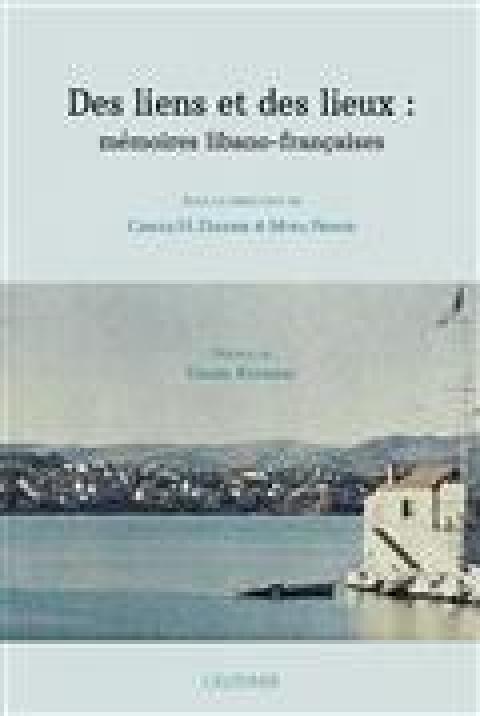
L’objectif de ce livre est de raconter les partenariats entre des Français et des Libanais dans des domaines variés et d’évoquer des hommes et des femmes qui se faisaient une certaine idée du Liban et de ses liens avec la France (p.15). Le Liban en tant qu’État apparaît dans les quatre communications suivantes.
L’historien libanais Antoine Hokayem décrit (p.17) comment la rédaction de la Constitution libanaise de 1926 fut confiée au député français Joseph-Paul Boncour, président de la Commission chargée par le Ministère français des Affaires Etrangères d’élaborer le projet de statut organique prévu pour la Syrie et le Liban, au sénateur Henry de Jouvenel, nommé le 13 novembre 1925 Haut-Commissaire de la République française en Syrie et au Liban et à la Commission de 12 membres du Conseil représentatif libanais, présidé par Moussa Namour. Cette Commission était composée de 3 maronites, 2 orthodoxes, 1 melkite, 1 latin (7 chrétiens), 2 sunnites, 2 chiites, 1 druze (5 musulmans) et du Président Namour, d’où son nom de « Commission des 13 » (p.31). Aucun membre n’étant constitutionnaliste, la Commission eut recours au juriste français Paul Souchier, maître des requêtes au Conseil d’État. Le 25 mai 1926, les deux Chambres libanaises élirent Charles Debbas, premier Président de la République libanaise (p.47).
Clotilde de Fouchécour (p.313) nous conte la lente élaboration du projet du Traité de 1936, qui devait mettre fin aux mandats du Liban comme de la Syrie. En fait, l’insertion régionale progressive du Liban et les réactions du gouvernement français ont rendu la signature du Traité impossible sans pour autant empêcher des avancées politiques notables (p.314). De 1936 à 1938, le gouvernement français radical-socialiste est disposé à préparer l’accession de la République libanaise à l’indépendance (p.336) d’autant plus que le Président Émile Eddé, récemment élu est francophile. La signature par la Syrie de ce Traité encourage les politiciens libanais à faire de même (p.346). Ils acceptent que le français devienne langue officielle, ce qui sera abrogé en 1943 (p.349). Le 13 novembre 1936, le Traité est signé par Damien de Martel, Haut-commissaire et le Président Eddé (p.359). Des manifestations soutenues par Riyad el Solh, petit-fils d’un Ouzbek et d’une Circassienne (p.363), rassemblent les musulmans partisans de l’intégration à l’État syrien (p.372). A Paris, le nouveau Premier Ministre Léon Blum, proche de Chaïm Weizmann, est en faveur du sionisme (p.384). D’autre part, pour éviter dans la guerre qui se prépare que la Turquie ne s’allie au Régime hitlérien, la France admet le rattachement du sandjak syrien d’Alexandrette, à la Turquie (p.393). Des parlementaires français, acquis à l’alliance turque jugeront la signature du Traité franco-libanais « prématurée » (p.397). Aucun gouvernement postérieur ne décidera de le soumettre aux Chambres : « Le Mandat français demeure l’un des angles morts de l’histoire » (p.416).
Yann Bouyrat évoque le souvenir d’un diplomate français de l’époque de Louis-Philippe, Nicolas-Prosper Bourée qui servit au Consulat de France de Beyrouth pendant dix ans (1840 à 1850) ; il eut à gérer au début de sa mission la fin de l’occupation du Levant par l’Égypte, alliée de la France, les tensions entre communautés maronite et druze et surtout l’influence rivale de la Grande-Bretagne (p.219). Beyrouth avec 20.000 habitants, doté de rues pavées et de quais modernes est dirigé par un Conseil municipal de douze membres dont six chrétiens (p.225). Cependant, en juillet 1840, lassés des exactions de l’occupant égyptien, les habitants du Mont-Liban se révoltent ; notre Consul, les soutenant, est désavoué et rappelé à Paris. Heureusement, il s’y justifie et regagne Beyrouth en avril 1841. M. Bourée saura affaiblir la mainmise anglaise sur l’administration turque, réaffirmer le protectorat catholique de la France (p.257) et de ce fait « mettre en œuvre le fil conducteur de la diplomatie française jusqu’à la première guerre mondiale » (p.262).
Stéphane Malsagne, dont nous avions fait sur ce site la recension de son excellent ouvrage rédigé avec Dima de Clerck Le Liban en guerre (Belin 2020), se penche (p.267) sur le premier ambassadeur du Liban à Paris, Ahmed Daouk (1893-1967), deux fois Président du Conseil. Cet ingénieur sunnite formé à Aix en Provence est également membre du Conseil Municipal de Beyrouth (p.276). En 1944, le Président Bechara El Khoury le nomme Ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire à Paris avant de prendre le titre d’Ambassadeur du Liban ; il y demeurera jusqu’en 1958 (p.288). Il crée la Chambre de Commerce franco-libanaise, acquiert à ses frais l’hôtel particulier qui deviendra la résidence de l’ambassadeur du Liban (p.299). Confronté à l’affaire de Suez, il devra gérer ce moment délicat. Également ambassadeur à Madrid, il assurera des missions auprès de l’UNESCO et de l’ONU (p.303). Notabilité beyrouthine, ce grand commis de l’État restera, comme l’a décrit Hubert Argod : « une des éminentes figures du Liban et un grand ami de la France » (p.311).
Les liens entre Français et Libanais font l’objet des six contributions suivantes.
Carole Dagher (p.59) rappelle l’amitié du professeur de droit lyonnais Paul Huvelin et du fondateur de la faculté de droit de l’Université Saint-Joseph, le magistrat Négib bey Aboussouan, qui partagèrent un même souci d’excellence juridique et académique et leur foi dans le rôle civilisateur de la France (p.60). Paul Huvelin obtint, malgré le climat d’anticléricalisme en France, à ce que l’École de Droit de Beyrouth devienne la filiale de la Faculté lyonnaise de Droit (p.64). De son côté, Négib Aboussouan, drogman du Patriarche latin de Jérusalem, était diplômé de droit de la Faculté ottomane d’Istanbul et de ce fait avait noué des relations utiles avec l’intelligentsia turcophone (p.68), d’autant plus que son grand-père avait traduit le Megéllé de 1877, code ottoman de droit civil. Le Pr. Aboussouan sera également Ministre de la Justice (p.73).
L’amitié des archéologues Maurice Chehab (1904-1994) et Maurice Dunand (1898-1987), est évoquée par Rolf Stucky et A.M. Maïla-Afeiche (p.77). M.Chehab, diplômé de l’École du Louvre, est nommé en 1928 Conservateur du Musée National de Beyrouth, qui ouvrira ses portes en 1938, puis Chef du Service des Antiquités cette même année (p.78). Sa parfaite connaissance du patrimoine archéologique lui permit de sauver les stèles gravées de Nahr el Kelb qui surplombaient la route côtière dont l’élargissement aurait pu les faire disparaître. Sa solution de creuser un double tunnel fut adoptée (p.82). Lui et son épouse Olga mirent à l’abri pendant la guerre civile de 1975 à 1980 les prestigieux sarcophages de la collection (p.84). Quant à Maurice Dunand, il participe aux fouilles de Byblos en 1924, en est nommé « Directeur à titre libanais » en 1929, responsabilité qu’il exercera jusqu’en 1980. Il dégagera entre 1963 et 1979 le sanctuaire d’Echmoun près de Saïda (p.81).
Jean-Marc Fevret relate l’amitié de deux hommes de lettres, Georges Schéhadé et Gaëtan Picon (p.121). Gaëtan, moins âgé de dix ans, plus grand de taille, conservait l’autorité calme de la bourgeoisie bordelaise tandis que Georges, originaire d’Alexandrien gardait l’allure d’un jeune homme qui cachait une profondeur peu commune (p.127). Ils se rencontrèrent à l’École des Lettres de Beyrouth, fondée par Gabriel Bounoure en octobre 1944, placée sous l’autorité de l’Université de Lyon, et où Georges était secrétaire général depuis 1945 ; Gaëtan y est nommé directeur de 1952 à 1954. Leur amitié fut instantanée (p.131). Ils accueillirent Roger Cailllois, Elsa Morante, Alberto Moravia, André et Madeleine Malraux (p.147). En 1954, Picon fut transféré à Florence et Schéhadé s’installa davantage à Paris. L’École des Lettres disparut en 1976, première victime de la guerre civile libanaise (p.159).
Zeina Saleh Kayali (p.175) rappelle le soutien apporté par un consul français mélomane, Georges Saint-René Taillandier (1852-1942) au compositeur Wadia Sabra (1876-1952). Le premier entend chanter à la paroisse protestante de Beyrouth le jeune Wadia en 1893 ; il lui fait obtenir une bourse au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris. De 1900 à 1908, Wadia sera l’organiste de la paroisse parisienne du Saint-Esprit. Appelé à Istanbul en 1908, il compose l’hymne national ottoman (p.179). Revenu à Beyrouth, il y crée le premier Conservatoire en 1910, la première revue locale de musique Musica en 1913. Il fabrique avec Bechara Ferzan aux ateliers Pleyel (1919 à 1922) un piano exécutant les tonalités de la musique orientale et de la musique classique. On lui doit également l’hymne national libanais en 1927 (p.188).
Dans le domaine de l’architecture urbaine, le rôle de Michel Ecochard (1905-1985) est révélé par Myra Prince (p.91). Diplômé en 1932 comme architecte, archéologue, urbaniste, il avait participé aux fouilles du temple palmyrénien de Bel en 1930 (p.95). Directeur du Service de l’Urbanisme en Syrie-Liban en 1940, il dresse le Plan d’aménagement de Beyrouth en 1943-1944 (p.97). Il construira avec des architectes libanais, l’École des Frères Maristes de Saïda, le Grand Lycée de la Mission Laïque et le Collège Protestant de Beyrouth (p.105). Avec son Schéma Directeur du Grand Beyrouth, Ecochard espérait juguler la prolifération chaotique des faubourgs par le regroupement des zones d’habitat. Une Loi en 1963 adopte ce Plan mais les projets de cités ouvrières seront éliminés par les élites libanaises (p.112). M.Prince en conclut que la notion d’utilité publique reste largement contredite par les intérêts particuliers.
C’est à Victoria Khouzami (1907-2005) que l’on doit la construction du Pavillon Libanais de la Cité Universitaire de Paris ; Chantal Verdeil décrit le combat de cette enseignante féministe engagée (p.195) qui, après avoir été responsable des écoles orthodoxes de Homs, est engagée au Lycée de filles de la Mission Laïque de Beyrouth. Son activité militante la mettra en relation avec des personnalités du Mandat et de la France Libre (p.198). En 1953, elle renonce à son poste à l’Université Saint-Joseph pour se consacrer à la fondation de la Maison du Liban durant 15 ans (p.202) en s’appuyant sur l’Association culturelle franco-libanaise, présidée par la sénatrice Marie-Hélène Lefaucheux et rassemblant Jean Gaulmier, Michel Aurillac, Georges Gorse, proches du pouvoir. Le Pavillon est inauguré le 8 mai 1965 par le Président Charles Helou et le Ministre Christian Fouchet. En 1969, il devient la Maison du Liban (p.208).
Avec Victoria Khouzami, officier de la Légion d’honneur, les relations franco-libanaises auront passé par une coopération éducative sans lignes confessionnelles, conclut C. Verdeil (p.216).
Le lecteur appréciera les nombreux documents illustrant les différentes contributions et la bibliographie particulière à chaque recherche.