


| Auteur | Hassan Adawa Ali Ganta |
| Editeur | du Menhir |
| Date | 2017 |
| Pages | 162 |
| Sujets | Djibouti 1900-1945 France Colonies Afrique Administration 1900-1945 |
| Cote | 61.526 |
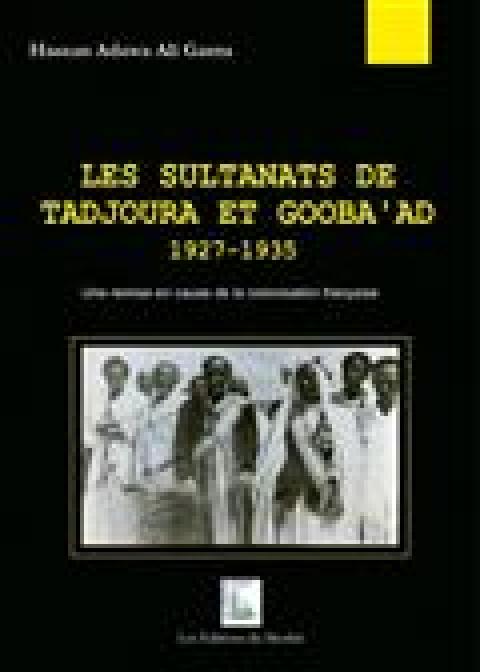
Hassan Adawa Ali Ganta, d’ethnie afar, est docteur en histoire et maître de conférences à l’université de Djibouti. Il a été ministre de l’éducation nationale de son pays et conseiller du Premier ministre. Il a consacré divers travaux à l’histoire de Djibouti et a entrepris de relater ici les évènements survenus dans les sultanats Afar de Tadjoura et de Gooba’ad au cours de la période de huit années allant de 1927 à 1935, qui voit l’occupation effective de ces deux entités politiques par les forces militaires et coloniales françaises.
Chacun sait que la France avait pris pied dans le golfe de Tadjourah en 1862, quand les sultans de Raheita, de Tadjourah et de Gooba’ad lui avaient cédé une bande côtière d’environ 400 km.2 s’étendant de Doumeïra à Ras Ali. Territoire désertique : Obock n’était qu’une position sans importance, fréquentée par des pêcheurs saisonniers. Un vieil Afar assurait la garde du pavillon.
D’entrée de jeu, l’auteur nous dit (notamment p. 18) que son travail a souffert de certains handicaps, liés entre autres à l’insuffisance de ses moyens financiers. C’est une difficulté que beaucoup de chercheurs ont connue. Il regrette de n’avoir pu procéder à une exploitation exhaustive des archives coloniales d’Aix en Provence ni explorer les fonds d’archives étrangères, notamment italiennes et britanniques.
La colonie de CFS avait une organisation administrative complexe puisqu’elle comprenait des territoires sous administration directe (Djibouti, Obock) et des territoires d’administration indirecte (Etats indigènes protégés). En 1927, le gouvernement français en vint à s’inquiéter des incursions des Italiens, présents en Erythrée, ainsi que des incantations impérialistes de Mussolini, qui revendiquait Djibouti, et décida de procéder à l’occupation effective des sultanats. Le gouverneur Pierre-Amable Chapon-Baissac, en poste à Djibouti de 1924 à 1933 fut l’artisan de cette troisième phase de l’occupation de la colonie, qui avait débuté à Obock et s’était poursuivie par Djibouti. Il entreprit son œuvre par la création de plusieurs petits postes côtiers pour assurer la surveillance du littoral et la répression de la contrebande. Chaque fortin avait une garnison de 7 à 8 gardes indigènes, une soixantaine au total en 1926[2]. Chapon-Baissac souhaitait occuper la bourgade de Tadjourah, centre commercial et caravanier actif et lieu de divers trafics, ce qui fut fait en 1927. L’usage voulait qu’à sa mort, le sultan de la ville fut remplacé par son vizir, appartenant à un sous clan. Mais cet ordre successoral traditionnel fut violé par les Français : à la mort du sultan Mahamad Arbahim (Mohammed Ibrahim), le vizir Habib fut écarté du trône qui fut attribué d’autorité au fils ainé du défunt, Humad Mahamad. Le vizir Habib, tenu pour responsable d’une embuscade, se vit infliger cinq ans d’internement à Madagascar. Chapon-Baissac entreprit ensuite d’occuper le sultanat de Gooba’ad dont les habitants opposèrent une vigoureuse résistance. Un poste administratif put être crée à Dikhil en 1928, suivi de la création d’un cercle de Dikhil-Gooba‘ad en 1931.
Alphonse Lippmann, grand défenseur des Issas et comme tel hostile aux Afars, fut le premier chef de ce poste qui rendit de grands services comme point d’appui pour une force de police mobile (une cinquantaine de miliciens issas aux ordres du sergent Ahmed Gouled, un ancien de Verdun). La fondation du poste, situé à l’ouest d’Ali Sabieh et pourvu d’un point d’eau permanent, traduisait le souci de l’administration de tenir les rezzous afars à l’écart de la voie ferrée de Djibouti à Addis, qui suit à peu près la frontière – toute théorique – entre Afars et Issas. (L’auteur a toutefois relevé des divergences entre les intérêts de l’administration et ceux de la compagnie du chemin de fer). Des postes de police étaient établis le long de la ligne à des intervalles d’une quinzaine de kilomètres, en général à proximité d’un château d’eau pour les machines, et les nomades cherchaient fréquemment à s’emparer de l’eau pour abreuver leurs troupeaux. Les incursions des Afars chez les Issas et des Issas chez les Afars s’accompagnaient, comme il se doit, de vols de bestiaux.
Un engagement que l’auteur qualifie de bataille, survenu à Udukya entre les miliciens et les guerriers Afar (12 mai 1930) eut pour conséquence la capture du sultan du Gooba’ad, Lo’oyta Hammad, et de son vizir Haji Ali, (lequel était soupçonné de traite d’esclaves) qui furent eux aussi déportés à Fort Dauphin. Lo’oyta Hammad y mourut en juillet 1931. A cette date, Chapon-Baissac considérait le sultanat comme une institution périmée, mais il se trompait probablement, puisqu’il a survécu jusqu’à nos jours. La pacification du territoire était encore loin d’être achevée et l’auteur ne recule pas devant le terme de « génocide »
(p. 113) en décrivant des massacres commis en 1934 par les troupes coloniales dans la plaine de l’Anlé. (il y aurait eu 311 victimes, des fosses communes en feraient foi). Une soixantaine de guerriers furent déportés à Madagascar dont 17 seulement seraient revenus. Peut-on pour autant parler des « bagnes » de Fort Dauphin ? Les internés jouissaient, à notre connaissance, d’un régime de semi-liberté.
En janvier 1935, le jeune administrateur Bernard, frais émoulu de l’Ecole Coloniale, trouvait la mort dans un engagement sévère à Moraïto, près du lac Abbé, en se portant à la rescousse d’un parti de guerriers Issa qui cherchaient à couper la retraite à un rezzou de nomades Afar.
Il est évident que de 1898 à la deuxième guerre mondiale (et peut-être au-delà) le pouvoir colonial a résolument joué la carte des Issas au détriment des Afars. Le nom même de la colonie : « Côte Française des Somalis », en fait foi. Un auteur Afar ne pouvait que dénoncer cette situation. Un hommage est toutefois rendu au peloton méhariste pour son action en faveur des populations, notamment dans le domaine de l’assistance médicale.
Cette lecture nous inspire diverses observations. L’orthographe est trop souvent négligée. Est-il exact d’écrire p. 12 que les deux sultanats étaient restés « indépendants » jusqu’en 1927 ? Les traités passés avec la France (représentée par Léonce Lagarde) en septembre 1884, leur faisaient défense de conclure tout accord avec une puissance étrangère ce qui équivalait à un protectorat, aussi souple fût il. Ces protectorats se trouvèrent inclus dans la colonie de Côte française des Somalis quand celle-ci fut crée en 1896. Les sultans continuèrent de jouir d’une très large autonomie interne mais ils n’étaient pas indépendants.
Nous avons par ailleurs relevé quelques inexactitudes : p. 32, le gouverneur qui était en poste à Djibouti en 1900 se nommait Alfred Martineau et non Martinet et il n’a pas promulgué de loi (il n’en avait pas le pouvoir) mais un simple règlement de police imposant aux Afar de Tadjourah le port d’un laissez-passer pour venir à Djibouti.
P. 51 : L’Aïd el-Adha et l’Aïd el Kebir sont une seule et même fête. Le 14 juillet est la fête de la Fédération et non de la Confédération.
La bibliographie est complète (les remarquables travaux de Colette Dubois sont en bonne place) mais quelques titres sont sans rapport avec le sujet. On regrette de ne pas trouver mention de la thèse de Rossana Van Gelder Pineda sur le chemin de fer franco-éthiopien.
[1]
Les recensions de l'Académie des sciences d'outre-mer sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrit.
Basé(e) sur une œuvre à www.academieoutremer.fr.
[2] La garde indigène, aussi dénommée milice, aux effectifs d’un bataillon avait été crée en 1909. Elle était principalement composée d’Issas (Somalis) dont la présence était très mal perçue par les Afars.