

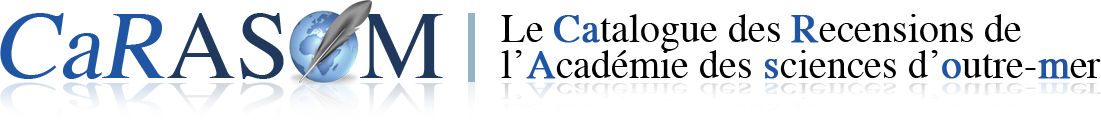
| Auteur | Márcio Souza ; traduction du brésilien par Stéphane Chao, Danielle Schramm ... |
| Editeur | Métailié |
| Date | 2024 |
| Pages | 452 |
| Sujets | Amazonie-Histoire |
| Cote | 69.062 |
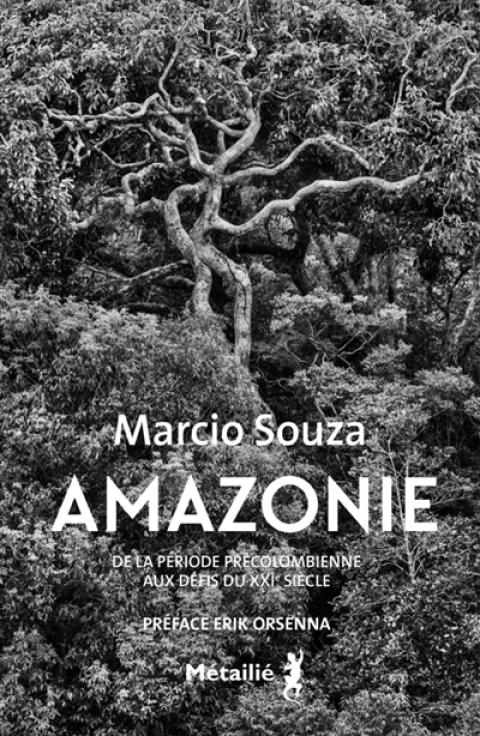
L’auteur, Màrcio Souza (1946-2024) est né à Manaus, capitale de l’État d’Amazonas. Grand romancier, metteur en scène de théâtre et d’opéra mais aussi historien, il a enseigné la littérature dans diverses universités américaines (Berkeley, Stamford, Austin et Dartmouth) ainsi qu’en Europe. La plus grande partie de son œuvre porte sur l’Amazonie. Il est l’auteur de nombreuses publications dont deux ont déjà été traduites en français et éditées par le même éditeur (éditions Métailié, Paris), dans la collection Bibliothèque brésilienne, L’Empereur d’Amazonie (1998), Mad Maria, (2002).
L’ouvrage est la traduction en français d’un texte publié au Brésil en 2019. Il est présenté comme un texte de référence sur l’Amazonie, et préfacé par Éric Orsenna. Il comporte 452 pages dont une bibliographie conséquente qui ne présente pas moins de 375 références, bibliographie riche en références brésiliennes, un lexique sommaire de mots brésiliens et deux cartes au début de l’ouvrage. C’est, en dix chapitres, l’histoire de ce sous-continent qu’est l’Amazonie, longtemps considéré comme l’une de deux entités brésiliennes distinctes (Brésil du sud, Brésil du nord), dix chapitres, à savoir.: 1/ Géographie d’un sous-continent, 2/ L’Amazonie avant les européens, 3/ La conquête, 4/ La colonisation, 5/ Soldats, Savants et voyageurs , 6/ L’Amazonie et l’Empire du Brésil, 7/ Le Cabanagem,[1] 8/ La fièvre du caoutchouc, 9/ La société extractiviste ,10/ La frontière économique
On peut pourtant regretter que le plus récent ouvrage cité dans la bibliographie remonte à 2014. Ainsi, la bibliographie ne permet pas de faire état des avancées récentes s’agissant des derniers développements des connaissances de l’histoire climatique de la forêt amazonienne et du rôle supposé de la forêt amazonienne dans le climat de la terre : même si l’expression « Le poumon du monde ? » (p.37) est suivie d’un point d’interrogation ; l’auteur accompagne cette présentation d’une interrogation ; ainsi, « la question est de savoir si la forêt amazonienne est une source ou un puits de carbone est ouverte ». Il indique cependant la difficulté d’esquisser un bilan complet et crédible de l’impact de l’Amazonie sur l’atmosphère.[2]
Ce n’est pas la partie principale de ce livre qui garde un très grand intérêt car il nous offre un regard brésilien sur cette région du monde et une passionnante histoire qui ne couvre pas seulement l’Amazonie brésilienne, en s’ouvrant à cette Amazonie qui parle espagnol, néerlandais, anglais, français.
L’ouvrage vaut en effet par l’histoire du bassin amazonien, depuis les temps précolombiens jusqu’à nos jours. La réalité précolombienne de la région est maintenant attestée par les travaux archéologiques, ethnolinguistiques et géographiques prouvant l’occupation ancienne de l’Amazonie, les sociétés amérindiennes réalisant une véritable domestication de la nature. Marcio Souza développe une géographie humaine de la colonisation, décrivant au passage les nombreux groupes ethniques et culturels qui ont contribué à la formation de l’Amazonie, depuis les colons portugais jusqu’aux japonais, les derniers à s’installer (1928), aboutissant à une culture singulière.
Rien n’échappe à l’auteur (chapitre 3) lorsqu’il note que dans la phase de conquête et de pénétration, « le récit personnel et étonné des voyageurs va jouer dans la culture le même rôle que l’économie de la collecte et de la prospection forestière avait joué dans l’économie de la conquête. Ce sont ces relations de voyageurs qui ultérieurement servirent en grande partie à orienter, classifier et interpréter la région comme un objet littéraire et scientifique ; ce sont eux, ces véritables scrutateurs du fantastique et du merveilleux, qui permirent de connaître les aspects visibles et invisibles annonçant la future expression de l’énigme régionale à travers une écriture singulière : L’Amazonie s’ouvrait aux yeux de l’occident…. Ils offraient au monde une nouvelle cosmogonie, dramaturgie de nouvelles vies, formulant le droit de conquête des pionniers européens. »
C’est l’ouverture aux autres cultures, la modification du discours colonial à partir de 1750 en Amazonie, quand l’expression devient laïque et profane. Viendront ensuite la construction d’une identité amazonienne entre guerres civiles, pacifications. Il y aura longtemps deux colonies de langue portugaise en Amérique du Sud, une découverte par Cabral en 1500, baptisée Brésil et administrée par des gouverneurs généraux et des vice- rois, ayant pour capitale Rio de Janeiro, et un territoire au Nord, administré par des gouverneurs militaires et des hauts fonctionnaires directement lié à Lisbonne et soucieux d’indépendance, ayant pour capitale Santa Maria de Belém et ce jusqu’en 1823, date à laquelle l’Empire du Brésil entreprit d’annexer la colonie nordiste. L’Amazonie cesse alors d’être sous administration coloniale autonome pour se transformer en frontière économique (chapitre 10). Hostiles à une séparation d’avec le Portugal, après des années d’administration directe, la nouvelle de l’indépendance du Brésil sera mal accueillie en Amazonie.
Comme le Brésil, l’Amazonie elle est le fruit d’un ensemble de paradoxes entre pauvreté et richesse, entre modernité et archaïsme, auxquels se surimpose le modèle colonial portugais, mais comme le souligne Éric Orsenna dans la préface de l’ouvrage, aboutissant à une identité amazonienne « créative et vivante ».
Cet ouvrage est bienvenu car il apporte ce regard brésilien sur l’Amazonie, heureusement traduit en français, et cette analyse extérieure des affrontements des nations européennes qui vont exporter leurs rivalités, politiques, économiques, jusqu’aux confins de l’Amazonie.
C’est aussi le caractère particulier du développement d’une société extractiviste qui voit l’apparition d’une puissante classe de commerçants très liés à l’import-export, du développement de villes capitales, Manaus, Belém, l’enrichissement d’oligarchies locales, les luttes sociales, les grands projets, les zones franches, mais encore les torts irréparables causés aux peuples indigènes, les agressions contre l’écosystème, les migrations internes de populations comme celles du sertao vers la forêt, les fronts pionniers des colons venus du sud du Brésil, les conflits de terres, l’occupation de terres par des populations non résidentes.
Dans cette histoire de l’Amazonie, Màrcio Souza fait œuvre d’historien rigoureux au service d’une histoire mal connue de l’Ocident, illustrant chaque époque d’analyses et de personnages aux prises avec des aventures, des rencontres, des conflits, et des débats qui renvoient le lecteur européen à sa propre histoire.
L’auteur de cette recension ne peut qu’ajouter cette citation de Euclides da Cunha, en conclusion à cette revue de l’ouvrage de Marcio Souza, revue forcément incomplète :
« L’Amazonie est la dernière page de la Genèse encore en train de s’écrire, avec tant de finesse et tant d’émotion qu’elle semble palpiter de fièvre. Elle est une guerre de mille ans contre l’inconnu. Elle ne triomphera qu’au terme de travaux incalculables dans un futur lointain. Pendant ce temps elle sera la terre enfant, la terre adolescente, la terre qui continue à grandir encore. »
Euclides da Cunha, Os sertoes (cité dans Environnement et développement en Amazonie brésilienne, Belin Ed. 1997)
[1]Cabanagem : vient de cabana qui désigne une habitation modeste, désigne la plus grande révolte populaire du Brésil qui agita les régions de l’Atlantique aux Andes (1835-1840)
[2] On sait aujourd’hui que l’Amazonie, comme les forêts en général ne sont pas des producteurs nets d’oxygène, le bilan O2/CO2 est quasiment nul. Non, la forêt amazonienne n’est pas le poumon de la terre, non la forêt amazonienne ne fournit pas 20 % de l’oxygène terrestre ; non, le biote terrestre n’est pas le principal vecteur d’élimination de CO2 dans l’atmosphère, l’océan étant et de loin le premier puits de carbone (voir L’Amazonie, le « poumon de la terre » ou le révélateur des limites de nos dirigeants, Pierre Thomas, Laboratoire de géologie de Lyon/ENS de Lyon, 27/08/2019)