

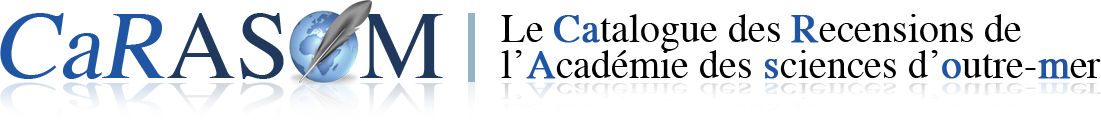
| Auteur | Christine Desouches |
| Editeur | Débats publics |
| Date | 2025 |
| Pages | 275 |
| Sujets | Francophonie XXIe siècle |
| Cote | 69.238 |
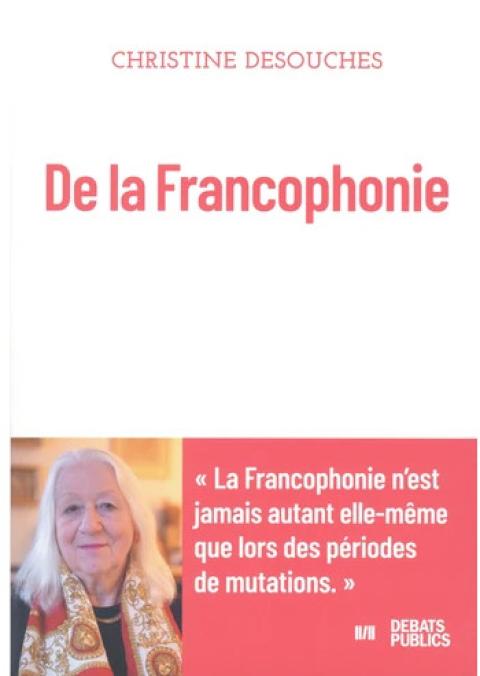
Attention au titre choisi par Christine Desouches. Sa « Francophonie » avec un F majuscule n'entend pas traiter essentiellement de l'espace du locuteur francophone mais plutôt de ce rassemblement volontaire de peuples et d'états liés par le français autour d'un projet politique commun et d'un ensemble de valeurs.
Ce choix n'est pas surprenant. Universitaire, juste auteur d'une thèse préparée sous la direction d'un maître très respecté, le professeur Gérard Conac, elle peut témoigner car elle a été une observatrice et une actrice privilégiée de la dynamique francophone. Coopérante en Afrique dans les années 70, puis déléguée générale à la coopération juridique et judiciaire, à la délégation aux droits de l’homme et à la démocratie à l'ACCT (Action Culturelle et Technique) devenue ensuite 0IF (Organisation internationale de la Francophonie), il ne s'agit pas pour elle d'écrire un mémoire en défense de ce qu'elle a pu faire en responsabilité. Il s'agit de regarder en face les ambiguïtés de la Francophonie et d'appeler à une clarification.
La Francophonie a des valeurs. Elle y croit. Elle les rappelle. Son livre est aussi une profession de foi.
La Francophonie, réalité polysémique aux contours ambigus peut-elle sortir de l’ambiguïté autrement qu’à son détriment ?
Née en pleine décolonisation, la Francophonie a toujours été suspecte.
Voulue par de grands décolonisateurs, Senghor, Bourguiba, Hamani Diori, Norodom Sihanouk, elle a pourtant été suspectée d'être une tentative néocoloniale. Consciente de ce soupçon, la France de De Gaulle s'est d'abord tenue à l’écart d’un mouvement voulu par des États africains qui venaient de quitter la Communauté franco-africaine.
C'est François Mitterrand qui est sorti de cet attentisme un organisant à Versailles ( 1986) puis à Québec ( 1987) les premiers sommets de la Francophonie, après qu’un accord sur les modalités de participation eût été trouvé entre le Canada et le Québec.
Jacques Chirac a poursuivi dans cette voie. Choisir pour le poste de secrétaire général de la Francophonie un ancien secrétaire général de L'ONU, réunir en 1997 un Sommet à Hanoï à l'invitation du Viêt-Nam, c'était démontrer par les faits qu'il s'agissait bien d'autre chose que de la reconstitution honteuse d’un Empire colonial disparu.
Le 3 novembre 2000 était adoptée à Bamako une déclaration sur « Les pratiques des droits et libertés de l'espace francophone », charte globale de la démocratie dotée d'un titre lui permettant d'agir efficacement. Le sommet de Ouagadougou, en novembre 2009, confirmait encore cette orientation.
Manifestement, Christine Desouches a la nostalgie de cette période et l'on comprend qu'elle s'interroge douloureusement : « Nous étions nous trompés sur la pérennité et la profondeur de l'adhésion d'une partie des États membres ainsi que sur la nature des attentes de la population ? »
C'est que vingt années se sont écoulées. Bamako, Ouagadougou, des noms qui comptent dans l’histoire de la francophonie, sont maintenant des capitales d'États gouvernés par des militaires ayant renversé des présidents légitimement élus et ne se souciant guère des observatoires de la Francophonie qui, d’ailleurs, réagit mal et maladroitement.
Avec la bienveillance de nouvelles puissances impériales, la Russie, la Chine, le Mali, le Niger et le Burkina Faso font à l’OIF un nouveau procès en hypocrisie en lui reprochant sa « compréhension » à l’égard du Gabon, du Tchad, voire de la Guinée. Mais que faire ? Sanctionner, c’est aussi s’exposer à nouveau à l’accusation d’intervention excessive dans les affaires intérieures de pays indépendants.
Mais ne rien faire désespère ceux qui veulent l'épanouissement de l'État de droit en Afrique.
La Francophonie et ses valeurs ne vont-elles pas constituer un casse-tête pour la diplomatie française et celle de l'Occident global ?
Christine Desouches affirme avec force son impatience et son inquiétude « autrefois acteur diplomatique reconnu et respecté, inspirant et appuyant la défense et la promotion de l’État de droit auprès des gouvernements et sociétés civiles…
La Francophonie est devenue un acteur secondaire, appliquant difficilement ses propres normes ».
La Francophonie a-t-elle encore un avenir?
Elle forme un espace mais il devient de plus en plus singulier. L'OIF se glorifie de regrouper d'avantage d'états que le Commonwealth. Mais à côté de pays réellement francophones, on compte de plus en plus de pays aux Francophones plus que universitaires. L'OIF sera-t-elle composée à l'avenir de pays à la francophonie largement virtuelle tandis que des pays encore Francophones, comme l'Algérie, continueraient à s'en tenir éloignés ? N'est-il pas temps de revoir la géographie de la Francophonie et donc d'en respecter les critères d'appartenance ?
Le monde change. Les technologies nouvelles ont pu bousculer l'usage du français mais de nouveaux procédés de traduction automatique peuvent au contraire réduire la nécessité du recours au tout-anglais.
La France se décidera-t-elle enfin à défendre l'usage raisonnable du Français dans les institutions internationales et singulièrement en Europe ?
Au XXIème siècle, la francophonie, comme d'autres espaces, peut utilement favoriser la compréhension entre le Sud (pas si global) et l'occident (décidément fracturé).
Essai tonique, précis, sincère, ce livre de Christine Desouches, présidente de l'Académie des Sciences d'outre-mer, appelle à une nouvelle détermination.
Puisse-t-il être lu, discuté, et inciter à l’action.