


| Auteur | Mathieu Guérin |
| Editeur | École française d’Extrême-Orient |
| Date | 2023 |
| Pages | 454 |
| Sujets | Conditions rurales Kampong Thom (Cambodge ; région) Histoire Politique et gouvernement Cambodge 1863-1953 |
| Cote | 67.608 |
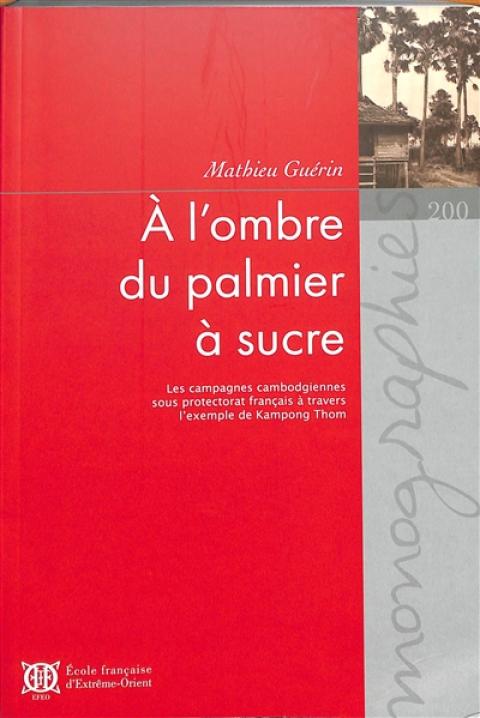
L’ouvrage, dense et volumineux (461 pages dont la pagination s’arrête curieusement à la page 454, avant les diverses tables) de Mathieu Guérin, historien spécialiste du Cambodge, se propose d’analyser les transformations de la société khmère sous l’effet du contact colonial, entre le milieu du XIXe siècle et l’indépendance en 1953. Son étude portant spécifiquement sur la terre de Kampong Svay, aujourd’hui province de Kampong Thom, située au centre du Cambodge, illustre les dynamiques de changement du royaume.
Dans son introduction, l’auteur annonce vouloir se démarquer de « l‘ethnocentrisme occidental » et des visions d’un Cambodge éternel attribuées notamment à B.P. Groslier ou J. Delvert, en tentant de se placer du point de vue des Cambodgiens. La difficulté est qu’il n’existe que très peu de textes khmers et que les sources sont principalement françaises, archives coloniales, notamment à Kampong Thom, ou travaux d’administrateurs comme Adhèmard Leclère, « pionnier de l’ethnographie khmère ». Une dizaine d’entretiens avec des personnes âgées effectués entre 2007 et 2017, comblent difficilement cette lacune, de sorte que le livre de Mathieu Guérin recourt aux méthodes éprouvées de reconstitution du passé en explorant les différentes facettes, politiques, anthropologiques d’une société fondamentalement paysanne, confrontée à une modernité importée.
L’ouvrage est organisé en deux parties, avant et après 1897, date de l’éviction du roi Norodom et de la mise en place effective de l’administration coloniale. La première partie brosse un tableau de la terre de Kampong Svay, « marche du royaume », sur les plans politiques, économiques et sociaux. Le souverain, protecteur de son peuple, assure en principe sa sécurité en échange de son obéissance, l’État pouvant être perçu,à l’occasion, comme un outil d’oppression, source de révoltes, comme en 1885. L’économie associe les rizières, la pêche et les activités de collecte dans les forêts claires à diptérocarpacées qui couvrent la plus grande partie d’un espace faiblement peuplé. Du palmier à sucre, le « thnot » emblématique des campagnes cambodgiennes, il n’est curieusement à peine fait mention alors qu’il donne son titre à l’ouvrage et joue, outre sa fonction paysagère, un rôle structurant dans la société paysanne khmère. Celle-ci oppose deux statuts, celui des « hommes en pleine possession de leurs moyens », et celui de ceux qui ont perdu « tout ou partie de leur libre arbitre », généralement pour cause de dette. Le regard colonial distinguait quant à lui « hommes libres » et « esclaves », ce qui à vrai dire revient à peu près au même dès lors qu’il s’agit de statuts et non de catégories essentialisées, d’autant qu’il existe une certaine fluidité entre ces statuts.
La deuxième partie étudie l’impact de l’administration coloniale sur la société khmère et sa « modernisation ». L’auteur souligne le rôle de la scolarisation, en particulier celui de l’École cambodgienne de Paris, pour la formation des nouvelles élites appelées à être les auxiliaires d’une nouvelle organisation du pouvoir. Il évoque aussi, trop rapidement, le rôle de l’ouverture de routes et la monétarisation comme facteurs de transformation économique et sociale, tout en insistant sur le fait que celles-ci demeurent superficielles. Selon l’auteur, en effet, le protectorat n’a pas réussi à imposer le modèle français d’administration faute d’avoir compris que le pouvoir du roi était moins de nature administrative que religieuse au sein d’une société imprégnée du bouddhisme théravada, ce qui pose la question récurrente de toute colonisation du sens de « l’émancipation » au nom de valeurs occidentales.
La conclusion récapitule en une vingtaine de pages l’essentiel des idées forces qui charpentent la réflexion de l’auteur tout en introduisant des acteurs essentiels du changement, en particulier les Chinois. Profitant de l’ouverture spatiale du Cambodge par les routes et les marchés, vecteurs de l’économie-monde, « les principaux acteurs de cette intégration sont les réseaux chinois », écrit-il : on aurait attendu qu’ils apparaissent plus tôt dans sa démonstration. Parallèlement s’observe le passage d’une société fondée sur le statut personnel à une société hiérarchisée par la richesse - les élites anciennes s’étant souvent glissées dans ce monde nouveau. Ce type d’évolution n’est pas spécifique au Cambodge, mais le mérite de Mathieu Guérin est d’en apporter des éléments précis d’analyse, témoignant de sa connaissance fine de la société cambodgienne. Il donne par ailleurs des clés de compréhension de l’émergence des Khmers rouges et de la tragédie du génocide des années 1975-79.
La dernière phrase de son livre, ouvre sur une note pessimiste, déplorant le « désastre écologique » de la déforestation depuis la fin des années 1990. Elle pointe l’alliance entre entrepreneurs d’origine chinoise et serviteurs de l’État, incarnée par les Sino-Khmers, dont les facteurs « trouvent leur origine dans la période du protectorat ».
Le temps long est certes indispensable à la compréhension du temps présent, mais le protectorat n’est redevable ni de la diaspora chinoise ancienne ni des appétits actuels de la Chine, même s’il a préparé le terrain à ces dynamiques locales contemporaines.