


| Auteur | coordonné par Odile Goerg et Françoise Raison-Jourde |
| Editeur | l'Harmattan |
| Date | 2012 |
| Pages | 254 |
| Sujets | Aide économique française Afrique 20e siècle France Relations économiques extérieures Afrique Afrique Relations économiques extérieures France |
| Cote | 59.117 |
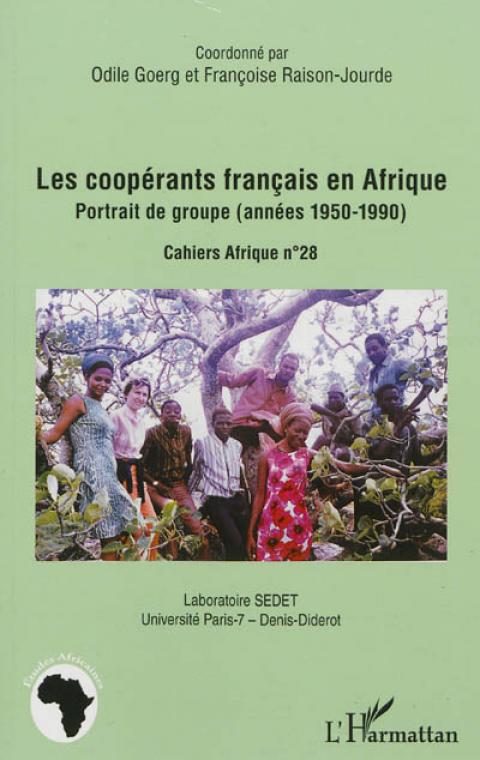
Il est parfois déconcertant de devoir rendre compte d’un ouvrage consacré à un sujet dont on a personnellement une longue expérience vécue. Pris entre l’exigence de l’impartialité dans l’analyse critique du texte et une mémoire personnelle du « vécu », donc en partie subjective, on peut être conduit sur plusieurs points et non des moindres, à contredire ou pour le moins nuancer ledit texte. On tentera donc de trouver un juste équilibre.
On commencera par quelques constats qui n’appellent guère discussion.
Auparavant, il convient de s’entendre sur les termes, le vocabulaire. Les « coopérants », selon l’acception la plus couramment admise de la fin des années 1950 au début du présent siècle, ont été, pour l’essentiel, des personnes mises, à partir des indépendances, à la disposition d’États nouvellement indépendants ou auprès d’organismes laïques ou religieux qui menaient des actions de coopération dans lesdits États.
« Mis à disposition » signifiait que, directement ou à travers des structures associatives, l’État français assurait au moins le traitement de base de ces personnels, les États « bénéficiaires » prenant à leur charge, directement ou par remboursement à la France, une partie des accessoires de rémunérations, les modalités précises étant fixées dans le cadre d’accords de coopération ou d’accords spécifiques. « Mis à disposition » signifie également que ces « coopérants » ne recevaient d’instruction, dans leur cadre professionnel, que des autorités locales dont ils relevaient.
À quoi il convient d’ajouter une catégorie particulière de personnels relevant bien du terme admis de « coopérants » : les jeunes gens qui, en lieu et place d’un service national militaire, optaient pour un service civil en coopération, généralement plus long que le service militaire classique, dont l’appellation a varié dans le temps mais généralement connus sous le nom de « VSN » ou « VSNA » (volontaires du service national). Ils furent particulièrement nombreux dans l’enseignement.
On précisera que la France ne fut pas seule à envoyer des « coopérants » en Afrique, d’autres États, européens ou non, le firent, tout comme la Communauté européenne et un certain nombre d’organisations multilatérales. « Coopérants » qui pouvaient parfaitement côtoyer dans les mêmes bureaux, sur les mêmes dossiers, les « coopérants » mis à disposition par la France. Parmi eux, des Français bien sûr.
On assimile parfois au terme de « coopérants » les agents des nombreuses sociétés nationales de développement, généralement héritées de la fin de la période qui précéda les indépendances, appartenant en fait à des sociétés semi-publiques françaises mais détachés (BDPA, CFDT, SEDES…).
L’ouvrage dont on parle ici traite bien de ces types de personnel, à l’exclusion des agents des bureaux d’études ou d’ingénierie et à plus forte raison des agents des diverses entreprises de travaux publics, de télécommunication etc. qui exécutaient les contrats financés sur crédits français, européens ou multilatéraux d’aide au développement (Fac ou Caisse centrale pour la France, FED ou BEI pour l’Europe).
Très naturellement, quelques chapitres ou sous-chapitres traitent d’expériences particulières, tels ceux consacrés à « la coopération dans l’enseignement privé protestant, les VSN du DEFAP à Madagascar », ou aux « coopérants dans l’enseignement secondaire en Haute-Volta jusqu’au milieu des années 1970 ». Ou le chapitre final qui décrit « en contrepoint » les coopérants russes et la coopération entre l’URSS et quelques pays africains francophones qui se définirent pendant un certain nombre d’années comme marxistes, à l’africaine certes. Ou, encore, le cas particulier de coopérants français au Sénégal, originaires des DOM d’Antilles-Guyane. Il s’agit là de monographies certainement utiles, tant les « coopérants » ont peu laissé de mémoires de leurs séjours et tant la littérature à leur propos est mince. Utiles et aussi intéressantes car elles reflètent des aventures, associatives ou non, souvent individuelles, et l’on ne rassemblera jamais assez de témoignages sur une période et un type d’activité professionnelle et individuelle, période d’une grande brièveté (environ un demi-siècle), mais dont rien auparavant n’avait eu lieu sous cette forme et, probablement après non plus.
Certes, chacune de ces « monographies » mérite discussions et questions : le mieux est d’inviter le lecteur à « y aller voir », elles méritent le détour. On se contentera de mentionner qu’elles devraient être suivies d’autres « monographies », complétant ainsi et progressivement un tableau dont seules quelques esquisses apparaissent actuellement. Mais n’est-ce pas le rôle d’un laboratoire tel que le SEDET que de poursuivre ses investigations ? On pourrait notamment suggérer une analyse de ce su furent et sont encore les coopérants chinois ou encore les « Peace corp » américains, beaucoup plus intéressants dans leur pratique et leurs méthodes que ne le furent, du temps du rideau de fer, les coopérants russes.
Après ces notations qui devraient inciter le lecteur à la lecture, on passera aux observations critiques.
Une de détail tout d’abord : p. 18, dans l’introduction apparaît le terme d’ « assistants techniques » qui semble constituer une catégorie particulière de « coopérants ». J’ai souvenir constant que l’un ou l’autre terme était régulièrement utilisé, sans distinction, pour désigner les mêmes personnels, terme générique donc et interchangeable.
En revanche, ni dans cette introduction ni dans le premier chapitre qui traite de l’ENFOM (on va y revenir), n’apparaissent des distinctions beaucoup plus significatives (quoique non « formalisées » dans quelque texte que ce soit) : il y a eu, dans le « champ» couvert par le ministère de la Coopération (nom générique qui a plusieurs fois changé dans le temps) une « coopération de substitution », une « coopération de conseil », une « coopération de projet ».
Cette classification pragmatique a l’avantage de définir deux ou trois temps de la coopération :
- celle où par manque de cadres nationaux, les États indépendants souhaitaient conserver en responsabilité et dans les divers organigrammes administratifs des Français « mis à leur disposition » ;
- celle où les cadres nationaux, revenant de formation, remplaçaient au fur et à mesure les coopérants de « substitution », lesquels pouvaient rester, pour une période généralement brève, aux côtés de leurs successeurs pour les appuyer ; celle aussi où, généralement au niveau des directeurs de ministères, des ministres, voire des présidents, les États faisaient appel à des experts de haut niveau pour élaborer ou accompagner les dossiers les plus délicats ou les plus complexes ;
- celle où des coopérants ou des équipes de coopérants élaboraient, pour le compte des administrations nationales, des projets à présenter à des bailleurs de fonds, la raison en étant généralement que lesdits coopérants connaissaient souvent mieux que les nationaux les méandres et pratiques de ces bailleurs.
Cette classification sommaire mérite certes un certain nombre d’adaptations aux différents corps de métier de la coopération : il paraît clair que les enseignants du secondaire, nombreux dans les années 1960, avaient vocation à disparaître au fur et à mesure que leurs homologues nationaux étaient en mesure de les remplacer, ils n’avaient pas vocation à « conseiller » leurs successeurs ni à bâtir des projets ; il est tout aussi clair que la durée de vie des coopérants « conseillers de haut niveau » dépendait en grande partie de la durée de vie aux postes de responsabilité ou politique des personnalités conseillées ; on devine sans peine que la durée de vie des « bâtisseurs de projets » dépendait du temps nécessaire à l’obtention des financements et, éventuellement, de la durée de mise en œuvre de ces projets.
Cette classification permet également de soulever la question de la « professionnalisation » des coopérants, qui n’est pratiquement pas abordée dans l’ouvrage sous revue. Par définition, dans tous les cas, la fonction de coopérant est limitée dans le temps et ne pouvait être qu’une étape de carrière professionnelle. De fait, seule une toute petite minorité d’agents, devenus jeunes coopérants au tout début des années 1960, a pu atteindre l’âge de la retraite sans cesser de l’être. Les autres, s’ils n’optaient pas pour un retour rapide dans leur corps d’origine ou dans leur profession en France, se coupaient assez vite de leur milieu et connaissaient, l’inévitable moment venu, de graves difficultés de reconversion. Or, jusque tardivement, c’est-à-dire vers le milieu des années 1990, le ministère de la Coopération n’a jamais su limiter les « temps de séjour ». On trouve là l’une des raisons pour lesquelles les coopérants français contractuels de ce ministère, fonctionnaires détachés ou recrutés sur le marché du travail ont souvent revendiqué une sorte de statut qui ne leur a jamais été accordé.
Une autre difficulté, inhérente celle-ci à la médiocrité des statistiques disponibles, eût mérité une analyse plus critique. L’évolution des effectifs de coopérants prête à de nombreuses approximations, selon que l’on se restreint à des définitions strictes (ici, les agents qui étaient sous contrat du ministère de la Coopération et ceux qui étaient agents de structures associatives ou semi-publiques financées presque exclusivement par ce ministère) ou que l’on étend le champ à des personnels qui ne peuvent être considérés comme coopérants, par exemple les agents de l’enseignement français à l’étranger ou les agents des centres culturels. Les statistiques produites sont, de ce point de vue, mal exploitables. Mais que l’on date le déclin des années 1970, 1980 ou 1985, l’une des principales causes de ce déclin tient à une cause précise : les États partenaires étaient tenus de rembourser à la France une partie du coût de l’assistance technique ; les plus pauvres, au Sahel notamment, ont cessé de le faire à partir de 1975, les plus riches, comme la Côte d’Ivoire (qui remboursait 75 % de ce coût), à partir de 1984/1985. Lorsque la France s’est avisée de réclamer son dû, avec insistance, la « déflation » des effectifs a été le fait des partenaires et elle a été rapide (dans le cas de la Côte d’Ivoire, réduction de plus de moitié entre 1990 et 1995). Ce constat pose inévitablement la question de savoir dans quelle mesure l’assistance technique était indispensable voire utile. On notera à ce sujet que dans les pays le plus récemment entrés dans le giron du ministère de la Coopération, Mozambique et Namibie par exemple, les effectifs de « coopérants » sont toujours restés squelettiques.
Plus généralement, l’approche de l’étude par cas particuliers ou selon une méthodologie fondée plus sur des entretiens, le plus souvent avec des enseignants, ne permet pas de bien comprendre, au-delà des appréciations personnelles, dans quelle mesure des effectifs de coopérants français, très supérieurs à ce que consentaient les autres aides bi ou multi latérales, ont été réellement utiles aux pays concernés.
Dans les dix premières années des indépendances, certainement car ils ont permis une substitution temporaire à des cadres nationaux insuffisants en nombre et, surtout, un considérable rattrapage dans les domaines de l’enseignement secondaire puis supérieur (la France qui se vante de son œuvre éducative pendant la période coloniale a en effet formé sur place en bon nombre des cadres africains moyens mais, par exemple dans les pays du Sahel, la scolarisation n’atteignait guère plus de 10 à 15 % d’enfants d’une classe d’âge et il n’existait en Afrique noire française aucune université…).
Dans les années suivantes, la réponse est beaucoup plus incertaine. Il est probable que ce que l’on a appelé la « déflation » des effectifs eût dû être bien plus rapide qu’elle ne l’a été.
Le chapitre intitulé « L’ENFOM, 1945-1959 : la coopération au programme» est probablement le plus discutable. Non pas quant à la qualité de la recherche mais sur l’interprétation qui en est faite. Étant probablement ici encore plus juge et partie que dans l’analyse critique qui précède, nous réserverons à l’équipe du SEDET les réflexions qu’il inspire.
Une courte notation cependant : l’un des protagonistes cités (Nicolas Leca – et non Luca comme orthographié dans le texte) pose un problème. Il était certes un personnage rude au langage souvent abrupt. Ses jugements à l’emporte-pièce irritaient souvent et appelaient au moins des nuances. Il convient cependant de se poser une question : comment cet homme de mauvais caractère a-t-il pu, malgré les conseils notamment de la France, être appelé, en 1959, par Diori Hamani pour être son directeur de cabinet, ce jusqu’au coup d’État de 1974, et le servir loyalement, s’il était aussi raciste et de la « vieille école colonialiste » qu’on l’a dit ?
La vivacité de certains de ces commentaires ne doit pas être prise en mauvaise part : elle démontre que le sujet est encore susceptible de prêter à de nombreuses discussions et, surtout, à la poursuite des recherches du laboratoire qui l’a pris en charge.
Les recensions de l' Académie des sciences d'outre-mer sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrite.
Basé(e) sur une œuvre à www.academieoutremer.fr.