


| Auteur | Richard Grove ; traduit de l'anglais par Mathias Lefèvre ; présenté par Grégory Quenet |
| Editeur | la Découverte |
| Date | 1993 |
| Pages | 138 |
| Sujets | Écologie Régions tropicales 17e siècle Écologie Régions tropicales 19e siècle |
| Cote | 59.370 |
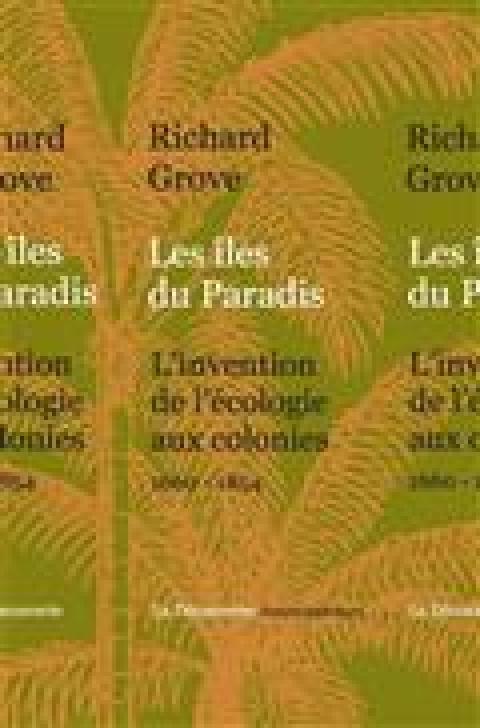
Richard Grove est reconnu internationalement comme spécialiste de l’histoire environnementale. Il a développé l’hypothèse que la conscience d’un impact anthropique sur l’environnement et les mesures de gestion préventives, de protection et de restauration ne seraient pas nées récemment avec les idées de conservation attribuées aux anglo-saxons au XIXe siècle, notamment aux États Unis (avec la création de parcs nationaux), mais coexistait déjà dans certaines colonies, notamment celles insulaires tropicales, entre 1650 et 1850. L’hypothèse centrale de Grove repose sur la rencontre des européens et un environnement inconnu, souvent interprété comme l’Eden perdu, devenant alors un laboratoire d’imaginaires, de pratiques et de connaissances.
Grove soutient le concept de « Green Imperialism » par le fait que l’état colonial fut souvent en contradiction avec la pratique courante de l’expansion impériale et de la maximisation du profit. De nouvelles idées scientifiques et concepts environnementaux purent plus facilement être étudiés loin de la métropole, des pratiques plus aisément diffusées au travers le vaste empire colonial.
On pourrait rappeler que depuis la haute antiquité l’homme s’est préoccupé, à des divers degrés, des effets d’une surexploitation de certains éléments de la nature et a cherché à mettre « de côté » des espaces (par exemple, bois sacrés et sources de la Grèce ancienne dont on trouve encore l’équivalent en Afrique et des espèces (animaux dont l’usage était proscrit ou réservé à certaines catégories ou castes) pour de multiples raisons : religieuses, ludiques ou utilitaires.
L'humanisme italien de la Renaissance est fortement empreint du concept de société idéale au sein d’une nature bien gérée, voire protégée. On retrouve ce concept dans le Songe de Poliphile publié en 1467, lorsque Francesco Colonna décrit une cité idéale sur l'île Cythérée. Aussi Thomas Moore dans son ouvrage Utopia paru en 1516, amène l’idée « d’une population grossière et sauvage qui serait humanisée au point de former un peuple qui surpasse tous les autres en civilisation qui habiterait une île, Abraxa, un lieu protégé rebutant les voyageurs par sa difficulté d’accès et par des barrières naturelles ».
Mais la véritable protection de la « nature sauvage », magnifiée pour des raisons esthétiques ou éthiques n’apparaît, dans le monde occidental, qu’à la fin du 17e siècle et surtout au 18eme siècle. Se développe alors un certain tourisme de nature centré sur la recherche de paysages pittoresques et sauvages, contemporain de la publication d’ouvrages botaniques de vulgarisation.
Parallèlement à la sanctuarisation de certains espaces, les pays de l’hémisphère nord cherchaient des dispositifs visant au contrôle de l’utilisation des espèces elles-mêmes. En effet, à la fin du 19e siècle la chasse où la pêche industrielle et de loisir, la destruction irraisonnée de prédateurs, tout comme la collecte d’espèces végétales et animales rares se sont développées sans contrôle. Il apparût vite qu’une stratégie de protection limitée à la mise en réserve de quelques territoires serait insuffisante. Le contrôle de l’utilisation des espèces fut alors l’objet de réunions et de conventions internationales. La nécessité de tenir compte de l’homme et de ses activités tout en développant une utilisation raisonnée des ressources naturelles est renforcée par une vaste mobilisation de scientifiques qui multiplient les ouvrages pour sensibiliser l’opinion publique.
Que d’une vision où la protection de la nature se limitait à délimiter des « sanctuaires » (qui dans certains cas sont nécessaires), à contrôler l’utilisation des espèces, l’on est passé progressivement à une vision beaucoup plus large conduisant à s’interroger à nouveau sur les rapports de l’homme avec le reste du monde vivant et à devoir admettre que notre espèce était amenée à limiter certaines de ses activités si elle souhaitait entretenir et transmettre un patrimoine « naturel ». La conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement de Rio (1992) va, en quelque sorte, faire sortir la diversité biologique du cénacle des spécialistes qui tentaient d’alerter depuis des décennies l’opinion publique et les responsables politiques sur l’érosion constatée. La diversité biologique objet d’une convention internationale signée en grande pompe devenait « objet politique ».
L'absence de mise en perspective sociale et historique de l'action humaine sur l'étendue terrestre - c'est-à-dire la transformation de la nature en espace sape la base conceptuelle des politiques conservatrices de protection de la nature. Pour que celle-ci puisse être viable à long terme, on doit cesser d'opposer «l’humanité» au reste du monde vivant, c'est-à-dire abandonner cette conception qui consiste à vouloir conserver la nature à l'écart des hommes. Seule une analyse capable d'appréhender la complexité des relations entre société, espace et nature, une analyse qui comprenne la globalité des phénomènes en cause tout en les situant sur une Terre transformée en écoumène peut servir de fondement à une politique visant à préserver la diversité terrestre, celle des milieux géographiques.
Ce que l'homme détruit comme espèces, paysages ou cultures ne sera pas remplacé: l'irréversibilité de ce processus anthropique/entropique devrait déboucher sur la conscience que la Terre est un ensemble clos, dans lequel chaque lieu aurait une valeur parce qu'il est une combinaison unique et non reproductible de la biosphère et de l'espace des sociétés à un moment donné de l'histoire. Car ce qui disparaît ou risque de disparaître, ce sont des écosystèmes et des milieux singuliers, constitués par des lieux d'extension variable et en nombre inconnu mais forcément limité, puisqu'ils sont situés sur la planète Terre.
La « géodiversité» peut être alors définie comme la somme des lieux terrestres permettant la perpétuation des processus de diversification tant biologiques que culturels par « spéciation géographique», selon un temps naturel ou historique propre à ces lieux et processus. La protection des spécificités qui fondent la singularité de chaque lieu composant cette géodiversité est la condition de l'habitabilité à long terme de la Terre par tous les êtres vivants, dont l'espèce humaine. Une géographie servant à « déchiffrer» la Terre plutôt qu'à continuer de la « défricher» permettrait de recenser le «patrimoine d'habitabilité» de la planète et de proposer des solutions, au cas par cas et en liaison avec d'autres sciences de l'homme et de la nature, pour préserver cette géodiversité.
Nous sommes arrivés à un stade de l'histoire où la dichotomie nature/humanité a été abolie. Il n'y a plus de « nature» mais une seule Terre, sur laquelle l'humanité a le pouvoir de faire disparaître, sinon toute forme de vie, au moins la plus grande partie des espèces, dont elle-même. Il ne s'agit donc plus de « conserver la nature», mais de sauvegarder la biosphère, et nous avec, en commençant sans doute par certains lieux qualifiés de « Patrimoine de l'humanité ». Cela implique d'abord de s'opposer à tout ce qui tend à diminuer la singularité du lieu à protéger, et donc à en réduire l'accessibilité.
Les recensions de l' Académie des sciences d'outre-mer sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrite.
Basé(e) sur une œuvre à www.academieoutremer.fr.