


| Auteur | Patrick Le Minor ; [préface du général Yves de Sesmaisons] |
| Editeur | Indo éditions |
| Date | 2018 |
| Pages | 303 |
| Sujets | Guerre d'Indochine (1946-1954) Récits personnels |
| Cote | 62.145 |
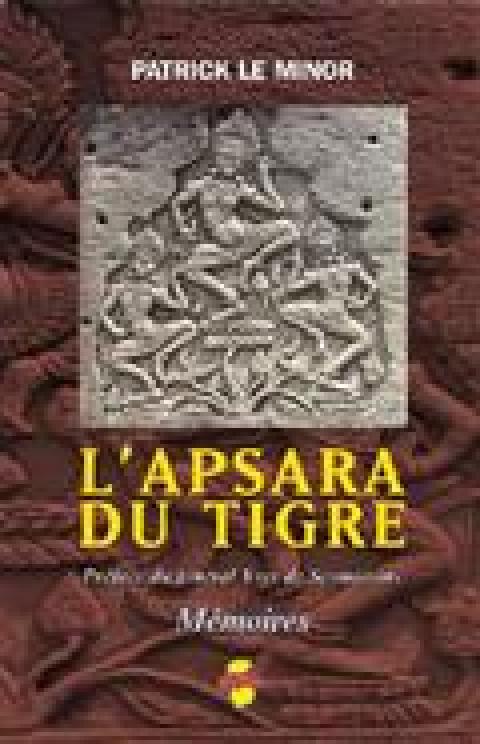
Il s’agit ici d’un ouvrage déjà publié sous le même titre en 2006 chez un autre éditeur, sans doute apparenté à l’éditeur d’aujourd’hui. Il est complété par un dossier de photos, d’illustrations diverses et par une préface du général Yves de Sesmaisons, qui fut président d’honneur de l’association nationale des anciens prisonniers déportés internés d’Indochine (ANAPI, regroupant aussi les prisonniers, otages ou déportés de la Seconde Guerre mondiale en Extrême-Orient, de la guerre de Corée). Il fut également prisonnier du Vietminh en 1951 et 1952.
Dans la préface, Yves de Sesmaisons, descendant d’une longue lignée de chevaliers bretons, s’émeut des temps passés et de la similitude, à l’âge et aux circonstances près, des mésaventures des enfants Le Minor et des siennes propres ainsi que de beaucoup d’autres prisonniers ou otages du Vietminh. Il explique avoir été frappé, lui le militaire, par un milieu de planteurs qu’il ne connaissait pas. Il s’émerveille du style de l’auteur, aux « accents chatoyants et aux images saisissantes », qui sait bien rappeler les accents de Kipling, les moussons de Conrad…Il admire « la brusque éclosion de la personnalité » du Philippe prête-nom. « Et soudain, aveuglante nous apparaît l’évidence des maléfices de l’apsara qui lança l’un contre l’autre nos deux peuples autrefois amis ».
L’auteur lui-même est trésorier de l’ANAPI, ce qui permet sans risque de supposer que son « récit » est en partie inspiré d’une expérience personnelle. De plus, une photo (voir p. 293) prise dans un camp du Vietminh au Cambodge montre l’auteur et sa sœur Françoise, âgés de 11 et 7 ans, capturés en août 1950 dans la plantation de caoutchouc de leurs parents, puis libérés, en mars 1951. Leur capture fit l’objet de la Une du France-Soir des 28 et 29 janvier 1951 (voir page 296). Leurs prête-noms dans le récit, ici baptisé « Mémoires », sont Philippe et Béatrice.
De fait, les enfants enlevés ne furent pas maltraités, on trouve même, pages 280 et 295, la traduction et la photo de l’acte de restitution aux parents Le Minor, signée par « le commandant de l’armée de Kompon Cham ». Mais l’auteur qualifie de « principe manichéen de guerre et de paix » cet « ordre de libération ».
Quel est le sens du titre ? Pour « Apsara », il suffit de consulter les bons dictionnaires pour apprendre, si on l’avait oublié, que les apsaras, dans le monde hindouiste, sont des nymphes, maléfiques pour ceux qui les ignorent, bénéfiques pour ceux qui les acceptent, voire les épousent. Ou, par extension, leurs représentations sur statues, bas-reliefs ou papier, comme notamment à Angkor, puisque Philippe et Béatrice furent enlevés et internés par le vietminh au Cambodge.
Pour « le Tigre », ce fut le surnom d’Absadum, le chasseur du tigre Top, devenu mangeur d’homme. Les villageois, après qu’il eût tué ce tigre, le baptisèrent de ce même nom. Ces villageois reconnaissants de sa chasse victorieuse lui firent cadeau d’une « apsara sculptée dans un croc de Top ». Ce Tigre mourut fauché par les balles dans une embuscade française.
Dans son avant-propos, l’auteur rappelle ce que furent les Issaraks (ceux supposés avoir enlevé les deux enfants), dont l’un des chefs emblématiques fut le Tigre cité plus haut. Ils devinrent, pour certains d’entre eux, les proches prédécesseurs des Khmer rouges, ceux de Pol Pot.
Mais le tigre est également un signe emblématique de l’astrologie chinoise. C’est sous ce signe que naquit Philippe Morin, le père supposé du prête-nom, Philippe. Lequel père se réfugia en France, sous la pression brutale des occupants japonais, et vécut avec sa famille dans un lieu situé près de Nantes, ce jusqu’à la fin de la guerre en Europe. Puis il reçut mission de « reprise en main des plantations de caoutchouc d’Indochine »,
L’auteur a tiré pendant plus de vingt ans « un épais voile d’oubli sur l’Indochine ». Ensuite, il a voulu exorciser les fantômes et écrire non pas un roman, pas plus une chronique, mais mêler à « des personnages et des faits réels, quelques éléments de fiction ». Donc pas de hasard dans cet épais récit mais un « fruit de la vérité ».
Le ton est donné : il y aura bien sûr dans l’ouvrage du comportement brutal des occupants japonais, des évocations de la dureté et de la cruauté des camps d’internement vietminh, mais ceci resitué dans un plus vaste ensemble, les paysages et la culture cambodgiens.
On se permettra ici une remarque plus qu’éditoriale. Pourquoi l’auteur ne parle-t-il pas en son nom propre et utilise-t-il la fiction du « récit » et des prête-noms ? Outre le fait que l’on se pose parfois la question de la réalité de certains personnages, dont le Tigre, cela rend difficile sa lecture au lecteur d’aujourd’hui qui peut être peu familier des drames indochinois des années 1940 puis 1950 jusqu’à Diên Biên Phu. Mais le lecteur qui, à titre personnel, enfant ou jeune adolescent, directement ou par parenté proche, a toutes les raisons de ne rien avoir oublié de cette époque, cet ouvrage parlera et appellera bien des commentaires.
Dans le premier de dix-huit chapitres, l’auteur conduit d’abord, pour un court transit, son prête-nom à Sidney où il acquiert presque par hasard une apsara cambodgienne soi-disant apportée par un boat-people arrivé du Cambodge, d’après les dires du vendeur. Philippe ayant insisté pour connaître l’origine de cet objet, s’entend répondre qu’il avait appartenu à un certain Sar Absadum avant d’être récupéré par un officier français après la mort dudit Absadum. De fait, Philippe allait vers Narita…, titre de ce premier chapitre.
Les chapitres suivants nous mènent en divers endroits, Mékong ou grand camp du maquis Viêt. Ou vers divers personnages, tel Phan Vo Duc, ancien communiste indochinois, issu de la classe mandarinale, chargé en 1949 d’endoctriner les Issarak cambodgiens.
L’on comprend alors pourquoi l’auteur a choisi la chronique ou le récit, et des prête-noms. Cela lui permet des digressions intéressantes sur l’histoire de la péninsule indochinoise ou les partis nationalistes et futurs rebelles armés. Sans pour autant faire directement œuvre d’historien érudit ou de chercheur. Et, pour le prête-nom, permettre de le faire raisonner comme sans doute il ne put le faire personnellement vu son jeune âge.
Il reprend cependant ses droits d’auteur dans son avant-propos et dans son épilogue. Ce dernier affirme, dans une note de bas de page, que sur « les 45.000 prisonniers des camps Vietminh, 9.000 seulement revinrent. À l’exception des exterminations, cette proportion de décès est supérieure aux camps de concentration nazi ». Il met en cause le rôle du PCF et de ses émissaires auprès des prisonniers pour les endoctriner.
Pour qui a eu, comme l’auteur de la présente note de lecture, des raisons personnelles de bien se rappeler l’avant et l’après-guerre en Indochine, l’après Diên Biên Phu, la lecture de l’ouvrage appelle peu de critique factuelle. Que le Vietminh ait été d’une particulière cruauté pour ses prisonniers, voire certaines populations montagnardes ou traditionnelles n’est pas discutable. Que certains Issarak futurs Khmer rouges les aient éventuellement dépassés ne l’est pas moins.
Que les Japonais aient été cruels ne l’est pas moins non plus. Fait plus que divers qui ne figure pas dans l’ouvrage, un administrateur français au Tonkin, comme on disait à l’époque, fut attaché au poteau d’exécution face auquel un autre poteau fut destiné à son fils encore jeune adolescent. Suivirent toutes les deux heures des simulacres d’exécution, entrecoupés de flagellations ; après une journée et une nuit le père fut effectivement exécuté sous les yeux du fils semi agonisant avant d’être détaché et chassé dans la brousse. Autant dire, pour ceux qui connaissaient l’histoire, qu’il était compréhensible, deux décennies plus tard, que ce fils devenu ambassadeur de France dans un pays africain fût nipponophobe au point de refuser tout contact officiel ou privé avec ses homologues japonais.
Il est tout aussi exact que les témoignages de quelques collaborateurs du rédacteur de la présente note de lecture, prisonniers après Diên Biên Phu, aient traduits une solide haine pour les camps vietminh, leurs geôliers et quelques communistes français venus les « rééduquer ».
Mais il est également exact que, lors d’une opération au Nord-Vietnam, les documents saisis sur des prisonniers vietminh – le Vietminh était, s’il est possible, plus archiviste que les archivistes occidentaux – disaient que, pour une fois, « les Français se conduisaient bien, n’exécutaient pas sommairement, rendant notre contrôle sur les notables villageois quasiment impossible ». Il est tout aussi exact qu’un officier supérieur français, en 1950 ou 1951, fut blâmé par ses pairs et soumis à de fortes pressions de sa hiérarchie pour avoir sanctionné au maximum réglementaire un adjudant coupable d’avoir gravement estropié – euphémisme – un prisonnier viet qu’il interrogeait de façon, disons musclée.
Une dernière considération : le Vietminh fut cruel pour ses adversaires, Français ou Vietnamiens. Il ne faut pas oublier qu’il fut également cruel pour les siens : comme le disaient certains officiers français à l’époque, « si les pertes en vies humaines dans une opération dépassent les 10 %, on l’arrête parce qu’elle est mal conçue. Mais les Viets ne jouent pas ce jeu, ils continuent à se battre même si leurs pertes dépassent de beaucoup ce pourcentage, voire jusqu’à 80 % ».
On rappellera aussi la fuite éperdue de quelques dizaines de milliers de Nord-Vietnamiens catholiques, dont plusieurs centaines périrent noyés sur des bancs de sable, en baie du Tonkin, à moins d’un mille de navires de guerre français qui n’intervinrent pas pour les sauver, car c’eût été rompre les accords de Genève, ce malgré les objurgations de quelques officiers français restés au Nord-Vietnam pour assurer la transition avec le Vietminh vainqueur. N’était-ce pas, de la part des marins français, un refus de sauver des personnes en péril, crime dans bien des législations dont la nôtre.
Ces considérations hors propos n’enlèvent rien à l’intérêt de l’ouvrage. Mais, comme on l’aura compris, il suppose une bonne mémoire de l’époque.
Il est suivi d’une impressionnante bibliographie en partie illustrée des Indo Éditions, dont il ressort que le « Mémoires » du titre vise une collection desdites éditions. Lesquelles sont essentiellement consacrées à l’Indochine.
Ce qui pose une question : s’agit-il d’une forme de nostalgie ou d’un objectif de mémoire à propos de ce qui fut en son temps le joyau des colonies françaises ?
Basé(e) sur une oeuvre à www.academieoutremer.fr.