


| Auteur | Christian Huetz de Lemps |
| Editeur | Vendémiaire |
| Date | 2017 |
| Pages | 428 |
| Sujets | Hawaii (États-Unis) Histoire |
| Cote | 61.596 |
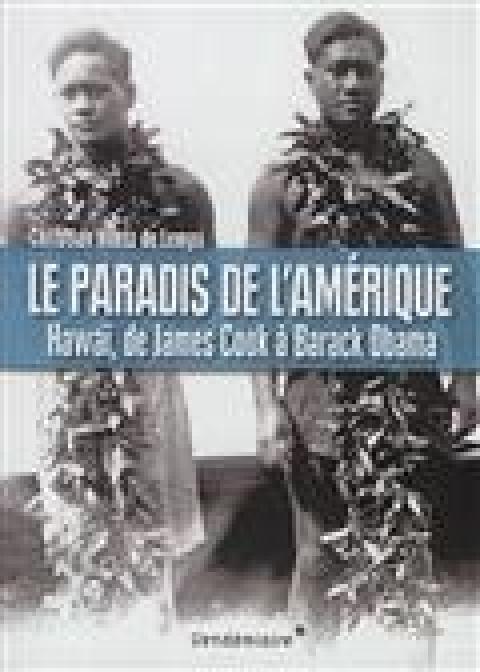
L’auteur nous a malheureusement quittés il y a quelques semaines, cet ouvrage est le dernier paru de son vivant.
On rappellera qu’il avait apporté sa contribution à notre ouvrage collectif, « Présences françaises Outre-mer », de 2012, avec un chapitre intitulé « La présence de la France et des Français dans les îles du Pacifique « au temps des colonies », 1840-1860 ».
Spécialiste, entre autres, de la géographie commerciale (plusieurs publications à propos du Bordeaux commerçant d’autrefois), insulaire (plus spécialement dans le Pacifique), il traite ici d’un « paradis » qu’il situe entre deux noms, celui du découvreur et celui qui y est bien plus récemment né. Initialement, l’archipel fut désigné par ses découvreurs comme « les îles Sandwich », du nom du commanditaire de l’expédition de Cook.
Paradoxe géographique et humain que ce lointain archipel, le plus isolé au monde, le presque dernier découvert par les Européens et pourtant aujourd’hui nœud de bien des transits, touristiques, portuaires et aéroportuaires, « melting pot » de bien des « races » (au sens américain du terme), où la population polynésienne d’origine ne représente plus, y compris ses métis, qu’un habitant sur cinq, les autres allant des « caucasiens » (environ un quart) aux Japonais, aux Chinois, aux Philippins, à différents métis d’autres « races » (dont Barack Obama qui le fut tout enfant), pour près ici encore d’un habitant sur cinq.
Le plus isolé au monde : une carte en fin de volume le montre bien : à plus de 4000 km de San Francisco, 3800 de Tahiti, 6400 du Japon, plus de 8000 d’Australie et de
Nouvelle-Zélande.
L’un des territoires où la colonisation et la post-colonisation ont suivi des chemins peu habituels, depuis les premiers contacts entre population autochtone et les différentes catégories de nouveaux-venus. Territoire qui connut des tentatives de modernisation par les royautés locales, aidées de divers Européens ou Américains qu’elles recrutaient, puis qui fut annexé par les USA en 1898, après une première tentative de 1893, et devint en 1959 le cinquantième État américain. Ce, en raison du positionnement de l’archipel dont le contrôle était devenu indispensable pour asseoir leur position dans le Pacifique.
En huit chapitres, l’auteur retrace les différentes étapes de l’histoire de l’archipel.
Lors de la première rencontre entre les Hawaïens et les Européens de James Cook, en 1778, les premiers ignoraient l’écriture, la roue, les métaux, les animaux de trait. Si l’archéologie permet de situer la première occupation, depuis au moins un millénaire, par des Polynésiens apparentés culturellement et linguistiquement aux Marquisiens et autres Tahitiens, rien ne permet de reconstituer l’histoire de cette longue période, sinon des traditions invérifiables.
Comme dans bien des cas, le déclin démographique relativement rapide de cette population autochtone s’explique au premier chef par l’absence d’immunité acquise à un certain nombre de maladies importées par les nouveaux-venus.
Selon une approche très classique pour un historien, l’auteur procède par des étapes dans le temps, résumées par leurs titres : le « Hawaï d’avant », celui de l’accession à la « civilisation » (le mot est mis dans le texte entre guillemets, et ne peut donc prêter à interprétation plus ou moins malveillante), le « grand basculement » (celui de la déchéance de la royauté et d’un traité à double tranchant), l’époque du « sucre roi », celui de la période proprement coloniale, celui de Pearl Harbor et enfin la liquidation de l’héritage colonial.
Cette périodisation est convaincante, elle pourrait être discutée à la marge mais sans pour autant pouvoir la contester sur le fond. L’auteur précise d’ailleurs qu’il l’a empruntée à des historiens américains, à quelques ajustements près.
Il est frappant de voir qu’avant même toute mainmise coloniale, les Hawaïens de souche, dès les premiers contacts avec les Européens puis les Américains, marchent vers la « modernité » : un roitelet local, avec l’appui de marins étrangers dont il a su « s’assurer la fidélité », Kamahameha que l’on dira 1er, prend le contrôle de l’ensemble de l’archipel et sait «conjuguer la civilisation traditionnelle avec les apports de plus en plus déstabilisants des multiples navires de passage ». Ce phénomène d’accession à une modernité autochtone n’est pas exceptionnel, bien des sociétés confrontées à l’irruption de nouveaux-venus, de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe ont tenté d’être « modernes » sans pour autant devenir occidentales, autrement dit de trouver en elles-mêmes les ressources sociales, religieuses, intellectuelles nécessaires à ces adaptations. Sans doute la lecture de l’introduction et du premier chapitre apprendra-t-il au lecteur français un pan d’histoire ethnologique qu’il ignore ou connaît mal.
Mais comme ce fut ailleurs souvent le cas, il est arrivé une période où ces modernisations autochtones ne purent s’opposer à une mainmise étrangère plus coloniale. Néanmoins, ce qui caractérise aux yeux de l’auteur une des spécificités du cas hawaïen est la naissance précoce du « melting pot » évoqué plus haut et la cohabitation plutôt paisible des « races », à tel point qu’une forte minorité japonaise, un demi-siècle plus tard, après Pearl-Harbor, ne fut jamais inquiétée, contrairement aux Japonais massivement internés sur le continent américain.
La monarchie, affaiblie, devenue en 1887 à la suite d’un véritable coup d’État, relativement pacifique, « constitutionnelle », plus ou moins dans l’esprit des contestataires « à l’anglaise », se survivra quelques années encore avec une reine, Lydia Kamakaeha Paki, trop intransigeante pour conserver son trône. Mais elle aura encore un successeur, Liliuokalani. Lequel ne put résister à une ligue plus ou moins officielle, créée en 1892, « pour l’annexion », par les USA bien entendu. On sera surpris au passage d’apprendre que les monarchistes se reconnaissaient volontiers dans la devise « Liberté, égalité, fraternité ».
Il est clair que cette évolution économique, politique, était due en grande partie à un renversement des poids respectifs des différentes « races » et du développement d’un capitalisme de plantations de canne à sucre. L’auteur nous présente à ce propos quelques personnalités originales, un Claus Sprekels par exemple, symbole et chef de file d’une «haolisation », les « haoles » étant de « race » blanche, planteurs à gros capitaux. Car en vertu d’un « traité de réciprocité » de 1876, le sucre hawaïen entrait librement aux USA.
On s’est un peu attardé sur la première moitié de l’ouvrage, cela semble suffisant pour inciter le lecteur à lire attentivement cet ouvrage d’histoire, chronique vivante. Mais aussi, pour le lecteur français peut-être bon connaisseur de son histoire coloniale, l’exemple moins bien connu de l’ouverture, à l’occasion de l’une des toutes dernières « grandes découvertes », d’un petit univers qui dans un premier temps se modernisera à sa façon, puis annexé sans effusion de sang, encore moins de conquête militaire, connaîtra une économie de type colonial pour enfin devenir un cinquantième État, peut-être le plus multiracial, des USA, éloignés de plusieurs milliers de kilomètres du reste du pays.
Restent deux questions.
La première, pourquoi le titre édénique de l’ouvrage ? Pour l’auteur, il est clair qu’outre un niveau de vie parmi les meilleurs du pays, Hawaï représente la concrétisation d’un certain rêve américain : multiracialité assumée, tolérances mutuelles des « races », au point que des critiques sur ce modèle idéalisé sont épisodiquement émises dans d’autres États par des citoyens moins ouverts. Même s’il n’en est pas familier, le lecteur accordera, avec quelques nuances, son entière confiance à cette approche et pourra réfléchir à d’autres colonisations et décolonisations plus riches en drames et en occasions perdues.
Seconde question : pourquoi et comment un géographe peut-il se transformer en historien chroniqueur ? La réponse se trouve dans l’une des toutes premières pages, celle des « remerciement ». L’auteur tout juste agrégé, il y aura bientôt soixante ans, a bénéficié d’une bourse d’un an pour étudier à l’université d’Honolulu. Il a gardé un riche souvenir « de la gentillesse de l’accueil, démonstration brillante de l’esprit Aloha souvent évoqué pour les îles ».
Que conclure, sinon d’inviter le lecteur à lire attentivement cet ouvrage qui est plus de témoignage qu’un ouvrage savant (peu de bibliographie, quelques photos, annexes restreintes à l’essentiel) ?
Les recensions de l'Académie des sciences d'outre-mer sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrit.
Basé(e) sur une oeuvre à www.academieoutremer.fr.