


| Auteur | Guillaume Lachenal |
| Editeur | Éditions du Seuil |
| Date | 2017 |
| Pages | 353 |
| Sujets | Médecins militaires Cameroun 1900-1945 Biographies Médecins militaires Wallis et Futuna 1900-1945 Biographies Colonisation Cameroun 1919-1960 Cameroun Politique et gouvernement Jusqu'à 1960 |
| Cote | 61.388 |
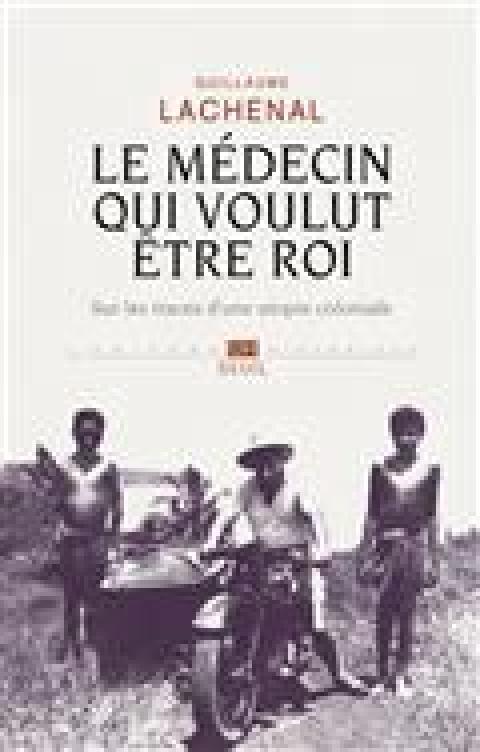
Le clin d’œil à la nouvelle de Kipling est évident et tous ceux qui l’ont lue adolescents ne peuvent être qu’alléchés par ce titre, car ils furent aussi sans doute lecteurs fébriles de Kim, l’orphelin de Lahore, perché à califourchon sur le canon Zam Zammah, « l’ami de tout au monde », un monde colonial, bigarré et pittoresque, parti dans une quête initiatique avec un lama qui prétendait mendier en silence, or « qui mendie en silence meurt en silence ».
Revenons aux choses sérieuses de l’adulte. Quoique…la seconde partie du titre parle bien d’ « utopie », toujours domaine du rêve, si ce n’est du cauchemar. Mais nous avons à faire à un auteur, historien patenté, sa bibliographie le prouve. Au-delà de l’utopie, c’est de deux parcours documentés dont il s’agit, celui du personnage principal, le médecin militaire Jean Joseph David, pas forcément bien connu du grand public. Et celui de l’auteur, sur ses traces.
On ne se souvient sans doute pas très bien, même si l’on a une connaissance raisonnable de l’histoire de la période coloniale en Afrique, de ce qu’en 1939, par décision du haut-commissaire de la République au Cameroun, le médecin commandant David se vit confier, outre la gestion d’un centre hospitalier créé au début du XXe siècle par les Allemands à Abong-Mbang, région du Haut-Nyong, 200 km à l’est de Yaoundé, la responsabilité administrative de la région, succédant ainsi à un administrateur des colonies. Il y fut assisté de cinq autres médecins militaires coloniaux, eux-mêmes devenus chefs de subdivision.
L’auteur, Guillaume Lachenal, s’est fait, entre autres, une spécialité de l’histoire de la recherche biomédicale en Afrique, coloniale ou plus récente (VIH notamment). Tombant dans sa recherche sur ce que l’on baptisa à l’époque « l’expérience du Haut-Nyong », il nous livre ici une enquête vivante, chronique de ses démarches pour retrouver des témoins, des chercheurs africains qui procédaient « à l’ancienne », accumulant les archives autrement et sans doute perdues.
Mais aussi, portant un regard aigu sur l’ « utopie », locale et plus générale : dès son introduction, il rappelle les errements d’Alexis Carrel, l’un des premiers prix Nobel d’avant la première guerre mondiale et partisan déclaré d’un eugénisme sans pitié « humaniste » ou « contraire à la lutte pour la vie » que permet la sélection naturelle d’où jaillissent les mieux adaptés, partant les meilleurs. L’une des dernières rues à porter son nom, dans le monde, ne fut débaptisée, à Paris, qu’à l’aube du XXIe siècle.
L’auteur rappelle les « utopies » plus générales des XIXe etXXe siècles auxquelles on peut rattacher l’utopie particulière dont David et ses cinq médecins subordonnés furent les acteurs. Utopies qui prétendaient à un monde plus ou moins dirigé par une médecine généreuse mais, comme dans bien des cas, tyrannique, pour le bien des mortels. D’ailleurs, une citation en début d’ouvrage, de Rudolf Virchow, en 1848, ne rappelle-t-elle pas cet horizon « La médecine est une science sociale, et la politique n’est rien d’autre que de la médecine à grande échelle » ?
Cependant, ce grand médecin avait aussi écrit : « Le médecin est l'avocat naturel du pauvre. ». Progressiste, il affirmait le droit de tous à la santé et préfigurait en théorie un prochain « État-Providence ». Lequel, fort répandu aujourd’hui, permet bien au-delà de la charité, d’assurer un minimum de solidarité et partant de redistribution des richesses, notamment dans le domaine de la santé.
Guillaume Lachenal ne rappelle pas, ce n’est pas son propos ici, que jusque dans les années 1940, des démocraties confirmées (des pays scandinaves, les USA notamment) pratiquèrent un eugénisme sévère et parfois assassin, sans pour autant tomber dans l’abomination nazie et ses millions de victimes. Ce qui pourrait signifier que les excès et les préjugés d’une certaine médecine « politique » n’étaient pas propres aux pays colonisés mais répondaient à une utopie plus générale.
Mais, dans ces pays colonisés, ils prenaient une allure particulière, alors que cette colonisation avait à faire à des populations non seulement victimes d’endémies tropicales sévères (notamment la trypanosomiase, la fièvre jaune, la variole et la lèpre, la syphilis, le pian en Afrique) mais encore supposées incapables de se prendre en charge, d’où la mission salvatrice et humaniste de la lutte médicale. En outre, pris dans de nombreuses contradictions, les médecins coloniaux partageaient les préjugés de leur époque à l’égard de ces populations, mineures, taillables et corvéables à merci. Ils subissaient les incohérences de l’économie coloniale, les besoins de main-d’œuvre de plantation et de chantiers publics (routes et autres infrastructures) mais aussi la nécessité de protéger, fût-ce de manière autoritaire, les malades, au détriment des besoins des colons et de l’administration. Et sans tenir grand compte des structures socio-économiques des populations dont ils voulaient assurer la bonne santé.
Tout au long d’un ouvrage qui relève pour l’essentiel de la catégorie du « carnet de voyage » ou du « journal de bord », l’auteur relate un parcours d’enquête, une plongée dans des mémoires encore vives, des sortes d’appels à témoin, des archives studieuses amoncelées par quelques enquêteurs camerounais, des réflexions d’ordre général à propos de chroniques au jour le jour.
Un tel livre, rapport d’enquête, journal de bord ou carnet de voyage, est impossible à résumer. Prenons le parti de l’interpréter. Et d’en faire un récit à multiples personnages.
* *
*
Le tout premier d’entre eux, « le médecin qui voulut être roi », nous est connu à la fois par les recherches de l’auteur, auprès de sa famille, peu diserte à son sujet, à travers quelques-uns de ses rapports ou ceux de l’administration, pour autant qu’ils aient été conservés et soient encore accessibles. Ces derniers sont souvent louangeurs mais n’expliquent pas forcément les ressorts du personnage. Ni pourquoi, apparemment promis à franchir tous les grades, il termina sa carrière à celui de médecin colonel. Selon les souvenirs que les uns et les autres, colonisés ou européens, ont gardé, l’image donnée va du péjoratif à l’élogieux, voire pour ce qui concerne les colonisés ou leurs descendants, à la révérence à « l’africaine », celle qui tait les réserves.
Certainement autoritaire, convaincu de sa mission, aimant le contact et le dévouement à ses malades, il ne semble pas avoir jamais explicité son éventuelle « doctrine », sinon à travers son action et quelques rares extraits de rapports. Mais depuis une affectation de quelques années, avant-guerre, à Wallis-et-Futuna, où il fut baptisé par les populations locales « le roi David », jusqu’à la fin de sa vie, dans une modeste position de visiteur médical dans l’Hexagone, Guillaume Lachenal, parti sur ses traces, admet des erreurs dans de précédents écrits, depuis corrigées. Il a notamment longtemps cru que son personnage était enterré à Abong-Mbang.
En bref, il s’agit, à Wallis, d’une sorte de répétition de ce qui se passera ensuite à Abong-Mbang : succédant à un médecin « exfiltré » par l’administration pour avoir trop pris parti dans les querelles princières locales, il conclut rapidement à « la paresse des indigènes » pour expliquer la chute de la production de coprah et imposer – ou tenter d’imposer – auxdits indigènes des lopins de plantation de ricin. Et ainsi permettre d’améliorer la collecte de l’impôt (avec en corollaire sa baisse au profit du contribuable).
Déjà fort autoritaire : son image est celle du « side-car et du fouet », d’une « période dictatoriale » mais aussi et plus sereinement du « ballon de foot », contesté à mots à peine prudents par les missionnaires, il se mêle d’état-civil en sommant indigènes et missions chrétiennes d’avoir à tout déclarer chez lui. Ce, ignorant l’administration à vrai dire un peu lointaine, pourtant admirative, au moins apparemment. Mais l’enquête menée par l’auteur pour cette première vie de « roi » ou d’« empereur » pâtit des défauts de mémoire des enquêtés qui, à des décennies de distance, peuvent bien avoir confondu les époques.
Dans la documentation rassemblée par un autre personnage, Wang Sonné, sur lequel nous reviendrons, figure le compte-rendu d’un entretien de 1992 dont l’un des passages est le suivant : « Wang Sonné : quelle était sa personnalité ? – Joseph Dobo : un Monsieur très autoritaire ! On l’appelait « Empereur » ! « Empereur du Haut-Nyong ! Très autoritaire contre tout le monde, contre les Noirs, les Blancs, les fonctionnaires, les administrateurs ».
Ce document est à l’origine de l’intérêt récent de Guillaume Lachenal pour ce premier personnage, le principal, sur lequel il porte finalement un jugement critique plutôt sévère. D’où son enquête dont il est ici rendu compte.
Car pour l’essentiel, il s’agissait, pour celui qui voulait être roi et ses adjoints, d’« apprendre à vivre aux indigènes et réorganiser leur monde : réinventer sur des bases saines une société nouvelle ».
* *
*
Un second personnage : à la fois une région, une ou des institutions ou installations médicales, une histoire qui remonte au début du XXe siècle, le lieu de l’utopie coloniale (parmi bien d’autres), le royaume de David.
« Territoire vitrine de la médecine coloniale : une terre d’épidémies et de sauveurs, scrutée par la propagande impériale, où s’est écrit un récit de rédemption par la médecine », ce depuis l’époque allemande. D’où dès ce temps, un village hôpital aux méthodes de soin et d’hospitalisation déjà coercitives.
Cameroun, territoire sous mandat, donc objet de rapports annuels à la SDN, sous l’œil critique de l’Allemagne dès avant-guerre, qui prétendait démontrer la carence des Français. Mais territoire délibérément considéré par la France, celle d’avant-guerre et celle de la France Libre, comme élément de son Empire. Et comme tel, sommé de contribuer à la prospérité de ses populations, à celle de ses colons planteurs et commerçants, et à l’économie de guerre, bien connue par les Africains sous la dénomination plus parlante de « l’effort de guerre », période de référence pour situer l’âge des enfants recensés ou des mariages lors des futures enquêtes démographiques, mais encore période de travail forcé et de réquisitions.
Inspirée par la doctrine plus vaste de la « médecine sociale », la doctrine coloniale du bien-être pour tous s’accompagne de déplacements de populations vers des centres où règnent les médecins, souvent par la force, à tout le moins par la contrainte. Ce que l’on appellera « l’expérience du Haut-Nyong » se situe dans ce contexte des expériences de Jamot, de Schweitzer et dans une certaine mesure des instituts Pasteur coloniaux. Elles tournent presque toutes autour des maladies endémiques et, non pas accessoirement, de la constatation d’un « vide démographique » qu’il convient de combler.
On sait que l’action menée par Eugène Jamot a mal tourné pour lui, suite à des maladresses graves de certains de ses adjoints mais qu’on lui imputa. On sait également que l’expérience de Lambaréné, après une période où l’hagiographie dominait, a été reconsidérée, plus récemment, de manière significativement critique.
Il est signalé cependant que le roi David a sans doute contemplé, fin 1939, une stèle érigée à la gloire du Dr. Jamot qui « vainquit la maladie du sommeil ».
Ce n’est pas ici le lieu d’analyser ces politiques sanitaires et épidémiologiques. Mais « l’expérience du Haut-Nyong » représente l’une de leurs applications les moins connues. « L’effort de guerre » supposait la production intensive de produits nécessaires, entre autres, à la fabrication du caoutchouc. Il se situait dans un cadre du code de l’indigénat qui limitait les déplacements mais permettait le travail forcé. Outre l’obligation faite aux femmes de venir accoucher à Abong-Mbang, où elles étaient du reste bien nourries, vêtues, en un mot bien traitées.
Comme l’écrit Guillaume Lachenal, « À Madouma, on disait que c’était la lutte contre la maladie qui avait amené la mort – ce qui n’avait rien d’irrationnel d’ailleurs (les campagnes étaient parsemées d’accidents et les thérapies étaient globalement inefficaces à l’échelle individuelle). La médecine coloniale se trouvait ainsi intégrée aux formes vernaculaires de manipulation à la fois thérapeutiques et malveillantes des forces de l’invisible. ». De l’incompréhension– ou plutôt de l’interprétation - par les populations du dispositif mis en place et auquel elles ne pouvaient échapper.
L’auteur déclare n’avoir pu exploiter les archives tenues scrupuleusement par le roi David et ses subordonnés, car elles furent brûlées lors d’un récent incendie. Mais il se montre sceptique sur les résultats de « l’expérience ». En d’autres termes, le personnage, «lieu d’essai de l’utopie coloniale », s’avère être peu convaincant et n’avoir guère eu de suites au regard des objectifs contradictoires fixés au départ.
* *
*
Le troisième personnage est constitué par les informateurs, au premier rang desquels Wang Sonné, enquêteur camerounais mort en 2002, avec lequel Guillaume Lachenal avait eu plusieurs entretiens et dont les descendants avaient conservé les papiers. C’est dans cette documentation que figurent notamment des comptes rendus d’enquêtes auprès de témoins de l’époque de l’ « expérience ».
Mais aussi Mme Ateba, veuve d’un infirmier en poste autrefois dans l’hôpital d’Ayos, puis « surveillant général» de l’hôpital d’Abong-Mbang, devenu maire plus tard, qui guidera notre auteur dans son enquête. Mais encore, le chauffeur Valentin et ses commentaires. Et, pour l’aventure wallisienne, Jean-Baptiste Mulikihaamea et le père Marquet, le second soulagé de voir partir un roi insupportable. Mais aussi la rue Oudinot et sa satisfaction de « l’œuvre accomplie » traduite par des médailles et des publications élogieuses.
* *
*
Dans une troisième et dernière partie, l’auteur traite des « suites ». D’abord, pour « le roi », de Dachau (où il fut chargé de soigner les milliers de déportés mis en quarantaine pour cause de typhus) à la Côte d’Ivoire (où la nouvelle donne – fin de l’indigénat et de la coercition – vide les maternités) et à l’Indochine. David aurait alors admis des erreurs dans les appréciations à l’origine, avant et pendant la guerre, des expériences « utopistes ».
Puis, apparemment hors propos, il est traité des « émeutes de la lumière », beaucoup plus récentes puisqu’elles datent de 2007 et mettent en cause un préfet, exécuteur supposé de deux lycéens lors d’une manifestation houleuse provoquée par d’innombrables coupures d’électricité. Lequel préfet mourra plus tard dans un « accident » de voiture. Laquelle restera longtemps exposée sur les lieux, « Elle restait là, comme un bloc de passé encombrant, suspect, impossible à détruire complètement, monument moqueur à ceux qui nous gouvernent, qui nous soignent et nous tuent ».
* *
*
Ce fort intéressant « carnet de voyage » ou « journal de bord », insistons sur cette définition de l’ouvrage, car elle en justifie la lecture, est donc à lire avec le regard d’un lecteur lui-même intéressé à l’aventure. Celle des héros de Kipling (Kim, Daniel Dravot ou Peachy Carnehan), celle des « Fous d’Afrique », celle du Kurtz au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Pour peu que ce lecteur ait fréquenté les mêmes lieux un peu ou beaucoup plus tard que le « roi » mais bien avant Guillaume Lachenal, il trouvera matière à suivre celui-ci, sans barguigner.
Il y a cependant matière à discussion. L’utopie coloniale des médecins n’est que l’un des aspects de l’utopie coloniale tout court. Ou plus exactement des parures humanistes données par la plupart des nations colonisatrices à leur colonisation, ancienne en Orient et en Extrême-Orient, plus récente dans les Afriques subsahariennes. Que dans ce cadre, des pratiques autoritaires aient coexisté avec des justifications civilisatrices en général, sanitaires et éducatives notamment, cela est évident. Et ne peut être voué aux gémonies que si l’on n’admet pas un minimum de relativisme.
Que des caractères individuels, chez les médecins, les administrateurs, les planteurs, les commerçants, aient marqué leurs actes, rien d’étonnant à cela. Certes, la stèle élevée en l’honneur de Jamot, dans le Haut-Nyong, porte une appréciation discutable : il a lutté mais n’a pas forcément éradiqué…
Mais la démarche de bien des acteurs de la colonisation se soit caractérisée par une certaine forme d’idéologie altruiste même si fortement marquée par les clichés de leur temps, c’est indéniable. Et ce n’est pas forcément propre au seul phénomène colonial. Et point n’est besoin de stigmatiser celui-ci pour admettre, le temps passant, que cette forme particulière de domination n’était plus acceptable à partir d’un certain moment de l’histoire et de la géopolitique.
Sortant du carnet de voyage, on aurait pu poser des questions le débordant largement. Par exemple, comment se fait-il qu’un sous-continent qui représentait moins de 10 % de la population mondiale au tournant des années 1950, a vu depuis ses effectifs quasiment quadruplés en moins d’un demi-siècle et représentera, selon les projections moyennes, vers 2050, près du quart de cette population mondiale. Sans pour autant vider les campagnes, bien au contraire, malgré une urbanisation galopante ?
Manifestement, les explications du premier vingtième siècle données par les acteurs coloniaux étaient fondées sur des hypothèses erronées, même si elles appelaient, sur le moment, des actions d’urgence.
Mais comment se fait-il qu’encore de nos jours, bien des pays du sous-continent soient l’objet de toutes les attentions, y compris exécutives, du monde associatif et humanitaire ?
Comme on le voit, le carnet de voyage inspiré par des utopies et des utopistes des temps passés conduit à se poser des questions sur les utopies et les utopistes des temps présents qu’il ne saurait être question de traiter ici. Bornons-nous à recommander la lecture de ce rapport d’enquête plutôt décousu mais riche en interrogations informulées.
Les recensions de l'Académie des sciences d'outre-mer sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrit.
Basé(e) sur une œuvre à www.academieoutremer.fr.