


| Auteur | Andrew S. Curran ; traduction de Patrick Graille |
| Editeur | Classiques Garnier |
| Date | 2017 |
| Pages | 333 |
| Sujets | Esclavage 18e siècle Racisme 18e siècle Noirs Physiologie Recherche 18e siècle Noirs Dans la littérature Mouvement des Lumières Thèmes, motifs |
| Cote | 61.848 |
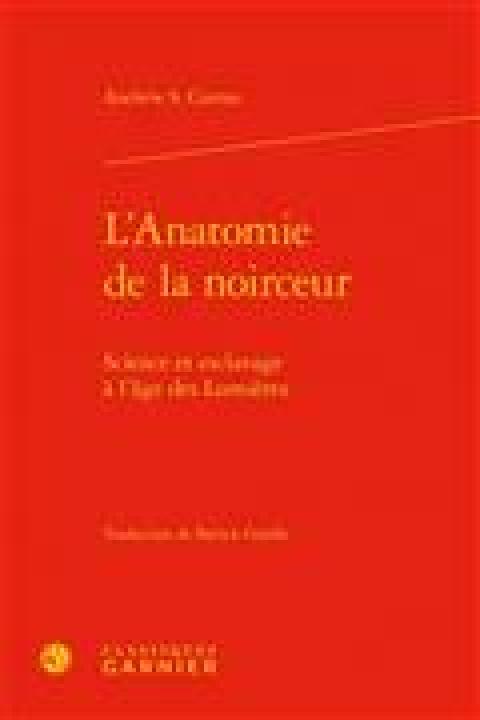
L’original anglais (qui porte, aux nuances près de la traduction, le même titre) date de 2011. L’auteur est professeur de français et d’Humanités à la Wesleyan University, spécialisé selon sa bibliographie dans le siècle des Lumières, notamment en France. Son université fut autrefois très liée à l’Église méthodiste. Elle figure parmi les premières des USA et comprend, selon certaines sources, trente pour cent d’étudiants qui se sont déclarés « de couleur ».
La bibliographie en français de cet auteur est fort restreinte, ce qui rend surprenant le fait que la traduction française de l’ouvrage, publiée par les Classiques Garnier, ait été annoncée des mois à l’avance. Cependant, lorsqu’on découvre que le traducteur, Patrick Graille, a cosigné avec l’auteur au moins un article et qu’il est lui-même spécialiste des Afriques anciennes (du XVIIIe siècle), historien des traites, nonobstant d’autres pôles d’intérêt de recherche (la marginalité et la monstruosité des corps, des esprits et des arts), l’on comprend mieux. L’on comprend d’autant mieux que ce traducteur est membre du VWPP (Vassar Wesleyan Program in Paris), programme d’échanges interuniversitaires franco-américain. Les relations entre auteur et traducteur sont donc étroites.
Wesley, théologien méthodiste, fut en son temps (la quasi-totalité du XVIIIe siècle) résolument abolitionniste, non seulement de la traite négrière mais de l’esclavage lui-même, affirmant que nul ne pouvait priver un autre être humain de sa liberté. On verra si ce parrainage a influé sur les analyses et les conclusions de l’ouvrage.
La traduction est précédée d’une préface de l’auteur, clairement destinée au lecteur français. Dès le premier paragraphe celui-ci est averti que « ce n’est pas un livre facile ». Rare modestie d’auteur ou sage incitation destinée à préparer son lecteur à une lecture attentive ? La seconde hypothèse est manifestement la bonne. Le rapprochement avec la préface en langue anglaise montre toutefois que les deux annoncent et suivent la même démarche.
Quelques mots tout d’abord sur la nature de l’ouvrage. On l’aura compris, il s’agit ici du livre érudit d’un bon connaisseur américain du siècle des Lumières en France, ainsi que des différentes sortes d’esclavage et des arguments contradictoires échangés à l’époque entre tenants de l’esclavage et leurs adversaires.
Son appareil critique, à défaut comme le dit l’auteur d’épuiser une littérature aujourd’hui monumentale sur le siècle des Lumières, les sciences modernes naissantes, les proto sociologie et anthropologie, suffira cependant à guider le lecteur désireux de juger par soi-même la pertinence de ses idées et de ses sources (nombreuses références à d’autres auteurs dans le cours du texte, notes de bas de page, bibliographie, index..). D’où l’avertissement de l’auteur à son lecteur français.
Le titre même ne saurait laisser celui-ci indifférent : il traite de « L’Anatomie de la noirceur », de « science » (celle, entre autres, encore naissante à l’époque de l’anatomie), mais d’une science qui a des répercussions sur l’esclavage. Il précise qu’on les place toutes deux sous les feux des « Lumières », de celles qui virent émerger à la fois les sciences modernes, les philosophies des Encyclopédistes et Buffon, les prémisses des futures Révolutions et des futures démocraties. Dès ce titre, le lecteur est « accroché » surtout s’il se souvient, comme tout homme ayant appris un peu d’histoire et de philosophie, que les Montesquieu, les Voltaire, les Diderot, ne dédaignaient pas de prendre leur part dans les Compagnies à commerce triangulaire. Ou que l’on peut tirer de leurs ouvrages, tels ceux des mêmes et de Rousseau, des citations suspectes d’aveuglements ou de compromissions qui dévalorisaient tout ce qui n’était pas alors de bonne civilisation européenne et de bonne couleur blanche.
La seconde partie du titre ne doit pas être ignorée : « Science et esclavage à l’âge des Lumières ». Ou savoir si et comment la science de l’époque a influencé la pratique, la perception morale et intellectuelle de l’esclavage, et dans quel sens.
L’introduction se termine dans sa version française par un court addendum de remerciements notamment à son «fidèle ami Patrick Graille, auteur de cette belle traduction », ce qui confirme l’étroitesse des relations et de la confiance mutuelle entre auteur et traducteur.Plus et mieux qu’il n’est généralement d’usage, elle résume en une trentaine de pages les quatre chapitres ou parties de l’ouvrage. Cette notation n’est pas un appel ou une suggestion au lecteur pressé de s’en contenter car il appréciera, en plus du résumé, les développements qui suivent. Esquissons-en les grandes lignes.
*
* *
Tout d’abord, retour sur la protohistoire de l’appréhension par les Européens, déjà entrés dans une certaine modernité, des peuples noirs. Joliment baptisé « Sentiers de papier, écrire l’Africain, 1450-1750 », un premier chapitre relate les récits et écrits des premiers redécouvreurs des pays noirs, les Portugais qui bien avant les autres Européens entreprirent sous l’autorité de leurs souverains de contourner l’Afrique et surtout d’y pénétrer. Afrique, restée mythique pendant des siècles, depuis l’Antiquité, mythes plus récemment reflétés par celui du prêtre Jean, celui d’une Éthiopie fantasmée. Il est rappelé que les Portugais, aux environs des années 1480, « atteignirent même le Tombouctou (Mali) ». Ils rassemblèrent des informations précises et détaillées sur les grands contours du continent et ses intérieurs. « …la mise en encre européenne de l’Afrique et des Africains noirs commençait. ».
La durée du siècle des Lumières varie selon la définition que l’on en donne et les auteurs ou manuels qui en traitent. Mais le milieu de ce siècle, 1750, y est de toute façon inclus. Ces « Sentiers de papier » conduisent donc du milieu du XVe siècle au plein siècle des Lumières et anticipent en partie sur le contenu des trois chapitres suivants.
Nombre d’auteurs sont convoqués pour expliquer, au fil de ces trois siècles, comment ils ont rassemblé puis diffusé leurs informations, éléments africanistes essentiels à la compréhension ultérieure et durable jusqu’à la période des Lumières.
Malgré la politique du secret imposé par les autorités portugaises aux voyageurs et autres cartographes, leurs témoignages finirent au milieu du XVIe siècle par être connus et publiés. Si certains préparent les futures justifications de l’esclavage et de la traite des Nègres, telle la Chronique de Guinée (1453) de l’historien Zurara, « épisodique et épique », d’autres offrent des approches plus nuancées des différents peuples, croyances et coutumes africains.
Ainsi de Ca’da Mosto, vénitien au service du prince Henri le Navigateur est chargé par ce dernier de « remplacer le vol par le commerce ». Dans ses Navigatio ad terras ignotas, il fait preuve d’une grande largeur de vue. Outre être négrier, il s’intéresse aux structures, hiérarchies sociales et politiques du royaume de Budomel. Durement agressé par des Sérères, il s’enquit auprès de prisonniers de la raison de leur hostilité et fut tout ébahi de découvrir que les Blancs et plus généralement les chrétiens avaient une réputation de cannibalisme. Ca’da Mosto et quelques autres voyageurs commerçants et non désintéressés ne transmirent cependant pas une approche méprisante de la noirceur des Nègres qui eût assimilé celle-ci à la sauvagerie et aux superstitions.
Un autre littérateur, géographe et compilateur de connaissances sur l’Afrique fut Al-Hassan ibn Mohammad al-Wazzãn plus connu du lecteur français sous le nom de Léon l’Africain, dont l’histoire est bien connue. D’une famille musulmane expulsée d’Espagne au Maroc, grand voyageur en Afrique et au Proche-Orient, capturé par des pirates siciliens (ou castillans selon certaines sources), il fut « offert en cadeau » au pape Léon X, en 1520 et croupit en prison. Pour s’en échapper, il se convertit sous le nom de son maître. Il révolutionna au milieu du XVIe siècle l’approche géographique, politique et sociale d’une Afrique qu’à l’exception de la boucle du Niger et de Tombouctou, il ne connaissait qu’à travers d’autres récits. Ceci pour l’Afrique noire, car pour l’Égypte et l’Afrique du Nord, il disposait d’informations personnelles suffisantes pour offrir à ses lecteurs une connaissance approfondie. Son attitude à l’égard des Noirs était ambivalente. Par réflexe d’ancien musulman, il se montre plutôt méprisant pour grand nombre d’entre eux mais admiratif pour ceux qui étaient en tout ou partie musulmans. C’est ainsi que la fascination pour Tombouctou des futurs explorateurs du début du XIXe siècle remonte sans doute à la description émerveillée qu’en fit en son temps Léon l’Africain.
Les Pays-Bas (pays même de l’édition européenne aux XVIIe et XVIIIe) furent à partir des années 1600 un haut lieu de rationalisation de la connaissance de l’Afrique. Même si une certaine Afrique des fantasmes anciens persistait, la majeure partie des ouvrages qui lui étaient dorénavant consacrés reposaient sur des bases plus objectives. L’auteur majeur de la période est Dapper, qui ne mit jamais les pieds hors de sa ville natale mais se livra à une compilation richement illustrée des connaissances de l’époque. Selon la nature et les pôles d’intérêt de ses sources, il fut souvent plutôt méprisant pour les peuples ou ethnies mais beaucoup plus neutre ou nuancé et parfois intéressé pour certains d’entre eux. « Simultanément attentif et dégagé », son dégagement influencera plus tard les penseurs des Lumières.
À partir des années 1650, il s’est créé aux Caraïbes une économie de plantation fondée sur une main d’œuvre servile notamment d’origine africaine. Elle modifiera le regard des Européens sur l’Afrique et les Africains noirs en créant une « Afrique caribéenne », à partir de laquelle les jugements portés sur les Noirs changent de nature. Il ne s’agit plus de regarder négativement, favorablement ou de façon neutre ou objective des peuples africains mais de les considérer comme esclaves par nature. D’autres formes d’esclavages ou assimilables à l’esclavage concernent bien des Blancs (forçats, engagés, prostituées..) mais sans pour autant que cela constitue en général leur destinée naturelle puisque leurs origines, les autorités sociales, politiques, administratives sont elles-mêmes blanches.
Les derniers écrivains notables répertoriés parmi nombre d’autres sont le dominicain Jean-Baptiste Labat et l’abbé Prévost.
Le premier fut fort influencé par un long séjour aux Caraïbes esclavagistes et imbu des préjugés correspondants (partisan du Code Noir, auteur sans état d’âme ni compassion des tortures infligées à un « sorcier »). Il publia trois œuvres consacrées à l’Afrique occidentale (il n’y avait jamais mis les pieds..), sortes de vulgarisation d’autres écrits, souvent à charge. Il y continua « à manifester un mélange de répulsion et de fascination vis-à-vis des histoires de vie qui violaient sa vision dominicaine du monde ». En fait, il reprochait aux Africains noirs leur vie et leurs croyances païennes, sources d’inhumanité.
Le second publia une Histoire générale des voyages, plus ou moins traduite d’un auteur anglais, John Green, « commandée pour diffuser une large sélection internationale de récits de voyage ». Pour ce qui concerne l’Afrique, son opinion varia avec le temps et les éditions. Il renonça aux compilations anciennes, méthodologiquement mal fondées selon lui, mais maintint un jugement selon lequel « les Noirs savaient pertinemment qu’ils étaient inférieurs aux Blancs et donc « faits pour être les serviteurs et les esclaves des blancs ».
Au bout du cheminement sur ces sentiers de papier longs de trois siècles, enfin vient Rousseau. Lequel conclut que si les autres mondes et continents sont de son temps bien connus des Européens à travers d’innombrables récits de voyage, les travaux des cartographes, il n’en est pas de même de l’Afrique au sud du Sahara ni des hommes qui l’habitent. Mais « la culture africaine ne pourrait devenir réelle connaissance qu’une fois traitée par des esprits supérieurs européens ». Il faisait du Hottentot l’homme resté hors du temps, la noblesse sauvage, supérieur en cela aux Européens.
Ces sentiers de papier constituent sans doute et paradoxalement la partie de l’ouvrage la plus intéressante en ce sens qu’elle décrit, dans la longue durée, une terra incognita et qui, en ce qui concerne l’Afrique, le restera pour l’essentiel malgré de nombreuses tentatives. Certes les cartes les plus récentes ne sont plus représentées peuplées d’animaux fantastiques, elles décrivent très approximativement l’intérieur. Mais cette terra incognita se peuple d’Africains noirs sur lesquels les jugements sont parfois nuancés mais en majorité négatifs. Outre que l’« Afrique caribéenne » y interfère largement. On verra également si et comment ces jugements ont influé sur les approches du siècle des Lumières.
*
* *
On traitera en même temps des informations, des analyses et des conclusions des trois chapitres suivants. Car les mêmes auteurs, naturalistes, philosophes, encyclopédistes y figurent. Au cours des trois brèves périodes couvertes (« Science et similitude – 1730-1750 », « Le problème de la différence – 1750-1770 », « L’histoire naturelle de l’esclavage – 1770-1802 »), on les retrouve et ils ont souvent évolué dans leurs concepts et leurs jugements. D’où le découpage en trois périodes dont deux fort courtes.
Ils se sont souvent opposés, bien sûr en général, mais en particulier sur la question de la noirceur au regard de leurs approches philosophiques, littéraires et scientifiques. Nul doute que leurs analyses et concepts en général soient fondés sur une approche révolutionnaire en son temps : rupture avec l’ordre religieux établi, les écrits et « légendes » de la Bible ; rupture avec le droit divin et la société qui en découlait ; rupture avec toutes formes de dogmes. Ont-ils pour autant rompu avec tout autre type de préjugé ? Le grand intérêt de l’ouvrage d’Andrew S. Curran est de mettre en lumière (sans jeu de mots ici) la façon dont des démarches novatrices ont pu aboutir, dans le cas de la « noirceur », à des analyses confuses et finalement suffisamment contradictoires pour dire tout, généreusement, et son contraire, une « histoire naturelle » (formule à prendre dans son sens ancien, l’ensemble des connaissances accessibles par les connaissances de l’homme) finalement méprisante pour la noirceur.
Presque tous les grands noms connus du siècle des Lumières sont ici convoqués, depuis Buffon jusqu’à Rousseau en passant par les Montesquieu, Voltaire, Diderot, d’Alembert, l’abbé Grégoire et bien d’autres moins connus du grand public.
Leurs démarches relèvent parfois de « l’humour noir » (formule utilisée par l’auteur à propos de Montesquieu), de sa contestation par Voltaire, de la finalité encyclopédiste.
Les thèmes qu’ils ont traités tournent autour du concept de l’origine commune du genre humain, « vers une monogenèse scientifique », fondement notamment des idées de Buffon, un temps contesté par Voltaire. Mais tous, y compris Rousseau, finissent par resituer les nègres soit comme une forme de dégénérescence à partir d’un modèle blanc, soit, par exemple pour Linné, comme une pathologie conduisant à bien des vices, paresse, indolence, hyper sexualité, imprévoyance, le tout gouverné par le caprice…
Le lecteur d’aujourd’hui s’amusera des analyses de dissection pratiquées sur des nègres (mais non vérifiées par les divers auteurs concernés) selon lesquelles leur cerveau serait noir ou violet, ainsi que leur sperme et d’autres parties du corps. Il s’amusera aussi des savantes discussions sur le phénomène « albinos » qui donna lieu à bien des interprétations, dont celle d’un retour à la race d’origine (le mot race commence à apparaître), aucun couple de blancs n’ayant jamais eu d’enfant noir.
*
* *
Les analyses d’Andrew S. Curran sont fouillées, elles sont souvent convaincantes. Elles appellent le lecteur généraliste à rassembler ses connaissances d’ « honnête homme ». Éventuellement à les rafraîchir. Ces analyses tendent toutes à démontrer que le siècle des Lumières et ses ténors, au-delà de ce qu’ils ont apporté de neuf dans la compréhension et les questionnements des idéaux et des connaissances de leur temps, ont sur le fond justifié une hiérarchisation des hommes, le blanc se trouvant au sommet. Ils auraient également, directement ou incidemment, justifié l’esclavage.
Certes, dans sa conclusion l’auteur n’ignore pas d’autres tares de ce siècle des Lumières pourtant « …inestimable héritage… La grande ironie, bien sûr, est que cette même période de l’histoire, sera à l’aune de cette même méthode, sévèrement jugée ». Et de rappeler le travail des enfants, la mise au ban des pauvres, la répression des hérétiques. En quelque sorte des Lumières riches en promesses mais indifférentes aux tares de leur société, pourtant dénoncées en théorie.
De tous ces maux inhérents à la société du siècle des Lumières, la traite et l’esclavage viennent cependant en tête. L’auteur se pose et pose à son lecteur « la question la plus fondamentale [qui] ne se détache parfois qu’indistinctement : comment l’esclavage a-t-il pu non seulement continuer d’exister mais s’épanouir comme jamais auparavant, durant une période humaniste et autoproclamée éclairée ? ». Pourquoi en outre a-t-il fallu attendre la fin de la période coloniale peu après le milieu du XXe siècle pour que des essais (par exemple Frantz Fanon et ses « Damnés de la terre ») ou recherches sérieuses soient entreprises sur « la servitude et l’âge des Lumières ». Car « pour paraphraser et réactualiser la formule de Bernardin de Saint-Pierre, tout se passait comme si les dix-huitiémistes s’étaient détournés, loin des réalités les plus dures et les plus dérangeantes de leurs champs d'investigations. Or en se détournant, ils détournaient l’histoire ».
On ne saurait achever cette note de lecture sans citer l’une des dernières phrases de l’ouvrage : « Ceci me conduit à un dernier mot précisant mes objectifs. Quoiqu’aussi impartial que possible, mon livre ne saurait être intellectuellement, moralement et politiquement neutre. ». Encore plus explicite, voire brutale, la dernière phrase : « L’anatomie noire au siècle des Lumières est, en somme, un miroir où se reflète l’inhumanité systématique, rationnalisée et croissante d’un système vicieux, gouverné non seulement par une petite population d’armateurs et de colons, mais par des négriers des sciences, de la finance, de la politique ».
Il est vrai que dans le corps de l’ouvrage certains jugements ou qualificatifs, peu nombreux, avaient pu surprendre le lecteur par leur ton polémique. On saura donc gré à l’auteur des dernières phrases citées ci-dessus. On lui saura gré, nonobstant son annonce finale, d’avoir exposé le résultat de ses recherches de façon le plus souvent de bonne argumentation et fondé sur une démarche disciplinaire étayée parce que solidement fondée sur une riche documentation et une bibliographie raisonnablement diversifiée.
Un autre intérêt pour le lecteur : l’ouvrage invite à des discussions intéressantes car il aborde un siècle des Lumières sous un angle inhabituel. Celui du titre, L’Anatomie de la noirceur. Et, pour peu que ce lecteur soit suffisamment âgé pour avoir pu connaître des jugements portés sur les Afriques et ses habitants noirs vers les années 1940 puis 1950, y compris chez les scientifiques de bien des disciplines, d’y retrouver certaines visions des mondes noirs, bienveillantes ou plus souvent paternalistes, parfois et pas rarement plus malveillantes, proches des jugements ambigus des grands penseurs des Lumières.
Finalement et à l’issue de la présente note de lecture, on ne craindra pas de recommander l’ouvrage au lecteur potentiel.
Reste une question à laquelle je ne saurais répondre : quel est l’apport de la tradition wesleyenne à l’ouvrage ? Sans doute qu’auteur et traducteur s’y rattachent mais sans autre filiation directe dans la démarche suivie par Andrew S. Curran.
Les recensions de l'Académie des sciences d'outre-mer sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrit.
Basé(e) sur une œuvre à www.academieoutremer.fr.