


| Auteur | Joël Michel |
| Editeur | CNRS éditions |
| Date | 2018 |
| Pages | 417 |
| Sujets | Impérialisme Europe Colonies Afrique |
| Cote | 61.968 |
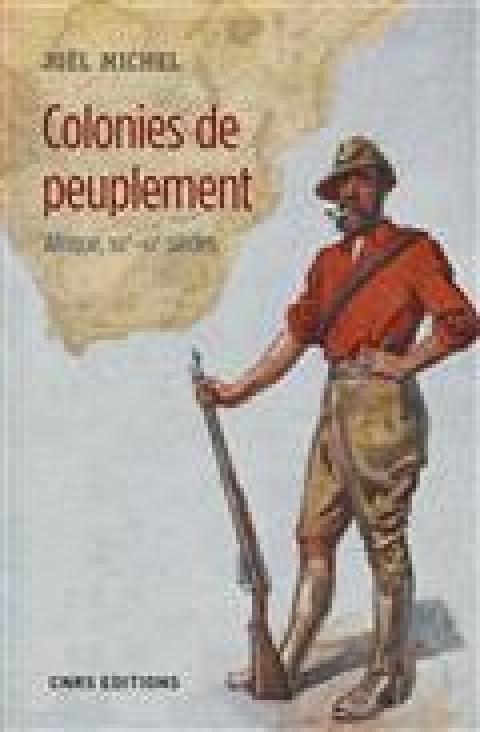
Georges Balandier nous proposait naguère une définition du phénomène colonial que la lecture du présent ouvrage est venue nous remettre heureusement en mémoire : « domination par une minorité allogène, confiscation du sol, mise en rapport de civilisations hétérogènes, recours à la répression comme seule réponse aux revendications culturelles et politiques ».
Domination par une minorité allogène : les premières colonies de l’histoire, les cités grecques d’Asie Mineure, pour prendre un exemple classique, furent bien des colonies de peuplement, même si certaines d’entre elles furent aussi des comptoirs.
Normalien, agrégé d’histoire, auteur d’ouvrages de vulgarisation (notamment sur le lynchage aux Etats-Unis, sur Condoleezza Rice et aussi sur la condition des mineurs dans le Nord de la France et dans la Ruhr), Joël Michel nous offre une étude comparée sur les colonies de peuplement en Afrique, principalement localisées, comme chacun sait, dans le nord du continent et dans ses régions australes. Mais le colonat blanc des colonies portugaises d’Angola et Mozambique et britanniques du Kenya n’est pas négligé. Les XIXe et XXe siècles se sont naturellement imposés comme cadre chronologique de cette étude.
Le plan suivi, articulé en huit chapitres, nous semble tout à fait défendable : le premier chapitre « Marginalité africaine » souligne l’aspect effectivement marginal des exodes européens vers le continent. Il faut entendre par marginalité la place très modeste des colonies d’Afrique comme lieu de destination des grandes migrations européennes du XIXe et du début du XXe siècle : de 1900 à 1940, un million de Portugais émigrent vers l’Amérique (du Nord et du sud) tandis qu’ils ne sont que 33.000 à se diriger vers l’Angola et moins encore vers le Mozambique.
La confiscation du sol, évoquée au deuxième chapitre (La Terre) est une caractéristique essentielle de la colonisation de peuplement. Mais la possession des terres ne serait que peu de chose sans bras pour les travailler et au chapitre 3, l’auteur étudie avec soin les mesures mises en œuvre pour astreindre les autochtones paupérisés à s’engager comme ouvriers agricoles sur les domaines coloniaux. (On peut toutefois rappeler que certains viticulteurs d’Oranie faisaient appel pour les vendanges à une main d’œuvre saisonnière originaire d’Espagne, aux époques où la misère régnait en Andalousie). Au chapitre IV, Joël Michel constate, pour qui l’ignorerait encore, que le fait colonial repose sur une violence. Violence coloniale qui se traduit par l’arbitraire, un statut dirimant, la politique de la chicotte. Mais c’est là presque un lieu commun. La violence est-elle un phénomène proprement colonial ? La question est posée
p. 153 et l’auteur analyse différentes formes de maltraitance et de mépris qui peuvent être assimilées à de la violence. Il va loin quand il n’hésite pas à dénoncer un type de violence dans l’introduction de l’état-civil patronymique en Algérie par une loi de 1882. Nous objecterons que même si le but poursuivi était la conscription militaire (donc l’intérêt du colonisateur), c’était là un progrès dont aucun Etat moderne n’a pu se dispenser. Et c’était un acquis pour les intéressés. Ainsi que Derrida l’a justement écrit, le nom propre est l'unique objet et l'unique possibilité de la mémoire. Et ne pas avoir de nom c’est ne pas s’appartenir.
Deux sociétés, celle des dominants et celle des dominés, qui vivent chacune dans la peur de l’autre : cette situation est clairement décrite au chapitre V, opportunément intitulé : Prospéro et Caliban. Les Blancs (ou assimilés) vivent dans la hantise de l’ensauvagement c’est-à-dire de l’adoption, volontaire ou non, des mœurs et du genre de vie des autochtones et bien sûr des mésalliances. Il existe cependant de bons sauvages. On lira p. 161 quelques lignes judicieuses sur le mythe berbère qui voulut voir dans les Kabyles les Auvergnats de l’Algérie et les parer de toutes les qualités de frugalité et d’ardeur à la tâche que l’on veut attribuer aux montagnards. Observons cependant que la « politique kabyle » a duré plus longtemps que les cinq années allant de 1880 à 1885 (une référence à la thèse d’Anissa Chillali eût été bienvenue). Ce refus de l’autre engendre un désir d’apartheid qui reste la plupart du temps à l’état inchoatif mais l’auteur s’attarde p. 183 sur le cas de l’Afrique Australe qui en constitue, en lui adjoignant la Rhodésie et la Namibie, l’exemple le plus abouti. Dans le contexte des débuts, le métissage est fortement réprouvé bien qu’il soit inévitable du fait du petit nombre de femmes blanches. On lit p. 163 : « Le métis est une erreur qu’il faut cacher ou ignorer en l’assimilant à l’un des deux groupes, celui de la mère indigène en général ». Rejetés de tous côtés (et parfois même tenus pour le rebut des deux nations) ces métis cherchent le plus souvent à s’agréger, non sans difficulté au groupe blanc. L’Afrique du sud est assez paradoxalement le seul pays qui ait reconnu l’existence légale des coloureds du Cap.
Au chapitre VI, « Lointaine Europe » l’auteur pose d’entrée de jeu une question de fond : « au cours de leur difficile implantation ces fragments d’Europe sont-ils capables de se créer une identité, de prendre leur autonomie, (par rapport aux métropoles), voire de devenir une nation ? » La réponse est bien évidemment négative et l’exemple de l’Amérique du Nord ne pouvait en aucun cas se trouver reproduit en Afrique.
Que peut recouvrir le terme de démocratie raciale qui est le titre du chapitre VII ? Autrement dit dans quelle mesure le racisme est-il compatible avec la démocratie ? La démocratie raciale est le régime qui s’applique à la vie politique de la catégorie dominante, celle qui jouit de la plénitude des droits, cives pleno jure. Le « socialisme pour les blancs » doit bénéficier aux poor whites d’Afrique du sud, aux petits blancs d’Afrique du Nord, aux Portugais pauvres des faubourgs de Luanda. On aboutit ainsi à une société sudiste caractérisée par la présence d’aventuriers hauts en couleurs dont l’abbé Lambert, élu maire d’Oran en 1934 est un très bel exemple mentionné p. 272.
Le huitième chapitre établit un constat. Modestement intitulé « l’effacement » il nous démontre que toutes les tentatives de colonisation de peuplement en Afrique étaient vouées à l’échec et ne pouvaient survivre à la décolonisation. Ces colons se trouvaient, comme il est excellemment dit p. 198, « à contre-courant de l’histoire » et s’opposaient avec un acharnement frisant l’inconscience à toute évolution, à toute promotion des autochtones, sans voir qu’ils creusaient leur tombeau. En Algérie, exemple sur lequel l’auteur revient fréquemment, les Européens ne souhaitaient pas réaliser l’Algérie française, quoi qu’ils en aient prétendu, ils voulaient maintenir l’Algérie coloniale, ce qui est tout autre chose. Il est juste de rappeler que beaucoup d’entre eux se revendiquaient comme Algériens, réservant aux autochtones les qualificatifs d’Arabes, de Kabyles ou encore d’Indigènes. Ils se targuaient d’avoir mis l’Algérie en valeur : ils en avaient surtout fait un immense vignoble, produisant un breuvage
in exportable que la France achetait au dessus des cours et qui était cause de la propagation de l’éthylisme en métropole et de graves crises dans le midi viticole.
Certains points mériteraient discussion et on peut regretter ici et là les effets d’une relecture sans doute un peu hâtive : il est fait un usage quelque peu abusif du terme de colonialisme (p. 192) pour désigner la colonisation, l’expansion coloniale. P. 178 l’architecte urbaniste des villes marocaines se nommait Henri Prost et non Probst. P. 211, l’influent sénateur d’Alger pendant l’entre-deux-guerres se nommait Jacques Duroux et non Ducroux. Qu’est-ce qu’une chambre tricamérale (p. 313) sinon un parlement à trois chambres ? En Algérie, la réforme Jonnart de 1919, certes combattue par les colons, ne fut pas une tentative de réforme. Elle passa bel et bien dans les faits, se traduisant par un allègement du régime de l’indigénat et un modeste mais réel élargissement du corps électoral indigène (p. 298). Il n’en alla pas de même du projet Blum Viollette de 1936 que les colons mirent en échec.
Au delà de ces quelques lacunes, le principal mérite de cet ouvrage est de tenter une mise en parallèle des divers types de colonisation de peuplement que l’on a pu observer sur le continent africain. La tâche était certes malaisée car il y a bien peu d’analogies entre le notable radical socialiste de Philippeville et le prédicateur réformé de Bloemfontein, entre le paysan blanc pauvre d’Angola et la riche baronne Blixen grande propriétaire terrienne du Kenya (Out of Africa). Les situations politiques étaient différentes : les Pieds noirs d’Algérie avaient une métropole qu’ils affectaient souvent de mépriser, mais ce bercail colonisateur leur offrit une position de repli dont ils surent tirer profit le moment venu, ce qui n’était pas le cas des Afrikaners.
L’appareil critique est digne de louanges. Un index des auteurs rend d’estimables services.
L’auteur a su dominer sa tâche et s’en acquitter honorablement.
Les recensions de l'Académie des sciences d'outre-mer sont mises disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrit.
Basé(e) sur une œuvre à www.academieoutremer.fr.