


| Auteur | Romain Tiquet |
| Editeur | Presses universitaires de Rennes |
| Date | 2019 |
| Pages | 282 |
| Sujets | Colonisation Sénégal 20e siècle Travail forcé Sénégal 20e siècle Travail Afrique occidentale 20e siècle |
| Cote | 62.579 |
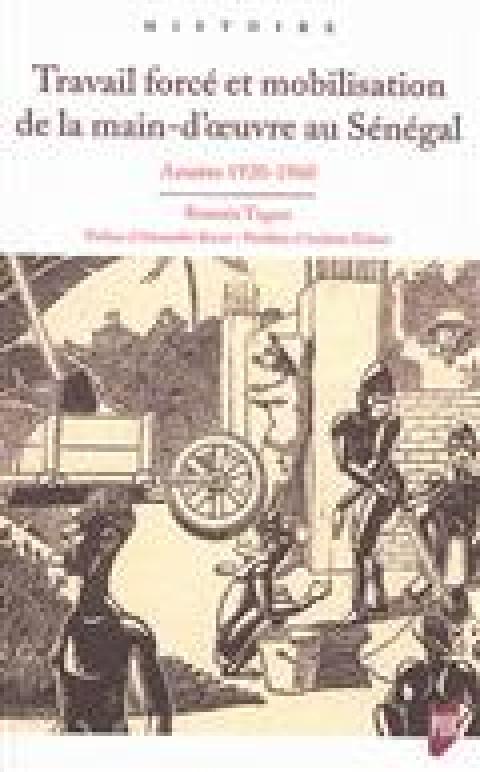
Romain Tiquet est aujourd’hui chercheur à l’université de Genève. Il s’est intéressé de longue date à l’histoire du travail forcé et aux diverses formes qu’il a revêtues dans l’univers colonial, notamment au Sénégal et plus largement dans toute l’Afrique Occidentale Française, sujet auquel il a consacré une volumineuse thèse préparée à partir de 2011 et soutenue en 2015 à l’université Humboldt de Berlin sous la direction du Pr. Alexander Keese qui a préfacé cet ouvrage issu de la thèse. Ce dernier est consacré aux quatre dernières décennies de la présence française au Sénégal. L’auteur s’explique dans l’introduction sur les raisons du choix de ce cadre chronologique. Les années 20 sont celles de l’application du plan Sarraut de mise en valeur des colonies et constituent un bon point de départ. De même, la loi Houphouët-Boigny de 1946 abolissant le travail forcé n’a pas été retenue comme point d’aboutissement : il existe diverses manières de tourner la loi et l’auteur a préféré l’inscrire dans la longue durée et poursuivre ses recherches jusqu’aux indépendances.
Les colonies n’ont de valeur qu’autant qu’elles sont dotées de voies de communication. Le Sénégal possède sans doute des voies fluviales que bien d’autres territoires pourraient lui envier. Mais il lui fallait un réseau de voies carrossables transversales. Le premier chapitre, intitulé La Route, est comme il se doit consacré aux efforts de l’administration pour doter la colonie d’un réseau routier digne de ce nom par le recours au travail prestataire et à la main d’œuvre pénale. Les conditions de vie et de travail dans les « camps pénaux » étaient infernales. Elles sont bien décrites pp.70-74. Dans une formule qui gagnerait à plus de simplicité, citée p. 75, Christopher Gray estime que : « La manifestation physique de la territorialité coloniale s’est avant tout exprimée par les travaux routiers ». En Basse Casamance, la construction de la route Tobor-Ziguinchor avait pu être menée à bien à la veille de la guerre, au prix de lourds sacrifices. En dépit des immenses efforts imposés aux populations le succès ne fut pas au rendez-vous et en 1950, le Sénégal ne comptait pas plus de 4500 km.de voies praticables par les automobiles (et encore seulement à la saison sèche) sur un réseau total de 37.000 km.
Au cours de la première moitié du vingtième siècle, le sisal représenta une part importante des exportations du Sénégal-Soudan. Le chapitre II évoque l’introduction de cet agave à la fin du XIX siècle et le développement progressif de sa production, à laquelle les sols sablonneux et pauvres en minéraux du Sénégal-Soudan se prêtaient particulièrement : la première plantation vit le jour en 1907 non loin de Kayes au Soudan. En 1932, deux compagnies CCTA et SPC, exploiteront 1500 hectares dans des régions peu peuplées. A l’appel des dirigeants qui menaçaient de fermer leurs entreprises en raison du manque de journaliers (les conditions de travail étaient fort peu attractives), l’administration dut recourir à des mesures de coercition et de migrations sous la contrainte. Les besoins en sisal s’accrurent pendant la deuxième guerre mondiale aussi bien sous Vichy que sous le régime de la France combattante qui marquèrent l’apogée de la production. A partir de 1945, la demande régressa et les sisaleraies virent leurs activités décliner. Elles furent mises en liquidation dans les années 50.
Le chapitre III nous apporte de très précieuses remarques sur cette courroie de transmission essentielle de la machine administrative coloniale que fut le commandement indigène, institution assez peu étudiée à ce jour, à notre connaissance du moins. L’auteur insiste sur le rôle de la chefferie indigène dans l’économie politique coloniale. Il eut été souhaitable, nous semble-t-il, de remonter jusqu’au décret de 1905 abolissant les souverainetés autochtones et sonnant le glas des « Etats indigènes protégés ». Il n’était plus question d’Indirect Rule comme dans les colonies britanniques et comme Faidherbe l’eût peut-être souhaité. L’auteur voit dans les chefs de canton : « la cheville ouvrière de l’administration » par le rôle capital qui est le leur dans la réquisition des travailleurs prestataires aussi bien que dans la collecte de l’impôt de capitation. Diverses circulaires émanant des gouverneurs généraux William Ponty (1909) très méfiant à l’égard des chefs, Joost Van Vollenhoven (15 août 1917), Brévié (1932) ont progressivement institutionnalisé, réglementé, pour ne pas dire fonctionnarisé la mission des chefs de canton. Celle-ci était en fait assez ambiguë,: représentants de l’autorité coloniale, subordonnés au commandant de cercle, ils devaient appliquer les directives du pouvoir, mais en certains lieux, ils étaient aussi représentants de la chefferie traditionnelle coutumière. Tel était le cas au Sine, au Saloum et dans les anciens royaumes pré-coloniaux du Haut-Fleuve mais l’exemple ne se vérifiait nullement en Basse-Casamance, région forestière tropicale humide. Un certain nombre de chefs de canton s’érigèrent en potentats locaux et commirent des abus de pouvoir ou des détournements de fonds. Il y eut quelques scandales exploités par la presse des Quatre Communes, mais la destitution d’un chef était une affaire lourde de risques et l’administration, hésitant à se déjuger, usait en général de modération. Les affaires Arfang Sanko, Bacar Ba et Lamane Dieng sont évoquées pp. 130-137.
De la lecture du quatrième chapitre, on retiendra de très intéressantes et très originales considérations sur les effets du travail forcé au Sénégal. Pour de nombreux autres territoires les études ne manquaient pas : qu’il nous suffise de faire mention des remarquables travaux de Catherine Coquery sur le Congo-Brazzaville, d’autres recherches de Jeremy Bell et Eric Allina sur l’enfer des colonies portugaises ou encore d’Anthony Asiwaju sur la condition des travailleurs dans les plantations de café de la Côte d’Ivoire et de la Haute-Volta. Comment la résistance des travailleurs requis pouvait-elle se manifester ? L’auteur voit deux réponses possibles : désobéir ou s’échapper. Le refus des prestations engendrait des migrations protestataires bien étudiées pp.145-148 tandis que les « camps pénaux » étaient le théâtre d’évasions massives ou d’émeutes parfois sanglantes. Ces attitudes « d’indiscipline, d’esquive ou de refus » sont bien analysées pp. 171-172.
L’institution du SMOTIG (service de la main d’œuvre et des travaux d’intérêt général) avait été appliquée à Madagascar par le gouverneur général Ollivier en 1926. Ce régime consistait à laisser une partie du contingent, non incorporée dans les tirailleurs, disponible pour des travaux civils. Cette « deuxième portion » restait dans ses foyers, mais était à la disposition de l’administration qui pouvait faire appel à elle autant que de besoin. Cette méthode ambiguë qui revenait à contourner la législation sur le travail forcé (ainsi que l’auteur l’observe excellemment p.180), fut bientôt appliquée au Sénégal. Cette réserve de main d’œuvre (tirailleurs La pelle ou tirailleurs lapin) dont l’étude fait l’objet du chapitre V ne semble pas avoir rendu de grands services en Afrique de l’Ouest. Presque abandonnée dans les années 30, la méthode fut réactivée sans grand succès pendant la deuxième guerre mondiale : la surveillance des chantiers était difficile et les cas de désertion étaient nombreux.
Dans un sixième et dernier chapitre l’auteur s’interroge sur la notion de « devoir du travail ». Comment mobiliser la main d’œuvre pour la construction d’une nation ? Il ouvre d’intéressantes pistes de réflexion sur la mobilisation des masses rurales et les mouvements de jeunesse ainsi que sur l’expérience sénégalaise en matière de développement coopératif.
La brillante postface, œuvre du Pr. Andreas Eckert (Université Humboldt de Berlin), se résume à une question de fond : quelle est la différence entre travail forcé et travail libre ? La question engendrera sans doute bien des débats avant de recevoir une réponse, même provisoire.
Une riche bibliographie et un inventaire des sources complètent heureusement ce bel ouvrage mais il nous sera permis de regretter l’absence d’un index.
Les recensions de l’ Académie des sciences d'outre-mer sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrite.
Basé(e) sur une œuvre à www.academieoutremer.fr.