


| Auteur | Bouda Etemad |
| Editeur | Vendémiaire |
| Date | 2019 |
| Pages | 235 |
| Sujets | Colonisation Aspect économique Colonies Europe Histoire |
| Cote | 62.671 |
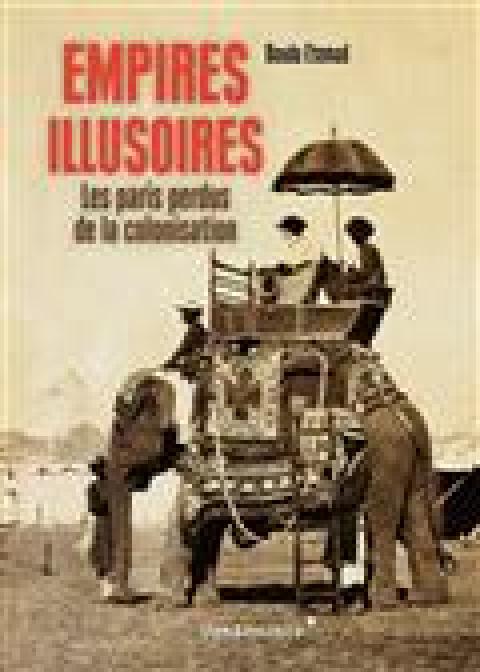
L’auteur, de nationalité suisse, genevois, de formation de base « sciences économiques et sociales » (sa thèse de 1983 portait sur « Pétrole et développement, Irak, Venezuela, Iran ») s’est spécialisé par la suite, si l’on en juge par une bibliographie nourrie, dans l’histoire de la colonisation, accessoirement dans les questions de développement.
Les titres de plusieurs de ses ouvrages, y compris celui sous revue, ne sont pas tendres pour la colonisation telle qu’elle fut menée par les Européens : « Crime et réparation, l’Occident face à son passé colonial » ; « L’héritage ambigu de la colonisation, économies, populations, sociétés » ; «De l’utilité des Empires, colonisation et prospérité de l’Europe, XVIe - XXe siècles ». La Suisse qui n’eut jamais aucun empire colonial n’est pas pour autant épargnée, « La Suisse et l’esclavage des Noirs » Car contrairement à un tabou longuement entretenu en Suisse, bien des Vaudois notamment ont contribué au financement de la traite.
Pour autant, Bouda Etmad n’est certes pas le seul historien européen à avoir souligné les erreurs et excès de la colonisation telle qu’elle fut pratiquée par les Européens. Jugements sévères, non par anachronisme moralisateur, mais par objectivité disciplinaire.
L’ouvrage sous revue traite de plusieurs cas, celui de l’Amérique du Nord britannique, « terre réfractaire à la seigneurie féodale » ; l’Empire des Indes, « moulin à chimères » ; l’Algérie française, « tenace et tragique illusion » ; enfin, l’Afrique occidentale, « une énigme et deux désillusions ». Soit un échantillonnage raisonnable, encore que l’Insulinde et la Chine eussent pu faire l’objet d’un tel échantillonnage. L’auteur qui en parle à plusieurs reprises explique cependant dans son introduction que « Ce livre est un essai. Il en a la taille et le contenu ». On ne critiquera donc point son choix, effectivement représentatif de plusieurs types de colonisation.
On ne peut être plus explicite quant au terme « essai », inutile d’y chercher le fruit de recherches de type universitaire, inutile encore de vouloir y trouver des renouvellements de perspectives communément admises. Mais, notation importante pour comprendre la portée de cet essai, « …ces territoires dévoilent une singularité commune qui passe souvent inaperçue : tous brisent le rêve du colonisateur européen. ».
Pour qui a étudié attentivement autrefois l’histoire coloniale, cependant, et si l’on prend le premier exemple, celui de l’Amérique du Nord, censée être « terre réfractaire à la seigneurie féodale », l’on comprend bien que les grands espaces permettaient aux colons d’échapper sans peine à toute emprise de type féodal. Ce fut également le cas en Australie par exemple.
Mais comment expliquer que ce qui était un choix plutôt rationnel et non pas « réfractaire » pour les colons anglais ne l’était pas pour les quelques milliers de colons français du Canada voisin, où ce « régime féodal », sous l’emprise d’un clergé catholique contraignant, a été d’une certaine façon la règle.
Il est dans ce chapitre question des treize colonies implantées par les Anglais sur le littoral atlantique, supposées être « leur premier apprentissage de la colonisation », s’entend celle de peuplement. Lequel s’étend sur plus d’un siècle : la Nouvelle Angleterre, entre 1620 et 1636 ; les colonies du centre, entre 1664 et 1681 ; celles du sud, de 1607 à 1732. Ces treize colonies, futurs États-Unis, datent de bien avant la révolution industrielle de l’Angleterre. Colonies de peuplement bien postérieures à celles de l’Amérique et des Antilles espagnoles. La Grande-Bretagne se situe de ce point de vue et à l’époque loin derrière l’Espagne, le Portugal, la Hollande.
Le modeste peuplement initial est le fait d’un financement privé, via des « Chartes royales » accordées à des « aventuriers ». Un autre trait « caractéristique des premières aventures est l’extravagance des privilèges accordés aux « découvreurs » de nouvelles terres. Ils ont « une juridiction absolue, une seigneurie entière ». De fait, les Anglais ont les yeux fixés sur les empires espagnols et leurs mines d’or. Mais dès la fin du règne d’Elisabeth Ière, en 1603, ruines et déconvenues de ces premières tentatives constituent le désastreux bilan de cette façon d’entr’apercevoir de fabuleuses richesses facilement acquises.
Puis l’auteur revient sur le peuplement européen des treize colonies du nord. Il y distingue trois modèles : celui des chartes de concession à des sociétés par action à but lucratif, celui des chartes de concession à des sociétés à but non lucratif, éventuellement religieux (les fameux pilgrims du Massachusetts), celui des concessions à des nobles, propriétaires éminents du sol.
Bouda Etmad classe le Massachusetts en premier dans la liste des réussites, ce en terme de rapidité du peuplement. Il explique encore qu’une bonne partie des décisions quant à ces treize colonies se prennent depuis Londres, ou plutôt par les actionnaires des compagnies à charte qui y résident. Il explique également pourquoi une ou des lois martiales sont édictées pour contraindre les travailleurs immigrés à une « discipline militaire ». Commercer par exemple avec les Indiens leur est interdit. Mais finalement, l’étau se desserre, et des terres de plusieurs dizaines d’hectares leur sont attribuées. Quelques mots encore sur le succès des variétés locales de tabac auprès des fumeurs en Angleterre, plus généralement en Europe, pour expliquer le développement de la Virginie À ce propos, une incidente : l’un des inventeurs de ces croisements et de ces variétés, est plus connu depuis pour avoir épousé la princesse indienne Pocahontas.
Les pages suivantes décrivent en détail l’évolution de ces treize premières colonies nord-américaines, les hésitations et voltefaces des sociétés à concession, ce qu’en ont dit Adam Smith, Tocqueville et autres Bancroft. Curieusement, il n’est ici question des Indiens qu’à propos de ceux qui en ont parlé en ces temps pour expliquer que le continent nord-américain était vide Alors que dans le chapitre suivant, il y sera fait référence pour expliquer la différence d’approche des Anglais dans leur mainmise sur l’Inde, où les sociétés et les économies locales étaient bien plus « développées ».
Ces Indiens furent-ils victimes de la colonisation blanche ? Soit par maladie, soit par refoulement ? Il semble dommage qu’il ne soit pas traité de leur existence ni de leurs rapports avec les « envahisseurs »…
Le « moulin à chimères » est sans aucune parenté historique, sociologique ou ethnographique avec l’Amérique du Nord. Sauf peut-être que cet Empire britannique des Indes se construit à peu près au moment où les colonies américaines prennent leur indépendance. Il y a d’un côté de vastes espaces et du côté « indigène » un écart de « civilisation » très sérieux avec l’Inde « cette Inde massive et subtile » qui appelle du conquérant « une combinaison de conquêtes militaires, longues et difficiles, et d’alliances mouvantes avec les élites locales ». La densité de population, des structures socio-économiques « sophistiquées », excluent tout colonat européen. Il faudra plus de deux siècles pour achever la conquête alors qu’il n’en fallut que peu de décennies en Amérique du Nord. Pour Nehru, la domination anglaise n’aura été qu’une parenthèse, certes marquée par la révolte et la défaite des cipayes puis le retour à l’indépendance.
D’abord, classiquement et pour près de cent ans, la domination anglaise est assurée par la Compagnie des Indes Orientales. La mutinerie des cipayes et ses sanglantes péripéties conduisirent le gouvernement britannique à transformer l’Inde en colonie de la Couronne, gouvernée depuis Londres. D’où la priorité donnée à l’amélioration de l’administration et au maintien de l’ordre, ce qui selon l’auteur, rétrécit l’horizon. Mais comment expliquer que cet Empire des Indes a d’abord aboli des structures politiques plus anciennes et plus traditionnelles ?
Des particularismes complexes subsistent au moment d’une Indépendance accordée sans conflit armé : la scission pakistanaise et plus tard bengalaise, la question toujours actuelle du Cachemire. Les explications à ces drames qui furent meurtriers manquent dans l’essai sous revue.
Lorsque que l’on passe à « l’Algérie française, tenace et tragique illusion », les premières phrases de ce chapitre sont les suivantes : «Il y a quelque chose de troublant dans l’histoire de l’Algérie française. Comment se fait-il que de toutes les expériences coloniales nées de l’expansion européenne d’outre-mer elle ait cumulé le plus d’outrances ».
Curieusement, Bouda Etemad ne rappelle pas le caractère très circonstanciel, lié à la politique intérieure française, de l’expédition d’Alger. Or, des anciennes colonies françaises des siècles précédents à celles dont la conquête commencera dans la deuxième moitié du 19ème siècle, celle-ci représente une exception qui durera cent trente ans, soit l’une des plus longues à la fois des colonies anciennes, du Québec aux plantation américaines et caribéennes, et des plus récentes, celles de la seconde moitié du 19ème siècle (dans ce dernier cas, à quelques exceptions près, telle la Nouvelle-Calédonie). Alors que les colonies des siècles précédents et les nouvelles au 19ème siècle correspondaient à des enjeux (ou illusions d’enjeux) économiques relativement évidents.
En revanche, Bouda Etemad est convaincant dans sa description des modalités de la conquête de l’Algérie, les interrogations qu’elle a posées quant à la façon de la poursuivre ou de la limiter, d’éviter une concurrence avec le Midi de la France où les produits agricoles sont de même nature, du partage des responsabilités politiques entre populations d’« indigènes » et d’immigrants d’origine européenne.
Il cite notamment les réflexions du baron Louis-André Pichon, « apologiste du système britannique », deux années à peine après l’expédition d’Alger. Il avait fait carrière aux États-Unis, dans les Antilles, ambassadeur sur la fin de sa carrière à Haïti ; puis « il devient brièvement le premier intendant civil de l’Algérie » plus précisément en 1832. Bouda Etemad affirme que les historiens ne se sont guère intéressés à ses écrits, prémonitoires des futures querelles entre « colonistes » et les « anticolonistes ».
L’autre témoin convoqué est Alexis de Tocqueville, auquel plusieurs pages sont consacrées, Il est connu que cet auteur engagé avait peu de considération pour les « indigènes » algériens, qu’il « était partisan d’une colonisation partielle », limitée aux environs d’Alger. Il estime que, pour la France « garder l’Algérie signifie garder son rang et affirmer son statut de grande puissance vis-à-vis de sa rivale, la Grande-Bretagne ».
Curieusement, Bouda Etemad ne souffle mot d’un autre acteur significatif de la période de la conquête, Abd-el-Kader, dont les conditions de la capitulation puis l’exil furent des étapes significatives de cette conquête. Elles ont un sens politique profond. Il n’évoque pas non plus les Bureaux arabes, dès 1844 et sous Napoléon III (où ils préfigurèrent les futures SAS de la guerre d’Algérie).
Vue d’Afrique du Nord, l’assimilation même partielle de l’Algérie à la France sert uniquement à consolider un colonat vulnérable. Vue de France métropolitaine, elle est plutôt censée favoriser en Algérie la « fusion des races » ». Cette formule lapidaire ne doit pas cacher, aux yeux de Bouda Etemad, l’hypocrisie de la France métropolitaine qui en fait, jusqu’au début des années 1950, privilégiera les colons au détriment des « indigènes ». Sauf erreur de lecture, il semble que ce colonat soit essentiellement agricole, ce qui serait le réduire abusivement, le colonat urbain étant également répandu.
L’on arrive ensuite à la dernière étape du parcours de l’essai, « L’Afrique occidentale, une énigme et deux désillusions ».
Ce chapitre commence par une sorte de classification des différents types d’emprises coloniales en Afrique subsaharienne : l’auteur dénote quatre « grands groupes », celui de l’Afrique occidentale où les Européens sont « pratiquement absents des activités de production » ; celui de « l’Afrique occidentale-centrale » où les gouvernements ont délégué à des entreprises expatriées la « mise en valeur » ; l’Afrique méridionale où priorité est donnée à ces entreprises expatriées d’exploiter les ressources minières et où «les colons européens doivent leur succès dans l’agriculture commerciale non pas à leurs techniques de production mais au traitement préférentiel que leur accordent les administrations coloniales » ; celui enfin, propre à l’Afrique orientale, il manque d’homogénéité, » « il s’agit d’économies où se côtoient productions « paysannes », domaines agricoles blancs et système de plantation ».
On ne rentrera pas dans la critique d’une telle classification, car la démonstration ou les constats de Bouda Etmad sont ailleurs. « Jamais, dans le drame colonial, le déséquilibre entre les acteurs n’aura été aussi grand ». Et de citer, entre autres, la supériorité donnée par les armes à feu, permettant des massacres de masse en rase campagne. Les progrès de la médecine tropicale (quinine), les moyens de transport (navigation motorisée, pose du rail) de communication (télégraphe) assurent « au colonisateur blanc une surpuissance inédite ».
Mais l’énigme est la suivante, pour l’Afrique occidentale (essentiellement colonisée par la France et l’Angleterre) : « les deux puissances se glorifient non pas de transformer et de « moderniser » les structures traditionnelles indigènes, mais de les protéger des forces dissolvantes du capitalisme industriel et financier ».
En d’autres termes, contrairement à d’autres colonisations européennes, celle-ci consisterait à « protéger » peuples et structures socio-politiques africaines. Selon un commentateur de l’époque coloniale, « les colonies d’Afrique occidentale britannique et française sont comme des filles naturelles qu’on craindrait de légitimer en les dotant ». Donc, « le colonialisme est un piètre agent du capitalisme ».
Pour qui a eu l’occasion d’être sur le terrain dans la phase finale de la colonisation, cette affirmation a de quoi surprendre. À moins que les maisons commerciales n’aient été qu’une illusion : de fait, elles géraient bien le capital de sociétés que l’on pourrait qualifier de traite, faute de « mise en valeur » devenue sur la fin « de développement » : c’est-à-dire exportant quelques denrées (coton, arachide, palmier à huile) et important des biens d’équipement, des véhicules, des produits de consommation de première nécessité au lieu de les faire produire sur place.
Trois compagnies (UAC, britannique, SCOA et CFAO, françaises), se partagent deux tiers à trois quarts du commerce extérieur de l’Afrique occidentale. Mais il s’agit ici d’un commerce « de traite » et non d’investissement productif. Selon l’auteur, un éventuel colonat européen agricole ne peut prospérer face à la concurrence des agricultures indigènes. La faible densité de la population, la prégnance des structures traditionnelles auxquelles les autorités coloniales ne peuvent que faire confiance, malgré les différences entre les colonies anglaises (l’indirect rule de Sir Lugard) et françaises (utilisation de fait des relais politico-économiques africains).
À titre d’exemple, Bouda Etemad consacre plusieurs pages au palmier à huile. Tout comme les cultures de cacao, de café, d’arachide, il se prête peu à la mécanisation. L’huile de palme supporte mal le stockage et le voyage à longue distance, l’économie traditionnelle en a fait commerce depuis longtemps. Pourtant, un dénommé Lever, tentera au Congo dit belge, à partir de 1920, de combiner usine, plantation, ce aux dépens des indigènes auxquels l’administration coloniale impose taxes, travail forcé, punitions corporelles. Mais, paternaliste, Lever atténue dès 1930 ces contraintes. Il semble que cet exemple de réussite soit unique en Afrique subsaharienne. Suit une analyse du « contre-exemple », celui de Sumatra.
L’« énigme » n’est pas résolue. Jacques Berque, vers 1960, constatait déjà que la colonisation ne transforme qu’en surface. Fi donc de la vision prométhéenne du progrès calquée sur la réussite occidentale et retour à la « préservation des systèmes précoloniaux », « auparavant vilipendés ».
Conclusion de ce chapitre : « la pauvreté recule précocement là où les Africains restent propriétaires des moyens de production et tardivement là où le colonat européen s’approprie une fraction disproportionnée des richesses ».
« Sur les terres lointaines, les bâtisseurs d’empire doivent affronter des forces souvent incontrôlables ». Tels sont les derniers mots de la conclusion de Bouda Etemad. Il signifie sans doute que ces bâtisseurs doivent renoncer à vouloir changer les mondes auxquels ils ont à faire.
Pour qui connaît bien les histoires coloniales – celles écrites dans les années 1900, 1930, 1950 puis à partir de 1980 – il y a dans cet « essai » bien des matières à commentaires, voire à discussion. Certaines ont été faites au cours de cette trop longue note de lecture. Comme le dit une partie du titre, « Empires illusoires », les Européens « auraient tout faux » parce que leurs empires seraient non conformes à leurs rêves de transformer le monde, en outre à leur image. Les échantillons choisis tendent à le démontrer, sauf dans le cas du peuplement nord-américain. Encore que dans ce cas, il a été noté l’absence, sauf rares allusions, de toute référence aux premiers occupants, amérindiens.
On notera que l’appareil critique est réduit au strict essentiel, pas une seule illustration – hormis celle de la couverture, une Anglaise perchée sur un énorme éléphant richement décoré.
À recommander pour les lecteurs familiers des histoires coloniales successives, comme première lecture d’apprentissage pour ceux qui ne le seraient pas.
Les recensions de l' Académie des sciences d'outre-mer sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrit.
Basé(e) sur une oeuvre à www.academieoutremer.fr.