


| Auteur | Richard Alain Marsaud de Labouygue |
| Editeur | VA |
| Date | 2020 |
| Pages | 88 |
| Sujets | Marsaud de Labouygue , Christian 1880-1952 Biographies |
| Cote | 63.494 |
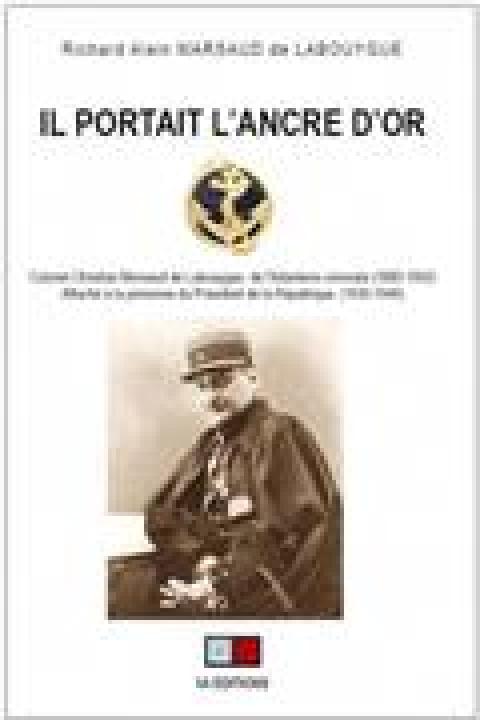
En quatrième de couverture, ce livre annonce : « L’aventure était dans le Havresac de ces Marsouins qui parcouraient mers et océans des continents asiatique et africain. L’ardeur d’une jeunesse « instruite pour vaincre » et l’enthousiasme légué par leurs aînés les entraînaient à se surpasser pour continuer l’œuvre coloniale grandiose, d’un Empire qui ne voyait pas se coucher le soleil. Christian Marsaud, comme ses camarades, a vécu grandement les événements qui se sont déroulés en Cochinchine, au Niger, avant de regagner la France métropolitaine pour participer à la Grande Guerre. Une blessure vint interrompre momentanément cette carrière, à défaut d’interrompre sa vie. Affecté au ministère de la Guerre, il devait travailler pendant deux ans, près du général Gallieni, dont il fut un des élèves. Il repart en opérations extérieures au Togo. Au ministère des Colonies et à l’École Militaire de Saint-Cyr, où il enseigna la géographie. De retour en opérations extérieures au Cameroun, il y rencontra le célèbre docteur Eugène Jamot, vainqueur de la maladie du Sommeil, propagée par la mouche Tsé-Tsé. Là, devait se terminer le temps de l’expatriation Outre-Mer. Il fut appelé à la Maison militaire de la Présidence de la République, à l’Élysée, par le Président Paul Doumer et confirmé ensuite dans ses fonctions par le Président Albert Lebrun, jusqu’en 1940. Il pressentait le désastre d’une défaite de nos armées et mettait un terme à sa carrière à Bordeaux, avec le sentiment, comme son père, le colonel d’État-Major-Général Joseph Marsaud, la veille de sa mort, qui s’était écrié : « J’ai fait mon devoir. Vive la France ! » Christian Marsaud de Labouygue, repose au Pays Basque, sa seconde patrie, qu’il aimait tant, dans le petit cimetière de Saint-Pierre-d’Irube. L’auteur : Richard Alain Marsaud de Labouygue, est l’arrière-petit-neveu du colonel Christian Marsaud de Labouygue. »
Cette « quatrième de couverture », fort explicite, devrait suffire à satisfaire les amateurs et « connoisseurs ». Il est rare qu’une « quatrième » reflète aussi fidèlement le contenu. Bien sûr, la « Une » avec le portrait n’a rien de surprenant, puisqu’il s’agit de l’exercice de style obligé de toute biographie. Que reste-t-il au critique littéraire et scientifique face à une excellente « quatrième » ? Il reste l’essentiel : trouver le montré-caché dans le caché-montré, ce que l’auteur omet par pudeur mais nous crie par transmission de pensée. Or, ledit auteur procède avec tact et pudeur : écriture sobre, présentation factuelle, absence d’effet rhétorique, énoncé objectif. S’il n’y avait cette discrète élégance de la plume, on croirait lire un JMO régimentaire (Journal de marches et d’opération) ou un rapport au retour de mission. C’est à peine si l’on devine le feu intérieur qui embrase l’auteur, pas tant l’admiration qu’il porte à un parent, que la force du symbole qui lie l’ancre d’or à la croix du Temple.
Il est révélateur qu’il ait posé l’emblème de la Coloniale en exergue du titre. En comparaison avec plusieurs de ses autres travaux, comme celui sur l’ordre templier, il est aisé de comprendre qu’il reconnaît son défunt parent comme un héritier moral du pèlerinage d’outremer, puisqu’il s’agit du nom que l’on donnait aux croisades avant le XVIIe siècle. Il n’y a qu’une seule façon d’analyser l’épineuse Question d’Orient, l’insoluble énigme des chancelleries : remonter à la plus longue mémoire pour éclairer l’actuel conflit du Proche-Orient, comme disent les journalistes influencés par l’américanisme, le Moyen-Orient comme on le disait jusqu’à un passé récent, le Levant s’il faut en croire le titre du corps expéditionnaire contre les Druzes.
L’auteur s’enquiert plus de l’âme et de l’esprit du défunt que des anecdotes pittoresques dans lesquelles se fourvoient si souvent les biographes. Il mentionne son tombeau. Saint-Pierre-d’Irube, lieu de l’éternel repos de ce rude guerrier, retentit encore dans l’Invisible et l’éternité du fracas des combats de Soult contre Wellington. Le souffle divin, depuis le pont Saint-Esprit de Bayonne, y remonte par la vallée de l’Adour. Bien oubliée aujourd’hui, cette bataille sanglante qui ravagea le cimetière vaut celle d’Eylau dans le poème de Victor Hugo. L’auteur, arrière-petit-neveu du défunt, rend un culte à ses dieux lares et pénates, sans verser dans l’hagiographie. Ce livre présente l’immense avantage de nous faire traverser une France qui change trois fois de régimes politiques et d’y exposer la mentalité d’un homme intransigeant quand il s’agit de son honneur et de son sens du devoir. Notre époque ayant largement estompé, voire oublié la signification de ces mots, il est bon à titre au moins documentaire de rappeler comment les protagonistes vécurent les événements à vif, et non s’attarder devant les jugements de valeur que nos contemporains peuvent porter a posteriori dans le confort douillet de leur cabinet d’étude. Ce colonel est d’autant plus fondé à nous montrer les facettes des opinions de son époque qu’il réunit en sa personne une expérience que peu purent acquérir : officier de troupe avec un commandement au feu, ayant reçu de très nombreuses affectations sur des continents et théâtres d’opérations nécessitant un capacité d’adaptation hors du commun, doté d’une faculté d’apprentissage théorique et pratique qui auraient pu lui donner accès aux étoiles si les circonstances l’avait permis.
Il faut rappeler l’importance des grades sous la IIIe République, sans commune mesure avec notre époque post-68tarde. Autrefois, l’attaché militaire français à Tokyo était un capitaine, ce qui n’a jamais froissé un empereur. Du temps de Marsaud, un colonel était regardé comme un grand seigneur commandant un régiment de 3000 hommes. Il devait tenir son rang et passer commande chez le maître-tailleur de la coûteuse tenue modèle 1931. Dans sa société, un « jeune homme de bonne famille » se serait senti humilié d’être recalé au « vieux bahut » de Saint-Cyr-l’École et mais admis en Sup’de’co. Marsaud, affecté à la Maison militaire de la présidence, adapte son sens de la fidélité et du lien vassalique, trouvant un juste compromis entre ses convictions intimes et le service de l’État en la personne de son plus haut magistrat. Les élus laïcs de la IIIe République éduqués chez les bons pères appliquent la doctrine coloniale préconisée par Victor Hugo disant des Français : « Nous sommes les Grecs du monde, c’est à nous d’illuminer le monde. » L’auteur, non seulement a su narrer l’atmosphère cette époque révolue, celle de la plus grande France, mais aussi dévoiler sous une lumière tamisée qui n’en reflète que mieux les contrastes, le conflit interne que dût résoudre son arrière grand-oncle.
Marsaud, officier de troupe, habitué à entendre siffler les balles, éclater les obus ou le son du clairon cabossé et les hurlements dans les corps à corps, le voilà dans le milieu feutré des tapis d’orient et des lambris dorés, loin des djebels et rizières où souffrent ses camarades. Le monde politique avec sa politesse compassée, ses rancunes tenaces et ses alliances paradoxales devient le quotidien de ce brave habitué au langage de la franchise. Une riche iconographie aux photos toutes inédites nous suggère subtilement ce changement d’univers. Imaginons une belle figure de la chevalerie franque aux croisades soudain plongée chez Machiavel. L’auteur a su traduire en quelques traits légers ces palinodies entre politiciens s’enivrant d’une rhétorique belliciste mais incapables de servir eux-mêmes au feu ; Marsaud surmonte ces contradictions internes grâce à son sens du devoir et de l’abnégation. Ces faux-semblants qui lui font regretter un bon marmitage à Verdun. Attaché à la Maison militaire de la Présidence de la République, il accomplit sa mission sans se faire valoir. Curieusement, il installe sa résidence secondaire dans le château du Bas-Moriers à Vaas dans la Sarthe ; or, il y a dans cette commune un énorme dépôt de munitions depuis 1917, qui prend une importance encore plus considérable en 1931.Il reste le témoin privilégié d’une époque qui se termine : il a la chance de mourir en 1952, l’année de l’offensive Vietminh contre les fortins de la Ligne de Lattre ; il ne verra pas s’écrouler l’œuvre coloniale à laquelle il a consacré sa vie.
Ses successeurs, le capitaine Léon Bonhomme à Vichy et le capitaine Geoffroy Chodron de Courcel à Londres, acquièrent une expérience très différente, plus connues des passionnés d’histoire. Ce livre comble donc une lacune.
Les recensions de l'Académie de Académie des sciences d'outre-mersont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrit.