


| Auteur | Isabelle Merle et Adrian Muckle |
| Editeur | CNRS |
| Date | 2019 |
| Pages | 527 |
| Sujets | Indigénat Colonies françaises Administration Autochtones Droits Conditions sociales Nouvelle-Calédonie Océanie |
| Cote | 62.612 |
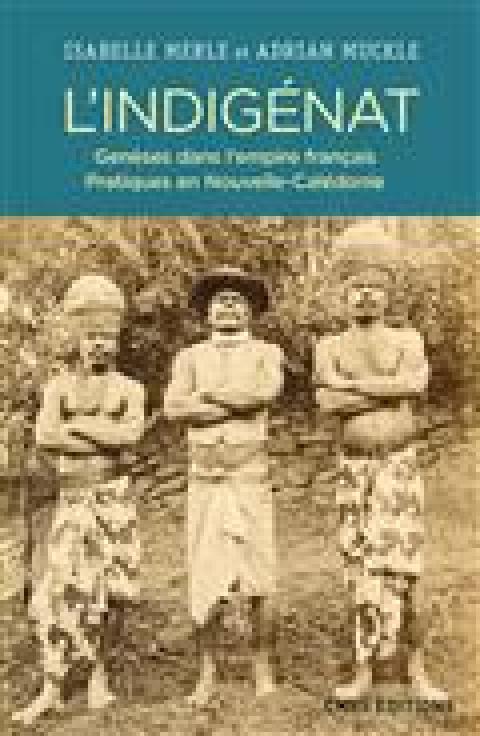
Assez étrangement, peut-être par défaut de connaissances spéciales, les historiens de la colonisation française ont eu tendance à négliger les aspects juridiques du phénomène colonial et notamment la question de l’indigénat. Tous les chercheurs savent qu’il est très difficile de se procurer un code exhaustif sous forme de compendium résumant ce régime : ce dernier était caractérisé par une législation ou plutôt une réglementation exorbitante au droit civil et au droit pénal, prévoyant des infirmités et des infractions particulières sanctionnées par des peines particulières. Isabelle Merle, directrice de recherche au CNRS et Adrian Muckle (Victoria University, Wellington NZ), tous deux spécialistes de l’histoire de l’Océanie, ont entrepris de combler, par le présent ouvrage, la lacune que nous venons de constater, avec un intérêt particulier pour le cas de la Nouvelle-Calédonie, colonie à laquelle ils ont déjà consacré plusieurs de leurs travaux.
Ils s’acquittent de leur tâche avec une indéniable compétence. Un premier chapitre plante le décor, dessine les grandes caractéristiques et rappelle les origines de ce régime qu’ils qualifient (p.42)de monstruosité juridique. Ainsi que les auteurs l’observent justement la nation française dévoyait aux colonies ses idéaux démocratiques en refusant de les étendre à ceux qu’elle soumettait.
La loi du 28 juin 1881, applicable à l’Algérie, peut être considérée comme l’acte de naissance de l’indigénat. Avec diverses amodiations, cette législation fut progressivement étendue à d’autres colonies notamment à la Cochinchine, au Sénégal puis aux autres territoires d’Afrique subsaharienne. Les quatre vieilles colonies (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), les quatre communes du Sénégal, ainsi que Saint Pierre-et-Miquelon et l’Inde Française restèrent toujours à l’écart, la plupart de ces colonies étant peuplées de citoyens à part entière et non de sujets.
Une deuxième partie nous emmène en Océanie et relate la prise de possession des Marquises ainsi que l’instauration, par Dupetit-Thouars, du protectorat à Tahiti qualifié (p. 89) «d’invention ambigüe». En fait ce n’était pas une invention, même s’il n’y avait eu que peu de précédents dans l’histoire coloniale française et que Dupetit-Thouars était loin d’être sûr d’avoir l’aval du gouvernement. On sait qu’il fut bel et bien désavoué par Guizot lors de l’affaire Pritchard.
Le chapitre 3 nous détaille les péripéties de l’institution du régime de l’indigénat en Nouvelle-Calédonie qui fut l’œuvre du gouverneur Louis Nouët, ancien capitaine d’infanterie de marine passé dans l’administration coloniale en Cochinchine (il fut directeur de l’Intérieur de cette colonie). Sujet brillant, titulaire d’appréciations flatteuses, Nouët sera à la tête de la colonie de 1886 à 1889 avant de poursuivre sa carrière en Inde Française puis en Guadeloupe et enfin en Martinique. Il élabora les projets de textes réglementaires de 1886 et le décret de 1887 dont un bon compte-rendu nous est donné au fil des pages. Nouët défend son œuvre dans une lettre circonstanciée adressée au ministre le 15 novembre 1886 et citée in extenso pp.122-125. Il insiste sur les énormes difficultés que rencontre la politique indigène qu’il entend mener, liées pour l’essentiel à la diversité des langues et aux tensions qui se font jour entre les tribus.
Une deuxième partie est intitulée «Plongée en colonie» : comment l’installation du régime de l’indigénat put-elle passer dans les faits et devenir une réalité ? Telle est la question à laquelle le chapitre 4 nous apporte d’utiles éléments de réponse en décrivant ce «temps des administrateurs» qu’il situe entre 1880 et 1902. Au lendemain de la Grande révolte de 1878 le territoire de la Grande Terre avait été divisé en cinq arrondissements, chacun d’entre eux étant placé sous l’autorité d’un administrateur, souvent issu de l’armée. Les auteurs décrivent l’important travail de «préparation du terrain» accompli par ces fonctionnaires entre 1880 et 1886 et les critiques qu’il allait engendrer de 1886 à 1894. Le régime des administrateurs fut finalement liquidé et ces fonctionnaires cédèrent la place à un nouveau type d’agent colonial, celui du gendarme-syndic qui devint assez populaire parmi les autochtones. Le commandement indigène était exercé par des grands chefs, ou chefs de districts, l’administration ayant procédé à un nouveau découpage territorial. Ces grands chefs avaient des compétences judiciaires et fiscales (collecte de l’impôt de capitation ou impôt d’indigénat auquel les seuls kanak étaient assujettis) ce qui faisait d’eux des percepteurs. Les auteurs soulignent à juste titre (p.263) le caractère fondamentalement inique de cet impôt mais ce n’est pas exceptionnel en situation coloniale. Les grands chefs avaient autorité sur les petits chefs ou chefs de tribu dont ils avaient souvent grand peine à se faire obéir. Les attributions de ces derniers étaient des plus modestes mais leurs incartades étaient fréquentes et se traduisaient fréquemment par des révocations ou à tout le moins des mesures d’internement.
Un septième chapitre traite de la société mélanésienne (Kanak) telle qu’elle se trouva sous le poids des contraintes imposées par le régime de l’indigénat. On notera que ce dernier aspirait à faire régner la moralité publique notamment en exerçant sur le comportement des femmes une surveillance attentive (mais quel en était le degré d’efficacité ?)
Le cas des îles Loyauté est étudié, de manière très sommaire à ce qu’il nous paraît, aux pages 290-304. Dans ces îles où les missions anglo-saxonnes avaient précédé le colonisateur français, le climat social était tout différent de la Grande Terre. Il n’y eut pas de colonat européen ni de confiscation du sol, les îles ayant été déclarées réserves foncières. Tout ceci eût mérité un examen plus approfondi.
La troisième partie (trois chapitres) nous dresse un tableau de ce régime de l’indigénat en Nouvelle-Calédonie au cours de la première moitié du XX siècle. Il fut plusieurs fois question de le remettre en cause et d’y apporter des amendements, notamment à la suite des rapports des inspecteurs des colonies Fillon et Revel (1907). Mais chacun sait que les travaux de l’inspection des colonies n’étaient trop souvent que vaine littérature promise à la poussière des archives. Les projets de statut des indigènes calédoniens, cette «nouvelle politique indigène» maintes fois évoqués entre 1913 et 1922 restèrent du domaine des chimères.
La colonisation n’était pas une œuvre philanthropique : elle avait un but, un credo qui était l’exploitation des autochtones et le régime de l’indigénat était son outil principal. Le chapitre 9 nous le rappelle judicieusement même si quelques réformes de détail pouvaient être apportées (Ch. Robert Ageron parle de réformes cosmétiques).
Le chapitre 10 nous décrit la dislocation finale de ce régime à la faveur de l’ébranlement des esprits pendant la deuxième guerre mondiale et notamment de la nouvelle mentalité engendrée par la présence des garnisons américaines et la participation de centaines d’autochtones sur les champs de bataille de la France Libre. En Nouvelle Calédonie comme dans le reste de l’Empire, le temps de l’indigénat était révolu et la voie de l’émancipation s’ouvrait, assez timidement il est vrai. Dès 1945, des notables autochtones rédigeaient une sorte de cahier de doléances qui impliquait la disparition quasi-totale de l’ancienne législation.
L’épilogue nous dépeint l’état de cette société calédonienne post indigénat caractérisé par l’éveil d’une vie politique locale et la naissance de formations politiques confessionnelles, l’UICALO (d’inspiration protestante) et l’AICLF (d’inspiration catholique), entre lesquelles il n’existait pas de divergences majeures. Mais le suffrage pour les Kanak était restreint (vote capacitaire) et ne deviendra universel qu’en 1956. (les deux partis, très attachés aux valeurs familiales, avaient freiné cette évolution). La personnalité du député Maurice Lenormand (l’émancipateur, selon l’heureuse expression d’Olivier Houdan) est évoquée en quelques pages : issu des rangs de l’extrême droite maurrassienne, haut fonctionnaire du ministère des colonies de Vichy, ce dernier avait pu échapper à toute poursuite en prenant part aux combats pour la libération de Paris. Epoux d’une Mélanésienne de Lifou, il sut s’imposer comme la figure marquante de la vie politique locale.
La relecture de l’orthographe semble avoir été quelque peu négligée : citons pour exemple : pour se faire (p.90), S’en est trop (p.139) et quelques autres coquilles étonnantes dans un texte rédigé par de grands universitaires et édité par le CNRS.
Des documents annexes fort utiles complètent heureusement cet ouvrage et la bibliographie est très complète encore qu’on puisse regretter qu’il ne soit pas fait mention des ouvrages de Frédéric Angleviel. Et on ne déplorera jamais assez l’absence d’un index qui aurait rendu les plus grands services pour la consultation de ce bel ouvrage de référence.