

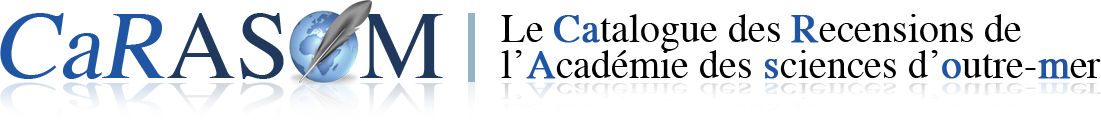
| Auteur | Ma Jian |
| Editeur | Flammarion |
| Date | 2019 |
| Pages | 201 |
| Sujets | Fiction de langue anglaise Royaume Uni XXIe siècle |
| Cote |
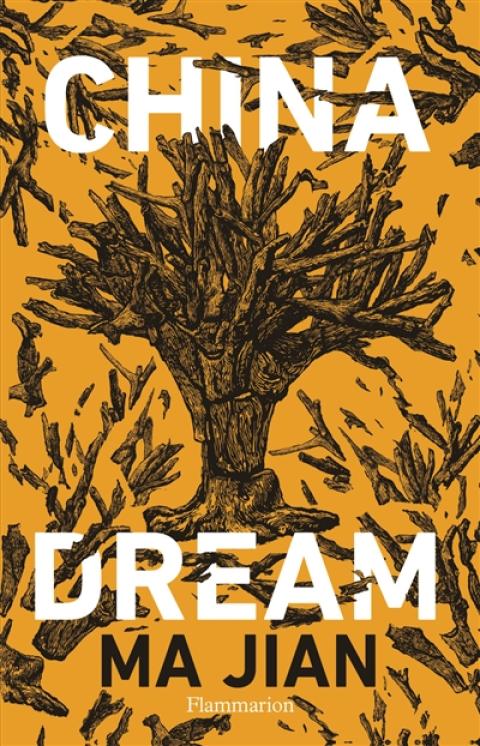
« China dream » a été écrit en 2018 par Ma Jian, écrivain en exil en Angleterre, au souffle d’une irrépressible indignation. Depuis 2012 insensiblement, un socialisme intolérant frappait la Chine, en un retour en arrière sur les méthodes maoïstes les plus sombres. Les arrestations se multipliaient dans toutes les couches de la société, couplées à de vigoureuses campagnes de restriction des libertés. Désormais leader incontesté, Xi Jinping préparait son pouvoir à vie, tordant la constitution pour se maintenir au-delà de deux quinquennats.
Si Ma Jian s’était limité à une simple dénonciation, l’œuvre risquait de n’aboutir à guère plus qu’un pamphlet sec parmi tant d’autres, brûlot légitime mais banal voire ennuyeux. Or dans China Dream, en écrivain parmi les plus doués de sa génération, il a su contourner l’obstacle en insufflant vie et personnalité à ses personnages pour en tirer un roman éblouissant de créativité sous une perspective largement inédite. Mettant en scène la classe ultrasecrète des apparatchiks, Ma Jian explore la face cachée du régime : l’intimité des plus hauts cadres, en exposant crument leurs obsessions et leurs rêves. La manière dont ils meublent leurs jours, vers quels objectifs (souvent inattendus) ils manient les « exosquelettes » de leurs superpouvoirs, en l’absence de toutes justice et presse indépendantes. Porté par l’indignation autant que par la verve littéraire, le projet de Ma Jian est anti-idéologique : il assume sa volonté d’en finir avec le « Rêve de Chine », ce slogan fondateur du règne de Xi Jinping. Ma Daode, son directeur du Bureau national des Rêves personnifie l’utopie du « Rêve de Chine » - la prétention d’insuffler au pays un renouveau national en le harnachant d’un nouvel appareil policier et judiciaire moralisateur.
A travers les errements de Ma Daode, l’auteur veut dévoiler le « « beau mensonge … concocté par l’Etat pour effacer les souvenirs douloureux des cerveaux de ses citoyens pour les remplacer par des pensées joyeuses ». Il brocarde aussi un « nationalisme exacerbé qui transforme les citoyens en enfants attardés - nourris, vêtus et divertis, mais sans aucun droit de se remémorer le passé ni de poser des questions ».
Dans son intrigue, Ma Jian entremêle vérité et fiction, entre les traits réels de la lourde machine socialiste (des organes et des actions du régime s’étant réellement passées) et les inventions extravagantes du directeur des rêves. Aux premières, comptent le fameux bureau des rêves (qui existe bel et bien), et la prise d’assaut de « Yaobang » par la police en vue de confisquer les terres et de les revendre aux promoteurs. On note au passage ce nom fictif de Yaobang, qui est à clé - une des multiples clés dont le roman fourmille. Yaobang est une de ces milliers de communes rurales qui avaient accueilli les 17 millions de « jeunes instruits » durant la Révolution Culturelle. Mais le nom est aussi - pas par hasard - celui de Hu Yaobang, ex-secrétaire général du Parti, réformateur convaincu qui avait tenté de, et failli réussir à aiguiller le régime vers la démocratie, avant d’être destitué par l’aile conservatrice en 1986. De même, « Ziyang », ville dont le directeur Ma a la charge, cache le prénom d’un autre haut cadre libéral, l’ex-premier ministre Zhao Ziyang passé à la trappe de Deng Xiaoping.
Dans le même registre, est-ce un hasard si l’auteur a prêté son propre patronyme à son anti-héros Ma Daode ? C’est comme pour rappeler son lien à sa nation, à sa culture, indéfectible malgré l’exil. Mais paradoxalement, Ma Jian choisit d’écrire son livre en anglais : comme pour honorer sa terre d’accueil. Ainsi ce roman traduit-il le déchirement intime de l’auteur en exil, entre fidélité et rupture…
Ma Daode, dans le récit, s’efforce d’inventer des outils de pouvoir nouveaux et délirants, tel cet implant neuronal destiné à aspirer la moindre pensée du citoyen, de lui faire oublier le passé qui l’obsède, et de le plonger en permanence dans un bain de pensées positives. Telle aussi la « Soupe du rêve chinois » aux ingrédients extravagants, dans la même finalité libératoire du passé.
Par ironie satirique, le prénom de « Daode » évoque celui qui a atteint la vertu, quoique le cadre mène une vie des plus dissolues, collectionnant et abandonnant par dizaines les filles incapables de lui résister et vivant dans un luxe incompatible avec l’austérité officielle. Un chapitre est consacré à une nuit hallucinante dans une boite de nuit (il vaudrait mieux parler d’un bordel) à thème maoïste, réservé aux seuls membres du sérail, où les filles se présentent en uniforme (très allégé) en référence avec la Révolution culturelle. Soit dit au passage, telle maison de plaisir fermée et invisible au grand public, existe dans la Chine réelle.
Plus loin dans le roman, Ma Daode préside une cérémonie de mariages de masse pour couples octogénaires - autre feature tirée de la réalité chinoise. Dans cette scène, les vieux époux vont gâter la fête en rappelant que leurs enfants assassinés ont été assassinés par les Gardes Rouges 50 ans en arrière.
Pour assurer la montée progressive de la tension, un « fil rouge » traverse le récit : la folie qui s’insinue et grandit inexorablement en Ma Daode, sous la double agression de sa quête de plaisirs et du souvenir de ses trahisons. Ces attaques mettent sa logique, sa pensée à rude épreuve, jusqu’à la chute. Dès le début du récit, il éveille l’inquiétude de ses pairs en s’assoupissant en pleine réunion après un repas copieusement arrosé, et en rêvant à voix haute des idées fantasques et divergentes, comme : « nous devons conquérir la forteresse des rêves… éradiquer les rêves passés… promouvoir le nouveau rêve national ».
Rattrapé par ses souvenirs, Ma Daode revoit ses parents qu’il a dénoncés dans sa jeunesse. Il tente désespérément de dissiper ces dangereuses idées fixes, mais ni les plaisirs, ni ses scabreux projets n’empêchent les sanglantes mémoires de réémerger, telle l’ignoble séance d’auto-critique de sa maîtresse au collège, noyée par les élèves-gardes rouges : « lorsqu’on l’a poussée dans l’étang, les nénuphars roses sont devenus noirs à cause de l’encre qu’on lui avait versée sur la tête ».
Enfin, durant la cérémonie des mariages d’octogénaires, Ma prononce l’irréparable en évoquant nommément la Révolution culturelle, thème rigoureusement banni. Après cette foucade, il se retrouve destitué, avant de se résoudre à l’unique voie qui lui reste ouverte - le suicide.
L’exercice littéraire de « China dream » confirme le don prodigieux de Ma Jian, son imagination débordante pour démonter le monde vicié de la Chine de Xi Jinping. Ma, ce faisant, veut agir pour son pays, et garde foi en l’homme - en sa capacité de vaincre la violence par l’écriture : « je crois encore que la vérité et la beauté sont des forces transcendantes qui survivront aux tyrannies des hommes ». De même, il espère qu’« à l’époque où [s]es enfants auront [s]on âge, le PCC n’existera plus que dans les salles poussiéreuses du Musée National » de Pékin.
C’est dans cette perspective, sous cet espoir qu’il a écrit cette satire féroce et drolatique : en un effort de catharsis, comme pour aider son peuple à contempler un jour, enfin, son passé sans trembler.