

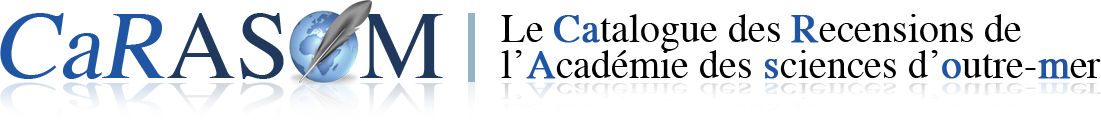
| Auteur | sous la direction d'Éric Anceau et Pierre Branda ; préface par François Villeroy de Galhau |
| Editeur | CNRS |
| Date | 2024 |
| Pages | 381 |
| Sujets | Napoléon 3 (1808-1873 ; empereur des Français) Et l'économie politique Actes de congrès Politique économique France 19e siècle Actes de congrès |
| Cote | 68.567 |
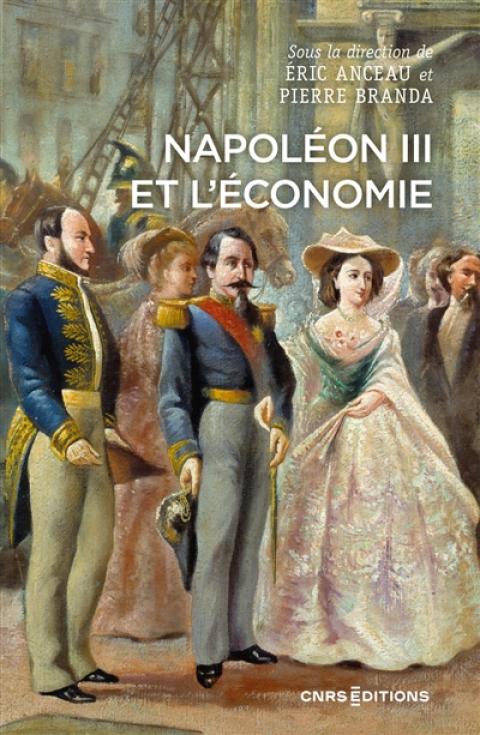
Les années récentes ont vu, de la part des historiens, une nette réhabilitation du Second Empire et, en particulier de l’action de Napoléon III. L’œuvre économique de l’Empereur et de son régime y a beaucoup contribué. L’ouvrage comporte une belle préface de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France (p. 7-10). Il rappelle que ce livre est le second consacré par la Banque de France à un tel sujet après un premier concernant le règne de Napoléon Ier. Il y insiste sur le rôle joué par la Banque de France, une fois son privilège renouvelé en 1857, dans la mise en place d’un système bancaire moderne, la mise en œuvre d’une politique anticipative fondée sur la pratique de taux d’escompte mobiles et la création de l’Union latine, en 1865 : au-delà des quatre pays fondateurs (Belgique, France, Italie et Suisse), elle regroupe jusqu’à 32 pays. En définitive, si le Premier Empire fut celui de la création de la Banque de France, le second fut celui de son expansion.
L’introduction générale d’Éric Anceau et de Pierre Branda justifie la publication d’un second volume par le fait qu’en matière d’économie, l’œuvre de Napoléon III a dépassé celle de son oncle. En premier lieu, la pensée économique du régime vient de loin, du fait des voyages et des nombreuses lectures de Louis-Napoléon. En revanche, il ne peut mettre en œuvre des idées qu’au lendemain du coup d’État du 2 décembre 1851. S’appuyant sur un nouveau personnel dirigeant et des entrepreneurs, Napoléon III procède à une relance par les investissements de base, puis à une modernisation basée sur une réforme du système de crédit (création du CIC, puis du Crédit lyonnais et de la Société générale), une grande politique des transports et d’aménagements du territoire (réseau ferroviaire, transports maritimes). Tandis que l’agriculture connaît un âge d’or, l’industrie réalise des progrès spectaculaires. Les principales villes du pays se modernisent, à commencer par Paris (grands magasins, expositions universelles). Toujours entre 1851 et 1869, le volume des échanges extérieurs est multiplié par trois. Or, persuadé que la libéralisation du commerce extérieur permettra d’abaisser le prix des denrées alimentaires, en particulier pour les pauvres, Napoléon III signe en janvier 1860, le Traité de commerce avec l’Angleterre, puis une quinzaine d’autres par la suite. De là même découle son soutien à Ferdinand de Lesseps dans son projet de percement du canal de Suez.
Dans les années 1860 la conjoncture devient moins bonne. Napoléon III s’engage alors dans la voie d’une politique sociale vigoureuse mais au succès mitigé. L’œuvre de Napoléon III souffre d’un discrédit majeur sous la Troisième République. Il faut attendre Jean Jaurès et Albert Thomas pour que les avancées économiques et sociales du Second Empire soient reconnues. Le renouveau s’amorce entre les deux guerres mais gagne en ampleur après la Seconde guerre mondiale avec de nombreuses thèses sectorielles, portant sur les travaux publics, la banque, les industries textiles, charbonnière, sidérurgiques et la première grande synthèse. Depuis les années 1980, les études économiques et sociales se sont multipliées et une floraison de travaux sectoriels d’une grande richesse qui imposaient une synthèse. Celle-ci s’organise donc autour de sept thématiques majeures : penser l’économie ; financer l’économie ; pouvoir et industrie ; transformer le pays ; et la France dit profonde ? ; s’ouvrir au monde ; les contrastes d’un règne.
En définitive, si Napoléon III était bien un Saint-Simon à cheval, il est impossible de réduire l'homme à cette dualité. Il est avant tout un pragmatique tourné vers l'avenir. Pour le meilleur et pour le pire, car il allait parfois trop vite. En effet, ses idées avant-gardistes ont conduit à la défaite dans la guerre contre la Prusse et ses alliés allemands et la chute de son régime a été le résultat de cette défaite. Fils de la Révolution, neveu de Napoléon Ier et grand amateur d’histoire, il a mené une politique très enracinée dans le passé français et très inspirée par son oncle. Mais il a aussi été un enfant de son époque, contemporain de l’industrialisation, grand voyageur et théoricien de l’avenir. Il a été imprégné par le saint-simonisme qu’il a cherché à appliquer au pouvoir. Pour cela, il s’est entouré de techniciens y compris dans ses gouvernements ; il a développé l’ensemble de l’économie et certains secteurs en particulier : banque, grande industrie, transports, commerce… ; il a mis en œuvre une politique sociale d’avant-garde. Aussi convaincu du rôle messianique de la France que les révolutionnaires de 1789 et que son oncle, il a pourtant exploré partiellement une autre voie qu’eux en la matière : celle des droits de l’homme et des grands congrès internationaux de la paix. Dans le regain d’intérêt et dans le mouvement de réévaluation dont le Second Empire et la personne même de son souverain ont fait l’objet ces dernières décennies, la référence au saint-simonisme joue un rôle-pivot. C’est le point autour duquel historiens et biographes tendent de plus en plus à faire tourner leurs réinterprétations des deux faces opposées et indissociables du bonapartisme : d’une part, son socialisme originel, y compris la nature autoritaire réputée être l’un des traits définitoires de ce courant d’idées ; d’autre part, son libéralisme tardif, tant au plan économique qu’au plan politique.
La partie 1 « Penser l’économie » débute par un texte très éclairant d’Éric Anceau, « les idées économiques de Napoléon III ». Il rappelle que dans l’esprit du chef de l’État, « le Second Empire doit procurer la prospérité matérielle à la France, comme le Premier, celui de son oncle, lui a apporté la gloire militaire » (p. 21). Napoléon III, en effet, arrive au pouvoir avec un authentique projet économique « Mûri et cohérent ». Pour lui, l’essor de l’économie conditionne à la fois le progrès social et la grandeur nationale. La voie retenue est celle d’un saint-simonisme « fortement réinterprété où le pilotage politique, l’humanisme, le patriotisme et le pragmatisme sont capitaux » (p. 321). Napoléon III apparaît donc non comme un idéologue mais comme un pragmatique qui a fait entrer la France dans la modernité. De fait, il a su inclure l’économie dans une pensée globale ancrée dans l’histoire et projetée vers l’avenir (p. 33). Serge Schweitzer s’interroge ensuite sur « La place de l’ouvrage Extinction du paupérisme dans l’histoire de la pensée économique ». Le livre, paru en 1844, nous révèle l’importance des priorités du futur Empereur. Celui-ci y apparait comme un vrai socialiste, témoignant d’une réelle sympathie pour les faibles et les pauvres. Mais, une fois Empereur, Napoléon III sera contraint à un « balancement constant entre socialisme césarien national et le refus que les ouvriers puissent être influencés par une internationale de nature étrangère » (p. 43).
L’économie fait alors l’objet de vifs débats parmi les spécialistes « Le Second Empire : une révolution de la pensée économique ? » telle est la question abordée par le troisième chapitre (D. Barjot). Depuis le XVIIIe siècle au moins, la pensée économique s’est largement nourrie du dialogue entre les classiques anglais et leurs homologues français. Elle a pénétré en profondeur le corps social au point que l’École de Manchester de Richard Cobden et les saint-simoniens, à l’instar d’Enfantin et de Michel Chevalier, ont obtenu que la France du Second Empire adopte le libre-échange quatorze ans après la Grande-Bretagne. Si les partisans du libre-échange l’ont emporté, temporairement, sur les protectionnistes, en revanche le débat intellectuel majeur entre tenants de la valeur travail et protagonistes de la valeur utilité ne cesse de gagner en ampleur. En dépit des intuitions de John Stuart Mill, un francophile, et, surtout, de Stanley Jevons, les Français ont pris de l’avance. Jean-Baptiste Say avait déjà engagé, sur ce point, un important débat avec David Ricardo. Néanmoins, les principales innovations viennent des ingénieurs français, parmi lesquels Jules Dupuit et Augustin Cournot. Il pose, avant Léon Walras et Alfred Marshall, quelques-unes des bases fondamentales de la science économique contemporaine : définition de l’élasticité de la demande par rapport aux prix, analyse de l’équilibre partiel et de la concurrence imparfaite, permettant d’expliquer le passage de la concurrence pure et parfaite au monopole et vice-versa.
La deuxième partie du livre s’intitule « Financer l’économie ». Elle débute par une contribution éclairante de Pierre Branda « Les budgets et les finances de Napoléon III ». Sous le Second Empire, les impôts restèrent ceux du régime précédent, mais la pression fiscale a diminué, favorisant l’expansion économique. Du côté des dépenses, l’effort a beaucoup porté sur les investissements au profit du dynamisme économique et de progrès sociaux. De ce fait, sur l’ensemble des exercices de la période 1852-1869, le déficit du budget a atteint entre 1 et 2% du PIB. Cependant, le déficit final eut d’abord pour origine la guerre. Les guerres de Napoléon III furent financées par l’emprunt. Cependant, le Second Empire n’en a pas abusé.
Sous Napoléon III, les pièces en argent à l’effigie des anciens souverains furent rapidement remplacées par celles en or représentant l’Empereur. Il s’agissait d’une rupture radicale par rapport au passé : en effet, sous les régimes antérieurs, les monnaies à l’effigie du souverain régnant circulaient conjointement avec celles de ses prédécesseurs. Quelles en furent les raisons : une volonté de l’Empereur ? Ou la conséquence non voulue de la loi de Gresham, selon laquelle la mauvaise monnaie chasse la bonne ? Telle est la question à laquelle répond Arnaud Manas, dans le chapitre 4 (« L’or de Napoléon III – Décret de l’Empereur ou loi de Gresham ? »). Il conclut ainsi : « l’effigie de l’Empereur s’est imposée en France dans les années 1850 grâce à l’or de Californie et à la loi de Gresham » (p. 85). En effet, l’explosion de la production d’argent et le discrédit conséquent du métal blanc condamnaient l’Europe et les États-Unis à adopter l’étalon d’or.
Il est donc pertinent à ce propos de s’interroger sur les relations entre la Banque de France et l’État (« Le gouverneur, l’Empereur et la Banque de France », chapitre 5, par François de Coustin). Si le rôle de la Banque de France dans la politique économique du Second Empire a été bien étudiée par Alain Plessis, le rôle spécifique des gouverneurs, notamment à l’occasion du renouvellement du privilège d’émission des billets de la banque en 1857, s’il est prolongé jusqu’en 1897, l’affaire confirme la vision de Napoléon Ier, pour qui la Banque n’appartient pas seulement à ses actionnaires, mais aussi à l’État en raison même du privilège de battre monnaie.
Cette deuxième partie s’achève sur une table ronde intitulée « Les banques et le crédit » (chapitre 6). Animée par Dominique Barjot, elle fournit l’occasion de débats passionnants entre Thierry Clayes, Matthieu de Oliveira et Nicolas Stoskopf autour des deux questions suivantes :
Question 1 - Quels sont les grands projets bancaires du Second Empire ? Le projet saint-simonien des Pereire ? Le Crédit foncier ? La banque de dépôts à l’anglaise ? Le projet Comptoir d’escompte ?
Question 2 - Comment ces grands projets bancaires du Second Empire ont-ils été réalisés (acteurs, obstacles, limites, portée, etc… ? La « révolution bancaire, telle qu’analysée par Rondo Cameron, Bertrand Gille, Jean Bouvier, Maurice Lévy-Leboyer et David S. Landes n’a-t-elle pas emprunté des chemins divers et concurrents ?
La troisième partie traite de « Pouvoir et industrie ». Dans le chapitre 7, Agnès D’Angio-Barros porte notre intérêt sur « Morny, Schneider, les Marchés et leur financement ». Auguste de Morny et Eugène Schneider, à la fois hommes politiques et d’affaires, furent très puissants sous le Second Empire. De leurs débuts sous la Monarchie de Juillet et jusqu’au décès de Morny, en mars 1865, ils œuvrèrent à créer ou développer de nouveaux marchés ainsi que les sources de financement nécessaires à leur conquête. En 1864, avec la création de la Société Générale, présidée par Eugène Schneider, les freins économiques existant au début de leurs carrières respectives ont en grande partie disparu, grâce notamment à l’action de deux hommes. Morny fait nommer le républicain Émile Ollivier à la tête de la commission parlementaire constituée en vue d’abolir la loi Le Chapelier qui empêche encore les chefs d’entreprise de constituer des groupes de pression stable ; c’est fait dès le 24 février 1864. Anticipant sur le vote du parlement, E. Schneider a créé, dès le 19, le Comité des forges qui a pour but l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels et commerciaux des grands sidérurgistes.
Cette époque voit l’émergence d’« Une nouvelle génération d’ingénieurs au service de la révolution des transports » (chapitre 8, Jean-François Belhoste). Si le premier fait marquant du régime fut l’achèvement des grandes lignes ferroviaires reliant la capitale aux principales métropoles régionales, un autre volet remarquable de la révolution des transports fut le développement, toujours sur les traces de l’Angleterre, de compagnies maritimes de dimension internationale. A cet essor contribuèrent de nombreux centraliens tels que Jules Petiet, formé comme beaucoup d’autres au sein du cabinet d’ingénierie fondé par Eugène Flachat, Philippe Vitali Émile II et Henri Pereire ou, plus tard, Gustave Eiffel. Comme le montre Thierry Renaux (chapitre 9, « La naissance de l’industrie de l’aluminium sous le Second Empire. Contexte, réseaux, influences (1854-1871) »), le premier âge de l’aluminium prend pour partie place sous le Second Empire. Des personnalités du régime s’engagent dans l’aventure : des chimistes et des ingénieurs de premier plan, mais aussi des industriels et des banquiers impliqués dans le Crédit mobilier. Il en va de même de personnages des hautes sphères de l’État et, surtout, de l’Empereur lui-même qui apporte un soutien financier et des commandes importantes.
La période voit encore « La percée d’une industrie nouvelle : les constructions métalliques et mécaniques. Schneider, Parent et Schaken, Gouïn et quelques autres » (Dominique Barjot et Clémence Becquet », chapitre 10). Les britanniques ont été des pionniers en matière de constructions de ponts comme de machines, grâce à l’invention du fer puddlé, puis de l’acier, de la machine à vapeur et de ses dérivés) mais aussi à la réalisation de structures métalliques de grande portée. Néanmoins, à partir des années 1840, le retard français est comblé sous l’impulsion d’entrepreneurs innovateurs tels que les frères Schneider ou Jean-François Cail. Portés par un immense effort d’équipement ferroviaire et par la première industrialisation française, un certain nombre d’entrepreneurs créent des usines de travaux de grande taille, jusqu’à constituer au tournant des années 1860, un oligopole de grandes maisons capables de relever, à partir de cette date, de s’imposer à l’exportation, même face à la concurrence britannique : les Établissements Schneider et Cie du Creusot, les usines Cail de Grenelle, la maison Parent & Schaken et les Établissements Ernest Gouïn. Toutefois, les opportunités du marché national puis international ouvrent ainsi la voie à des entreprises moyennes compétitives, souvent issues de la serrurerie, à l’exemple des Établissements Joly d’Argenteuil, de la maison Armand Moisant ou des Ateliers de Levallois-Perret, rachetés en1866 par Gustave Eiffel. Jusqu’au milieu des années 1880, ces entreprises symbolisent la percée économique internationale de la France.
La quatrième partie s’intéresse à « Transformer le pays ». En la matière, comme le dit Georges Ribeill, l’un des éléments majeurs ce sont « Les chemins de fer, un vecteur décisif du développement économique » (chapitre 11). Tout au long du Second Empire, le réseau national a connu une forte croissance territoriale permettant de couvrir tout le territoire. Fin 1869, toutes les préfectures sont atteintes, sauf Digne et Gap. Cela est dû principalement à la politique ferroviaire de Napoléon III : concentration des exploitants en six grandes compagnies ; nouvelles garanties financières mises en œuvre par l’État pour forcer les compagnies à étendre leurs réseaux, à travers les conventions de 1859 et 1863 ; soutien des candidats officiels aux élections de l’époque ; introduction d’un nouveau régime de voies d’intérêt local, dépendant des conseils généraux. Relancés par le traité de commerce de 1860, les travaux ferroviaires favorisent le transport de la houille et des denrées alimentaires dans tout le pays, mais aussi l’accélération des transactions commerciales.
Transformer le pays, c’est aussi « Démanteler le mur des Fermiers généraux en 1860, la fin de l’Ancien Régime fiscal à Paris ? » (Juliette Glikman, chapitre 12). En 1784, plusieurs facteurs ont conduit à la création du « mur murant Paris ». Mais, sous le Second Empire, l’accroissement démographique des environs de Paris pousse à l’annexion des communes périphériques, au risque du sacrifice des intérêts industriels. En 1860, le mur, d’une longueur de 24 kilomètres, est finalement détruit au profit des intérêts de la capitale, non sans engendrer de vifs débats autour du droit d’entrepôt dont bénéficiaient les industriels et aussi de l’intention supposée des pouvoirs publics de vouloir bouter les ouvriers hors de Paris.
Le chapitre 13 consiste en une table ronde portant sur « Les grands travaux ». Animée par Michel Hau, elle a consisté en un débat entre Florence Bourillon, Michel Carmona et Dominique Barjot. En introduction, Michel Hau rappelle qu’en 1852, Louis Napoléon Bonaparte a déclaré préférer les grands travaux à la guerre comme moyen d’affirmer la grandeur d’une nation. Selon Michel Carmona, quand, le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon réalise son coup d’État, il a les coudées franches pour accélérer et amplifier le programme des grands travaux. Dans ce but, il veut un collaborateur loyal, solide, bon administrateur : en juin 1853, il fait appel Georges-Eugène Haussmann, alors préfet de la Gironde. Haussmann restera préfet de la Seine seize ans et demi, de juin 1853 à janvier 1870. Dès son arrivée, il engage les immenses travaux, que l’on connaît et accueille, à Paris, l’Exposition universelle de 1855. Pour financer tous ces travaux, c’est le Crédit Mobilier créé fin 1852 par les frères Isaac et Émile Pereire qui remplit le rôle de banquier et en même temps d’investisseur-promoteur.
En 1858, Napoléon III force la cadence. Il fait voter un grand emprunt qui permet de multiplier les travaux dans tous les quartiers de Paris. Napoléon III demande à Haussmann d’effectuer ces réalisations sur dix ans. Il le charge d’étendre les limites spatiales de Paris. Le 1er janvier 1860, la superficie de Paris double. De douze arrondissements on passe à vingt. Dans l’ancien Paris les grands travaux se poursuivent avec la même intensité après cette date. Haussmann attache une grande importance au mobilier urbain et à l’aménagement de l’espace public. D’un point de vue financier, la note totale, ancien et nouveau Paris confondus, s’élève, de 1852 à 1870, à 2 milliards de francs, dont une forte proportion fournie par l’emprunt. Si Haussmann, accusé de mauvaise gestion et devenu le symbole de l’autoritarisme napoléonien, est démis de ses fonctions dans les premiers jours de 1870, la Ville de Paris absorbera aisément le fardeau de la dette sans augmentation de la pression fiscale grâce au dynamisme économique stimulé par les grands travaux qui fait croître mécaniquement les rentrées fiscales.
Pour Florence Bourillon, l’opposition à l’annexion concerne essentiellement les communes de La Villette, quartier « sacrifié à l’industrie » selon les termes d’Alain Faure, et de Bercy, entrepôt des vins. L’enjeu est, pour les opposants, le report de l’octroi des anciennes barrières au mur des fortifications, incluant ainsi les territoires devenus de véritables zones franches, depuis les années 1840. La rapidité des procédures est à relever puisque la loi est votée le 16 juin 1859 pour une application au 1er janvier 1860. Il s’agit de faire profiter la ville des ressources de l’industrie et du commerce, de faciliter la circulation des biens et des personnes en déplaçant les barrières d’octroi, faire de Paris une capitale moderne, digne de l’Empire. Paris double alors sa superficie et sa population augmente de près d’un demi-million d’habitants. D’après les chiffres donnés par Haussmann, le coût de l’annexion n’équivaut qu’à 16,6% de l’ensemble du total des grands travaux parisiens. À long terme cependant, l’annexion représente cependant un enjeu considérable dans la transformation de Paris.
Dominique Barjot s’intéresse quant à lui à l’échelle nationale. Pour Michel Chevalier, l’Empire doit à la fois satisfaire les classes les plus nombreuses et se rattacher les classes les plus élevées. Ce programme, désigné comme « l’économie du deux décembre », se réalise en deux temps. Dans un premier, l’objectif est d’assurer la croissance des investissements de base, afin de renouer avec le processus de croissance du « moment Guizot » tout en desserrant les contraintes opposées aux initiatives des investisseurs depuis 1848. Dans un second, s’engage l’étape libérale : le développement des investissements a pour but d’accroître le commerce et d’assurer une expansion continue. De fait, le Second Empire se caractérise par une croissance économique soutenue, mais marquée par des crises cycliques, notamment en 1857-58, en 1862-63 et en 1868. S’élevant à près de 4 % par an en moyenne, la croissance du PIB bénéficie d’un effet d’amplification. Ce dernier résultat notamment du poids relatif élevé de l’investissement au sein du PIB.
En premier lieu, le Second Empire s’inscrit dans un grand cycle d’expansion de la construction allant des années 1830 aux années 1880 et combinant le dynamisme à la fois des constructions urbaines et rurales. S’y ajoute un cycle d’expansion des infrastructures de base. Il s’agit en premier lieu du chemin de fer : les investissements ferroviaires s’accroissent à un rythme soutenu des années 1840 à 1857, avant de connaître ensuite un fléchissement, tout en demeurant à un niveau élevé. Ce fléchissement favorise un rééquilibrage au profit des canaux et des ports et, surtout, s’accompagne d’un effort très soutenu en faveur des routes. En revanche, les investissements en matériels connaissent un moindre développement, parce que la croissance économique demeure fondée sur la mobilisation d’une main-d’œuvre grandissante.
À bien des égards, il s’agit d’une croissance économique caractéristique d’un pays émergent. Elle se trouve portée par l’importance des grands travaux : grandes opérations immobilières, grands chantiers d’infrastructures de transport et d’aménagement du territoire, tels que reboisements, défrichements, assèchements. Durant le Second Empire, la France consacre ainsi une part élevée de son PIB aux investissements. Une telle situation impose un niveau élevé et un flux régulier d’épargne, mais aussi une propension à consommer relativement faible et le maintien d’une grande inégalité dans la répartition du revenu national. Aux origines de ces grands travaux se trouvent différents facteurs. En premier lieu jouent de profondes transformations urbaines. Elles sont portées par la vigueur de l’urbanisation, à Paris, mais aussi dans les villes de plus de 50 000 habitants. Cette urbanisation prend la forme de l’« Haussmannisation », qui répond à des objectifs complexes : développement des systèmes de circulation, essor des constructions neuves, mise en place de réseaux d’assainissement et de distribution d’eau, développement des logements populaires et essor du génie civil urbain.
En second lieu, se développe pendant la période du Second Empire un effort majeur d’investissement en grands travaux d’infrastructure. Celui-ci revêt deux formes principales :
1 – la modernisation des réseaux de transports : essor du système ferroviaire, avec notamment la constitution des grands réseaux ; effort en faveur des ports, notamment au service de la constitution de grandes compagnies de navigation et des canaux ; modernisation du réseau routier.
2 – Le développement de l’aménagement du territoire. Celui-ci prend la forme de grands travaux d’assainissement (ainsi que de protection des espaces naturels. Mais il peut consister aussi en la multiplication de simples travaux agricoles.
En troisième lieu, le Second Empire pratique une politique économique incitative. Cette politique bénéficie de l’appui des grands corps, notamment des ingénieurs des Ponts et chaussées et des ingénieurs des Mines. Cette politique incitative revêt une triple dimension :
1 – Elle consiste d’abord en une politique conjoncturelle modèle, associant une pratique volontariste du taux de l’escompte et une politique budgétaire plutôt expansionniste, prenant la forme de grands emprunts.
2 – Elle s’accompagne d’une politique des structures : mise en place d’un système bancaire moderne autour de la Banque de France ; modernisation du régime des sociétés anonymes.
3 – Enfin, l’expression la plus achevée de ce volontarisme réside dans le choix du libre-échange, aux conséquences plus positives que ne l’a craint une majorité des milieux d’affaires-.
Enfin, en quatrième et dernier lieu, la période du Second Empire voit se constituer, autour des chantiers de grands travaux, un fort noyau de grandes entreprises à même de les réaliser. Il s’agit d’abord de firmes œuvrant dans le secteur des constructions métalliques. Ces grandes entreprises se retrouvent aussi dans d’autres spécialités du génie civil ou, même dans le bâtiment. Cet ensemble de grandes entreprises est à l’origine d’une percée internationale du génie civil français.
La cinquième partie a pour thème « Et la France dite « profonde » ? ». Elle débute par un article très attendu de Nadine Vivier (« Napoléon III et le progrès agricole », chapitre 14). Elle montre bien comment, entre 1852 et 1870, l’agriculture a surmonté les difficultés liées aux maladies des animaux et des végétaux et, ainsi, connu de notables progrès. Ils s’inscrivent dans un mouvement commencé autour de 1835, qui s’est amplifié nettement par la suite. Le Second Empire a vu donc une ouverture économique et culturelle des campagnes. Le rôle de l’Empereur a contribué à créer un climat favorable à la diffusion des innovations. Pour autant, il n’a pas eu de véritable politique agricole, mais seulement encouragé la mise en place de mesures dispersées, quoique cohérentes et complémentaires afin de vaincre les résistances des propriétaires, stimuler les exploitants, sans renoncer à des mesures sociales en faveur des plus pauvres.
Quant à Chantal Prévot, elle a présenté une communication sur « Les Halles : le gargantuesque « ventre » de Paris : quand les marchés de la Halle devinrent les Halles centrales » (chapitre 15). Siège, depuis le Moyen-Âge, du principal marché de produits frais de la capitale, le quartier des Halles était arrivé à saturation sous le Second Empire, suscitant la volonté de Napoléon III, relayée par le préfet de la Seine Haussmann, de doter la capitale d’un outil moderne, au service de la distribution entre producteurs, grossistes et détaillants. Les travaux avancèrent vite, grâce notamment à Victor Baltard, et à Félix Callet, conduisant à une mise en service complète dès la fin des années 1850. Véritable « machine de guerre alimentaire », le « ventre de Paris », tel que l’appelle Zola, constituant un monde en soi où s’affairaient tout une gamme de métiers allant des « seigneurs des halles », aux « forts des halles », mais aussi des « dames de la halle », aux tanneurs, réveilleurs et réveilleuses, écosseuses et équeteuses, voire aux compteurs-mireurs d’œufs, ceux-ci employés par la ville de Paris. De son côté, Frantz Laurent s’intéresse au bonapartisme populaire à l’épreuve du pouvoir (chapitre 16). Si jusqu’à la fin de son règne, Napoléon III a bénéficié d’un large soutien populaire, les contemporains comme les historiens ont souligné une opposition entre ouvriers et paysans. En réalité, les deux mondes, ouvrier et paysan, sont loin d’être homogènes. D’une étude de l’évolution de l’opinion, il ressort qu’affaibli par les difficultés économiques et sociales de la fin du règne, concurrencé, dans les grands centres urbains, par la propagande républicaine et socialiste, le bonapartisme ouvrier a souffert de l’usine du pouvoir, tandis que le bonapartisme paysan ne se démentit pas. Il ne cessera d’exister que dans les années 1880 au profit du radicalisme notamment.
La sixième partie, « S’ouvrir au monde », débute par une étude d’Olivier Baustian, « Le traité de commerce avec l’union douanière allemande (1860-1865) : une erreur stratégique ? » (Chapitre 17). On le sait, après la signature du traité de commerce franco-britannique du 23 janvier 1860, le Second Empire cherche à signer des traités de commerce avec d’autres pays européens : ainsi celui conclu avec la Confédération germanique. Il eut cependant pour conséquence d’accélérer l’ascension de la Prusse au détriment de l’Empire autrichien. Apparemment avantageux pour les intérêts français, en excluant l’Autriche, il précipite la dissolution de la Confédération germanique, dès 1866, et consécutivement, la création de l’Empire allemand.
« Des ports au service des ambitions mondiales du Second Empire », tel est le thème traité par Bruno Marnot (chapitre 18). En matière de financement des ports, le mouvement impérial a correspondu aux plus fortes dotations budgétaires. Le constat est parfaitement cohérent avec les ambitions maritimes du Second Empire, à savoir concurrencer les Britanniques dans le développement de lignes maritimes intercontinentales, relancer la politique coloniale et exercer une politique d’influence mondiale exigeant de développer les outils navals et portuaires outre-mer. En définitive, le Second Empire a été le seul régime du XIXe siècle capable de mettre en œuvre une politique portuaire cohérente par rapport à ses ambitions maritimes. Renouant avec une orientation saint-simonienne, les ports de commerce et de guerre ont bénéficié d’un effort soutenu et massif de l’État, marqué à la fois par une politique d’équipement, mais aussi la création d’établissements littoraux.
Marie-Françoise Berneron-Couvenhes va dans le même sens (chapitre 19, « Naissance et essor des compagnies maritimes sous le Second Empire : initiative publique, initiatives privées). Deux grandes compagnies de navigation voient le jour au moment du Second Empire : les services maritimes de Messageries impériales en 1852, plus tard Messageries maritimes ; la Compagnie générale maritime en 1855, devenue Compagnie générale transatlantique en 1861. Leur création répond à deux impératifs nationaux : créer des compagnies de navigation sur le modèle anglais afin d’éviter le déclassement international de la France ; désengager l’État des services maritimes postaux effectués en régie en Méditerranée au milieu des années 1830. Grâce à la convergence d’une volonté politique forte et d’initiatives entrepreneuriales audacieuses, les deux compagnies « deviennent les ambassadrices du pavillon national sur les océans du globe et les initiatrices d’une marine marchande moderne en France » (p. 273). Outre leur dimension économique, elles servent la politique extérieure française, renforcent l’indépendance des dessertes coloniales, donnent même quelques avantages vis-à-vis de l’Angleterre.
Caroline Piquet a pour objet d’étude « Le canal de Suez : une voie maritime au cœur des ambitions commerciales du Second Empire » (chapitre 20). Certes le canal de Suez trouve ses origines bien avant l’accession au pouvoir de Napoléon III, mais il se réalise sous son règne. Projet saint-simonien, le canal de Suez symbolise une époque dominée par le développement des échanges et les progrès de l’industrie. Si le chantier de creusement s’étend de 1859 à 1869, il met à l’honneur les capacités techniques de la France à l’époque. À partir de 1862, la Compagnie renonce au système de la corvée, et aux entrepreneurs locaux pour se doter d’une organisation rationnelle, inspirée de l’industrialisation française conçue par François-Philippe Voisin. Elle fait aussi à quelques-uns des plus grands entrepreneurs du temps. De son côté, Napoléon III joue un rôle capital à partir de 1864. De fait, le percement de l’isthme égyptien s’est imposé, en effet, comme un projet-phare des années 1860, soulevant l’enthousiasme des petits porteurs, des grands industriels et de la presse.
Quant à Édouard Vasseur, il fait le point sur « Les expositions universelles de Paris de 1855 et 1867 » (chapitre 21). Dès 1853, Napoléon III ouvre les expositions nationales de produits de l’industrie aux producteurs des pays étrangers et en organisant deux expositions universelles en 1855 et 1867. Officiellement, ces expositions constituent un incontestable succès pour le régime. Lors de ces deux éditions, la France domine la compétition artistique, s’affirme comme un leader de l’industrie du luxe et dans le secteur des travaux publics. Elles symbolisent ainsi la fête impériale. Cependant, elles révèlent aussi quelques faiblesses : si la France domine dans le luxe et dans le demi-luxe, elle reste distancée par l’Angleterre en matière de produits grand public. De plus, elles mettent en lumière le succès limité de la politique sociale et pédagogique. Enfin, diplomatiquement, le succès de la France apparait modeste, notamment en 1867, en raison des tensions diplomatiques avec la Prusse.
La septième et dernière partie, « Les contrastes d’un règne » commence sur une contribution de Xavier Mauduit (« Flamboyant Second Empire : la cour de Napoléon III »). L’expression « fête impériale » s’est imposée pour désigner le Second Empire, tant les cérémonies grandioses, les bals somptueux et la vitalité de la vie de cour sont demeurés dans les mémoires. Réceptions et voyages constituent tout autant d’occasions de déployer le faste du pouvoir. Pour financer cette fête, mais aussi pour encourager l’industrie et le commerce, Napoléon III dispose d’une liste civile et d’une institution efficace : la Maison de l’Empereur, organisée en Ministère. De 1852 à 1870, son budget représente en moyenne 1,25% des dépenses totales de l’État, contre 23,9% pour le Ministère de la Guerre et 8,8% pour celui de l’Intérieur. De plus, les finances de la Maison de l’Empereur sont marquées par une grande stabilité. Certes l’Empire coûte cher, mais sûrement pas au point de justifier toutes les critiques qui lui ont été adressées.
Vincent Haegele a traité de « Protéger, encadrer, limiter le travail des enfants : une initiative sociale du Second Empire. La société de Protection pour les apprentis et les enfants des manufactures » (chapitre 22). Sous le Second Empire, le travail des enfants, même réglementé par les régimes précédents, est devenu un programme social de première importance. Avec l’accélération de l’industrialisation, de plus en plus de familles rurales doivent migrer vers les centres urbains : les enfants travaillent dans la plupart des secteurs de production, avec des horaires proches de ceux des adultes. La massification du travail des enfants conduit certains à s’inquiéter de ce qui pourrait devenir « le fléau d’une génération », condamnée à travailler sa possibilité d’instruction. Charles Barreswill, chimiste et inspecteur honoraire du travail, en fait le combat d’une vie, gagnant le soutien de l’Impératrice Eugénie. Militant en faveur de l’apprentissage et de la protection des enfants, il ouvre la voie à l’éducation obligatoire portée par la Troisième République.
Agnès Sandras revient, pour sa part, sur la vision de Zola (chapitre 23, « Zola critique de l’économie du 2 décembre et les conséquences : la faute à Balzac et Hugo ? »). Dans ses ouvrages, tels que La Curée, L’Argent, le Second Empire se caractérise d’abord par le faste impérial, le poids grandissant des banques et de la Bourse, la cupidité des actionnaires et des promoteurs. Néanmoins, dans une interview de 1895, Zola semble remettre en cause cette vision. Tout en reconnaissant l’influence qu’ont exercé sur lui Balzac et Hugo, sa rigueur l’a conduit à être critique, à la fois sous l’angle positif et sous celui négatif, vis-à-vis de l’économie du Second Empire. Le dernier chapitre traite de « 1857, 1867, années de crise économique » (chapitre 24), à travers une étude comparative des deux crises. L’objectif est de montrer en quoi ces crises ont marqué une rupture. Mondiales, leur composante agricole est désormais négligeable en comparaison de leur dimension industrielle et financière. De plus, les pouvoirs publics ont organisé une réponse en adaptant la politique monétaire, une nouveauté par rapport à une vision classique de la monnaie, où, du fait de sa neutralité, elle ne joue aucun rôle dans la croissance, mais uniquement dans l’organisation des échanges.
L’ouvrage s’achève par une « Conclusion générale » d’Éric Anceau et Pierre Branda. Auteur d’un véritable programme économique (Analyse de la question des sucres, Extinction du paupérisme), Louis-Napoléon, puis Napoléon III arrive au pouvoir avec un véritable programme économique. Selon lui, l’État doit accélérer le développement de l’économie. Il ne peut le faire seul, sans l’appui du secteur bancaire et des grandes firmes. L’Empereur éprouve une réelle sympathie pour les pauvres et, inspiré par le saint-simonisme, privilégie le progrès technique et social. Dans ce but, il met en œuvre « l’économie du 2 décembre » en deux temps : assurer la croissance des investissements de base en allégeant les contraintes étatiques, puis profiter des progrès économiques induits pour distribuer et garantir une croissance soutenable. Dans un contexte monétaire pas toujours favorable, l’action de la Banque de France et de la nouvelle banque, telle que promue par les Pereire, fut déterminante. Encouragés par le gouvernement impérial, de grands industriels s’investissent dans l’entreprise de modernisation. En outre, Napoléon III a parfaitement compris le rôle des transports, ferroviaires bien sûr, mais aussi maritimes, tout en accordant une place privilégiée au progrès technique et scientifique.
Comme le montrent le démantèlement du mur des Fermiers généraux, et plus encore la réalisation du Paris haussmannien, il n’hésita pas à recourir à l’emprunt pour financer les investissements nécessaires. Soucieux d’ouverture économique, il promeut contre les oppositions patronale et ouvrière, au libre-échange généralisé, étendant la conclusion de traités à toute l’Europe : après l’Angleterre, la Belgique, le Zollverein allemand, l’Empire ottoman, les Pays-Bas, l’Italie... mais au prix du renforcement de la Prusse. La construction du canal de Suez, par l’entreprise privée, en constitue le symbole. Le monde agricole ne fut pas oublié, loin de là : sa prospérité fut largement le fruit de la modernisation. En matière sociale, son action fut plus mitigée. Cependant, il double les crédits accordés à l’assistance publique et donne du travail à la classe ouvrière à travers sa politique des grands travaux, associant progrès technique et progrès social, en conformité avec le projet saint-simonien.