

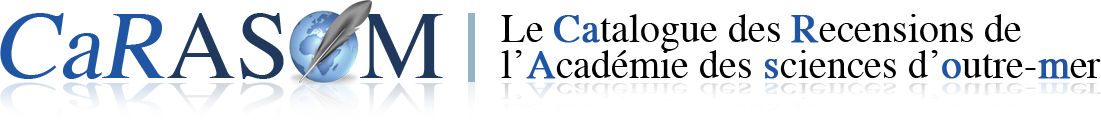
| Auteur | Gérard Buttoud |
| Editeur | l'Harmattan |
| Date | 2024 |
| Pages | 193 |
| Sujets | Guerres napoléoniennes (1800-1815) Algérie |
| Cote | 69.089 |
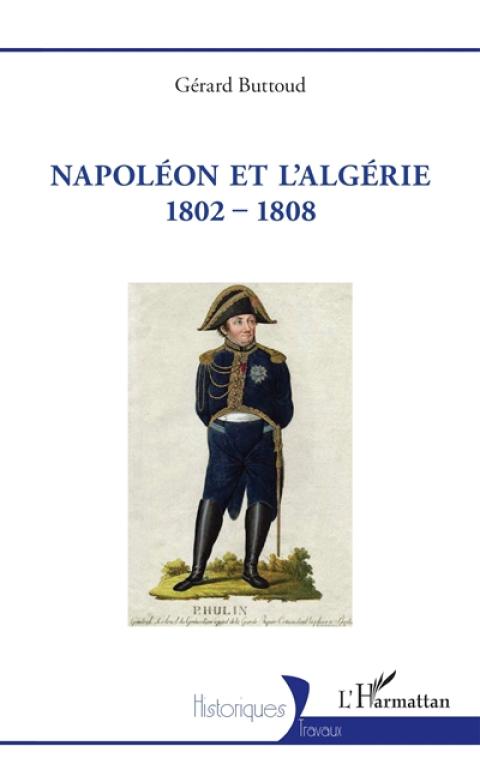
Ce court ouvrage, au titre un peu anachronique, puisque le terme d’Algérie n’est guère employé sous l’Empire (on lui préfère celui de Régence ou de Royaume d’Alger) ne traite pas moins d’une période intéressante. C’est celle que marquèrent les tensions entre l’Empereur Napoléon 1er, au faîte de sa puissance, et le pouvoir algérien, représenté par les deys, vassaux du sultan de Constantinople (on rappelle que quatre deys se succédèrent au cours de la période concernée, trois ayant été assassinés). Il convient de souligner que, depuis un siècle (1689), un traité de paix existait entre la France et la Régence et que cet état ne fut pas rompu par la Révolution, ni par Bonaparte. Au contraire, d’importants achats de blé avaient été conclus pour le ravitaillement de l’expédition d’Égypte de 1798, grâce à des prêts consentis par la maison algérienne des frères Bacri. Si le différend sur le règlement de ces prêts constitua une source de difficultés, nul ne croyait qu’il devait être le prétexte de la rupture survenue en 1827, à l’origine de la conquête.
Les principales causes de plaintes du côté français concernèrent, en fait, la sécurité des échanges maritimes menacée par les attaques des corsaires algériens menées contre des navires relevant de l’Empire, mais non explicitement français le plus souvent (génois, par exemple). Elles concernèrent aussi la saisie par le dey de la ville côtière de la Calle et des « Concessions d’Afrique », attribuées depuis deux siècles au commerce français (1802). Autant et plus qu’aux pertes proprement dites, relativement limitées, le gouvernement français était sensible à l’aspect arbitraire de ces saisies qui compromettaient la régularité du commerce et la sûreté des transactions. Il acceptait par ailleurs de plus en plus mal la tradition bien établie qui conférait aux souverains de l’Algérie la faculté de prélever des droits de douanes élevés et d’exiger des cadeaux pour prix de leurs bons offices. Napoléon, au surplus, raisonnait dans un cadre mondial : le Maghreb représentait un pion sur la route de l’Égypte et celle-ci un pion sur la route des Indes, source de la prospérité anglaise. Mais l’Empereur devait tenir compte aussi des priorités de sa politique en Europe, avec une suite de campagnes ininterrompues à partir de 1805 et l’extension constante de l’Empire. La défaite de Trafalgar qui imposa la suprématie navale britannique, rendait difficile, sinon impossible, toute intervention navale d’envergure.
Il reste donc de toute cette période une série de menaces adressées par Napoléon aux deys successifs, destinées surtout à accompagner des démarches diplomatiques qui, finalement, firent tomber la tension. Les projets d’intervention qui furent proposés ou préparés à l’initiative de l’Empereur lui-même succédaient à un grand nombre d’autres, bien rappelés par l’auteur, imaginés depuis le XVIIIe siècle, et tous également dépourvus de suites concrètes. Il faut cependant retenir que c’est au colonel Yves Boutin, envoyé par Napoléon à Alger (mai-juillet 1808), qu’est dû le premier véritable travail d’état-major précisant le lieu de débarquement (la plage de Sidi-Ferruch, à l’ouest d’Alger), l’itinéraire à suivre vers la ville, et définissant les moyens nécessaires à l’opération. Ce rapport, demeuré dans les archives, devait se révéler le document de base pour les responsables de l’expédition de 1830[1].
La bibliographie est assez complète pour permettre au lecteur curieux, et même au chercheur, d’aller plus loin dans la connaissance de la période. Elle néglige, on ne sait pourquoi, les livres toujours indispensables de Charles-André Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine. Tome I : La conquête et les débuts de la colonisation. 1827-1871, PUF, 1979, et Xavier Yacono Histoire de l’Algérie de la fin de la Régence turque à l’insurrection de 1954, Éditions de l’Atlanthrope, 1993.
On regrettera aussi une écriture aux tournures parfois exagérément familières.
[1] Voir Jacques Frémeaux, « Boutin et la conquête d’Alger », Napoléon 1er , n°19, mars-avril 2003, p.24-27.