

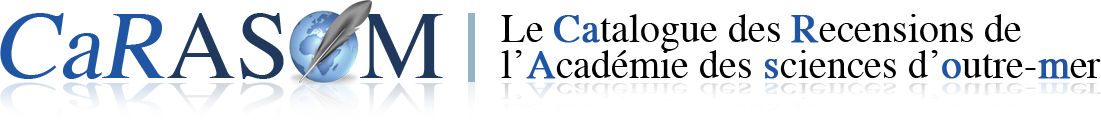
| Auteur | Sophie Boisseau Du Rocher, Christian Lechervy |
| Editeur | Odile Jacob |
| Date | 2025 |
| Pages | 306 |
| Sujets | Géopolitique Asie orientale 2000-.... Géopolitique Asie du Sud-Est 1970-.... Conditions économiques Asie orientale 1997-.... Mondialisation Asie orientale 2000-... |
| Cote | 69.252 |
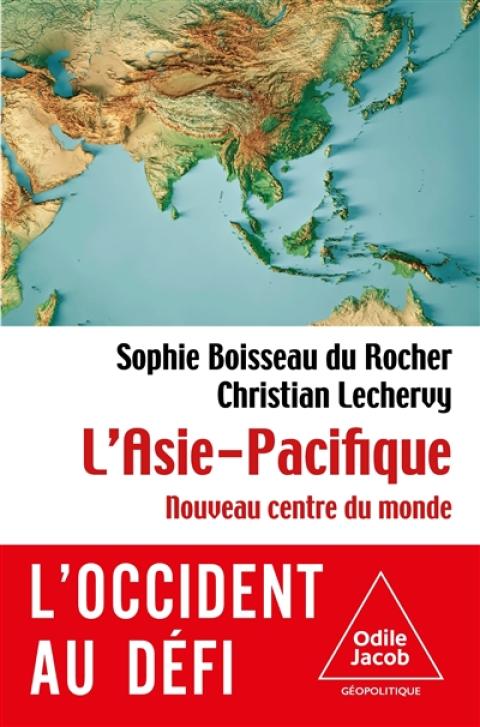
Dans ce livre de 307 pages, Sophie Boisseau du Rocher et Christian Lechervy s’intéressent à l’Asie-Pacifique, une région plus restreinte que celle dénommée Indo-Pacifique. Pour les deux auteurs, l’Asie-Pacifique comprend 17 États : Mongolie, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, Chine, Taïwan, Birmanie, Laos, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Brunei, Malaisie, Singapour, Indonésie, Timor Leste, Philippines. Rassemblant le monde sinisé, ces pays apparaissent utilement sur une carte en noir et blanc au début de l’ouvrage. Cette région composée de l’Asie du Nord-Est et de l’Asie du Sud-Est se trouve au carrefour de deux océans, l’océan Pacifique et l’océan Indien, dont les parties nord apparaissent sur la page de couverture.Les auteurs indiquent que la Chine inclut dans la zone Asie-Pacifique l’océan Pacifique dans sa totalité.
L’ouvrage se présente sous une forme originale, privilégiant des thèmes plutôt que des pays. L’introduction mentionne que cette région se trouve à l’origine de la désoccidentalisation du monde. Elle indique clairement que ce processus n’est pas seulement provoqué par l’émergence de la Chine mais qu’il se nourrit aussi de dynamiques anciennes, précoloniales et réactivées par les divers États de la région. La région Asie-Pacifique représente 60 % du PIB mondial et 60 % de la croissance mondiale. Fort de succès économiques, les puissances de l’avenir, et pas seulement la Chine, s’y trouvent. Elles retrouvent en fait la place qu’elles occupaient dans le monde avant l’arrivée des Européens. La Chine adopte une stratégie globale qui se manifeste d’abord dans son voisinage en Asie et dans le Pacifique. Elle affirme sa puissance avant tout dans le domaine économique sans négliger pour autant son armée. Mais le Japon assure un contrepoids. Pour les Asiatiques, l’Europe ne semble pas capable de les aider à résoudre leurs problèmes. Et les États-Unis les inquiètent. Globalement, l’Occident les déçoit mais ils ne s’en détournent pas.
Le chapitre 1 « De la périphérie au centre de l’économie-monde » commence par une citation d’un politologue américain d’origine indienne, Parag Khanna : « Au XIXe siècle, le monde était ‘européanisé’ ; au XXe siècle, il était ‘américanisé’ ; au XXIe siècle, il ‘s’asiatise’ ». Pour ce politologue, l’Asie connaîtra les plus grandes réussites économiques grâce aux technologies les plus avancées. Les pays d’Asie-Pacifique s’émanciperont des circuits occidentaux, devenant de plus en plus autonomes. La croissance s’établira par des marchés régionaux et la consommation intérieure. Selon la Cnuced, 60 % du trafic maritime mondial passent par l’Asie-Pacifique. Rassemblant 2,3 milliards d’habitants, les pays d’Asie-Pacifique s’affirment d’ores et déjà dans les domaines des télécommunications, des énergies renouvelables, de l’automobile et des nanotechnologies. Ils ne regardent plus l’Europe comme un modèle de modernité. Les places financières asiatiques, Shenzen, Shanghai, Hong Kong, Singapour, Séoul, Tokyo, s’affirment. En 2030, un tiers de la classe moyenne mondiale se trouvera en Asie-Pacifique. C’est dans cette région que l’on compte le plus de milléniaux, presque 800 millions, gros consommateurs et confiants dans l’avenir. Les pays vieillissants (Japon, Chine, Corée du Sud, Thaïlande, Singapour…) s’investissent de plus en plus dans les pays jeunes (Philippines, Vietnam, Indonésie, Cambodge…). Sur le plan économique, la région Asie-Pacifique est la plus dynamique du monde. La Chine, la Corée du Sud, Singapour et Taïwan se distinguent par leur haute productivité et leurs excellentes infrastructures.
Une bonne partie du trafic maritime mondial traverse l’Asie-Pacifique. Parmi les six plus grands ports du monde, cinq se trouvent en Chine. D’autres « superports » existent au Japon et en Corée du Sud. Des ports majeurs ont été créés en Malaisie, à Singapour, en Indonésie et à Taïwan. Presque 85 000 navires franchissent le détroit de Malacca chaque année. Les communications maritimes entre pays de la zone se développent rapidement. Les régions côtières se sont dotées de zones économiques spéciales, notamment en Chine du sud (Zhuhai, Shenzhen), en Corée du Nord (Kaesong) et Corée du Sud (Incheon). Le port taïwanais de Kaohsiung a été la première zone franche d’Asie, établie en 1966. L’Asie-Pacifique maîtrise le trafic de conteneurs. La Chine, le Japon et la Corée du Sud sont de grands constructeurs navals. Près de 54 % de la flotte mondiale se trouve en Asie-Pacifique.
Le dynamisme se traduit aussi par l’urbanisation. Depuis 2019, la population de l’Asie-Pacifique est majoritairement urbaine. Parmi les 30 plus grandes villes mondiales, 21 se trouvent en Asie-Pacifique. L’Asie-Pacifique se situe à l’avant-garde des smart cities, villes intelligentes recourant aux technologies de pointedans les domaines les plus divers (déchets, eau, mobilité, santé, sécurité…) grâce aux firmes Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi (BATX). Sur certaines lignes du métro de Pékin, le paiement se fait grâce aux empreintes palmaires, à Jakarta la reconnaissance faciale est utilisée dans les grandes gares, Songdo en Corée du Sud est gérée par un cerveau informatique. Simultanément, la surveillance s’intensifie par l’installation de caméras fabriquées en Chine, performantes et peu chères. Les villes chinoises disposent de milliers de caméras au kilomètre carré.
La région est soumise aux risques climatiques, subissant des périodes de très fortes chaleurs. Elle produit le plus de gaz à effet de serre au monde. La montée du niveau de la mer menace Jakarta, bientôt la ville la plus peuplée du monde. L’Indonésie se dote d’une nouvelle capitale, Nusantara sur l’île de Bornéo.
Produisant auparavant pour les marchés occidentaux, les pays d’Asie orientale produisent de plus en plus à présent pour leurs propres marchés. Les normes correspondent à leurs cultures. De ce fait, les firmes occidentales rencontrent une vive concurrence et perdent du terrain sur ces marchés les plus dynamiques au monde.
Les transports aériens régionaux se développent fortement. La compagnie malaisienne Air Asia se classe au premier rang des compagnies low cost depuis des années. Les besoins des compagnies d’Asie orientale s’élèvent d’ici 2040 à plus de 17 600 aéronefs, dont presque la moitié pour la seule Chine. La Chine, seul fabricant régional, met en service de nouveaux appareils réduisant sa dépendance à l’égard de Boeing et Airbus. Elle produit le moyen courrier C 919 et prépare un long courrier, CR 929.
L’Asie orientale représente un important marché pour les produits de luxe. Les firmes françaises y réalisent d’appréciables profits. Mais la concurrence apparaît en Chine, en Corée du Sud, à Taïwan et en Malaisie. Dans les ventes mondiales d’art contemporain, la Chine représente 32 %.
L’Asie-Pacifique dépend de moins en moins de l’Occident dans le domaine de l’innovation. Elle excelle dans le numérique. La Chine innove dans l’intelligence artificielle, la robotique, l’énergie, l’espace et les biotechnologies. Taïwan produit des semi-conducteurs dont 60 % partent en Chine. Les jeunes pousses d’Asie du Sud-Est se distinguent dans le commerce électronique, la technologie financière, la technologie de la santé et l’intelligence artificielle. Des coopérations existent entre la Chine et les pays d’Asie du Sud-Est. Les pays d’Asie-Pacifique figurent parmi les plus gros exportateurs de haute technologie, la Chine étant largement en tête.
Le chapitre 2 « Un modèle asiatique de développement » annonce d’entrée la confiance en l’avenir des pays d’Asie-Pacifique, fiers de leurs modèles de développement. Ils pourraient représenter 60 % de la croissance mondiale en 2030. Le facteur culturel explique leur réussite. Malgré la diversité entre pays, le confucianisme les a marqués directement (Japon, Corée, Vietnam) ou indirectement. Le succès repose sur l’importance de l’éducation, le respect de l’autorité et la loyauté, des caractéristiques communes à une « civilisation sinisée ». Singapour ajoute même des cours d’éducation morale. Dans le classement Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), les pays d’Asie orientale occupent les premiers rangs. Le culte de la performance et l’ultra compétitivité sont omniprésents, avec un corollaire négatif, le suicide des jeunes à Hong Kong, en Corée du Sud, au Japon et à Singapour. Grâce au rôle des États, partout en Asie-Pacifique, des réformes agraires expliquent l’absence de problèmes alimentaires majeurs. L’industrialisation a fait l’objet d’impulsions gouvernementales. Le Japon a été le premier pays à s’industrialiser et a servi de modèle, œuvrant à une véritable régionalisation par imitation. La Malaisie a développé avec succès le secteur électronique dans l’île de Penang qui détient désormais 7 % du marché mondial des semi-conducteurs. Les actions de technocrates compétents expliquent la réussite de Singapour. La bonne gouvernance à Singapour comme au Japon et ailleurs a permis aux États de faire de bons choix. Les subventions aux exportations, notamment en Corée du Sud, à Taïwan et en Chine ont généré de la croissance, permettant de soutenir le processus d’exportation sur les marchés mondiaux. Partout, les interactions entre le secteur public et le secteur privé ont facilité les innovations. La majorité des investissements proviennent de la région Asie-Pacifique elle-même. Le Japon consacre les deux tiers de son aide publique au développement à la région Asie-Pacifique. Comme la Chine, le Vietnam a créé un capitalisme mixte. Ses principales exportations vers les États-Unis portent sur les produits de haute technologie. Ayant signé 16 accords régionaux de libre-échange, il commerce activement avec l’Association européenne de libre-échange, avec Israël et les Émirats arabes unis. L’Indonésie connaît une croissance régulière depuis 25 ans et exporte du charbon, du gaz naturel, du nickel, du cobalt, de l’huile de palme et du caoutchouc. Sa dette publique reste en dessous de 40 % de son PIB. Elle se dote de bons réseaux autoroutiers et ferroviaires. L’économie numérique connaît un remarquable essor favorisé par une population jeune (30 % des 280 millions d’habitants ont moins de 25 ans). Les pays d’Asie-Pacifique ont fait le choix de l’ouverture régionale. Beaucoup aux États-Unis accusent le Japon d’avoir provoqué leur désindustrialisation et de se comporter en partenaire commercial déloyal.
Le chapitre 3 « Le recentrage asiatique » mentionne la montée en puissance de la régionalisation en Asie orientale. Plus de 60 % des échanges commerciaux se font à l’intérieur de la région. Les investissements directs étrangers proviennent majoritairement de la région. La Chine et le Japon sont les principaux investisseurs, suivis de la Corée du Sud et de Singapour. À l’origine de la régionalisation se trouvent des acteurs privés, soutenus ensuite par les États. L’Union européenne renonçant aux souverainetés nationales n’a pas servi de modèle. L’harmonisation des procédures se fait sans atteinte aux souverainetés des États. Les diasporas chinoises s’impliquent dans les échanges régionaux. Au Japon, les Chinois représentent la communauté étrangère la plus nombreuse et, bien accueillis, se montrent très actifs. L’Asian Bond Market Initiative (ABMI) instaure un marché obligataire régional en monnaies locales. Un accord d’échanges de devises impliquant les pays de l’Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), la Chine, le Japon et la Corée du Sud permet de mettre en commun des réserves. La création d’un Fonds monétaire asiatique préconisé par le Japon est régulièrement envisagée, mais les États-Unis et même la Chine s’y opposent.
La Chine s’efforce de convaincre ses partenaires régionaux à dédollariser les transactions. Hong Kong s’implique dans la création de nouveaux instruments financiers. L’usage du yuan gagne du terrain. La Chine est un bailleur régional dans le cadre des routes de la soie. Créée par les Chinois, la Banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures (BAII) constitue un important instrument d’influence pour Pékin. En 2021, la Chine et l’Indonésie ont conclu un accord pour utiliser leurs monnaies nationales dans leurs échanges commerciaux. La Chine et la Thaïlande pourraient faire de même. Depuis 2023, les pays de l’ASEAN utilisent leurs monnaies dans les échanges commerciaux entre eux.
La Chine s’affirme comme le principal partenaire commercial de la plupart des pays d’Asie-Pacifique. Un accord de libre-échange associe la Chine aux membres de l’ASEAN. Le Japon s’engage en faveur d’un accord commercial avec l’ASEAN. Un accord-cadre de coopération économique lie la Chine à Taïwan. Conclu en 2020, le Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) regroupant 15 pays (les 10 pays membres de l’ASEAN, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande), mais excluant la Corée du Nord et Taïwan, est le plus important accord commercial au monde. L’Asie annonce ainsi son libre-échangisme en éliminant 90 % des droits de douane. Le RCEP contribue à favoriser les échanges entre pays asiatiques et à réduire ceux avec les pays occidentaux. La Chine joue un rôle décisif.
Le Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) signé en 2018 inclut 11 pays : Australie, Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam. Il ne revêt pas l’importance du RCEP. La Chine et Taïwan ont posé leur candidature, la première posant comme condition l’exclusion du second. Leur adhésion a peu de chance d’aboutir.
L’Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) datant de 2022 comprend 14 pays : États-Unis, Japon, Inde, Australie, Brunei, Corée du Sud, Indonésie, Fidji, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam. Ce n’est pas un accord de libre-échange mais un processus d’intégration dans l’économie numérique, les chaînes d’approvisionnement, les énergies vertes et la lutte contre la corruption.
Le TransPacific Partnership (TPP), conclu en 2016, comprend 12 membres dont seulement cinq appartiennent à la région, Brunei, Japon, Malaisie, Singapour et Vietnam, les 7 étant extérieurs, Australie, Canada, Chili, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, États-Unis (ces derniers se sont retirés en 2017).
Il convient de noter que le RCEP, le CPTPP, l’IPEF et le TPP incluent des membres extérieurs à l’Asie orientale. Les trois derniers, initiés par les États-Unis, excluent la Chine. En réalité, les pays de l’Asie-Pacifique ne souhaitent pas la diabolisation de la Chine et expriment leur méfiance à l’égard des États-Unis.
De plus en plus, les universités asiatiques se placent bien dans les classements internationaux et sont sollicitées par les étudiants asiatiques. Elles bénéficient d’investissements importants. Les universités chinoises accueillent 200 000 étudiants originaires de l’Asie du Sud-Est. Les universités japonaises, singapouriennes et sud-coréennes reçoivent, elles, de plus en plus des étudiants chinois. La mobilité estudiantine s’accroît comme le soulignent bien les auteurs. Ces jeunes voient leur avenir en Asie.
Le chapitre 4 « Vers une Pax asiatica ? » traite les aspects sécuritaires. La Chine récuse la présence américaine et affirme que la sécurité de la région doit être assurée par les Asiatiques eux-mêmes. Elle revendique des territoires de l’Inde à la Russie. L’Asie-Pacifique connaît d’importants flux maritimes. Après l’échec de l’Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est (OTASE), les États-Unis ont conclu des alliances bilatérales, et ont organisé des forums et dialogues. Le traité de sécurité conclu entre les États-Unis et le Japon en 1951 a été révisé en traité de coopération mutuelle et de sécurité en 1960. En vertu de ce traité, 54 000 soldats américains stationnent au Japon. Il accorde aussi des bases aux États-Unis. En 1951, un traité de défense mutuelle a été signé entre les États-Unis et les Philippines. Jusqu’en 1992, les Américains disposaient de cinq bases aux Philippines. Un traité de défense mutuelle a été conclu entre les États-Unis et la Corée du Sud en 1953, à l’issue de la guerre de Corée. En 2024, 28 500 soldats stationnaient en Corée du Sud. Un partenariat entre les États-Unis et Singapour conclu en 1990 permet aux Américains d’utiliser des installations dans la cité-État.
Après avoir décrit le dispositif américain en Asie orientale, les auteurs analysent la montée en puissance de la Chine dans le domaine de la défense. Ayant échoué dans sa guerre contre le Vietnam en 1979, la Chine a modernisé ses forces armées, plus qu’aucun autre pays. Elle pourrait prendre l’ascendant dans le Pacifique dès 2027, grâce notamment à un programme de construction de porte-avions et de sous-marins. Avec ses missiles à longue portée, la Chine pourrait frapper le territoire américain depuis les mers qui la bordent sur 14 000 kilomètres. La coordination inter-armées a progressé. Toutefois, l’accès de la marine chinoise vers le grand large reste problématique à cause de la barrière que constitue le détroit de Bashi entre Taïwan et les Philippines.
Sur le plan diplomatique, la Chine a élaboré des partenariats stratégiques avec l’Indonésie en 2013, avec la Thaïlande en 2015, avec les Philippines en 2018. Les auteurs n’indiquent pas la détérioration des relations entre Pékin et Manille qui rend caduc le lien sécuritaire entre les deux pays. Le Cambodge entretient des relations étroites avec la Chine et lui accorde des facilités portuaires. La base de Ream pourrait recevoir des militaires chinois, comme celle de Djibouti. Quant à la Thaïlande, elle ne considère pas la Chine comme une menace et achète des armements chinois.
Face à l’arsenal chinois, la marine américaine garde un avantage technologique mais l’a perdu sur le plan quantitatif. Elle multiplie les exercices pour rendre visible sa présence et effectue des patrouilles pour assurer la liberté de circulation. Les États-Unis réactivent le concept de l’Indo-Pacifique. Ils recherchent avec leurs partenaires une meilleure interopérabilité. Ils affirment que Taïwan est un allié majeur. Ils resserrent leurs liens en matière de sécurité avec lesPhilippines qui accordent grâce à un accord conclu en 2014 à la marine américaine la possibilité de disposer d’installations militaires sur 9 sites (les 5 bases qu’elle possédait jusqu’en 1992 et 4 nouvelles) considérés comme essentiels pour assurer la défense des Philippines mais aussi de Taïwan. Une alliance, l’AUKUS, rassemble depuis 2021 l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Un dialogue sécuritaire, le Quad, réunit depuis 2023 les États-Unis, l’Australie, le Japon et l’Inde.
L’Europe ne possède aucune troupe en Asie orientale. Ses États membres cherchent à vendre leurs armements. Les pays asiatiques, ne voulant pas choisir entre les États-Unis et la Chine, souhaitent une présence européenne. De fait, l’Europe participe au Forum régional de l’ASEAN établi en 1994 et depuis 1996 au dialogue biennal avec l’Asie dans le cadre des Asia-Europe meetings (ASEM). Un partenariat stratégique rassemble depuis 2020 l’ASEAN et l’Union européenne. Cette dernière a adopté une stratégie indo-pacifique en 2021. Néanmoins, l’Europe dispose de peu de moyens sur zone. Les pays asiatiques en sont conscients.
Trois zones conflictuelles se perpétuent en Asie orientale : Taïwan, Corée du Nord et mer de Chine méridionale. Taïwan constitue un bastion occidental, un centre de renseignement et un lieu de stockage de matériels. Taïwan possède aussi dans l’archipel des Spratleys une île, Taiping, disposant d’eau potable et pouvant accueillir des submersibles. La Corée du Nord, alliée à la Chine par un traité conclu en 1961 et renouvelé en 2021 pour 20 ans, et à la Russie par un accord global de coopération stratégique signé en 2024, s’affirme sur le plan militaire. Elle déclare posséder un sous-marin nucléaire d’attaque depuis 2023. Elle a mis sur orbite en 2024 un satellite d’observation militaire. Ses programmes balistiques et nucléaires progressent. Elle possèderait environ 100 têtes nucléaires et en construit de nouvelles (peut-être jusqu’à 300 dans les prochaines années). La menace nord-coréenne ne s’applique pas seulement à l’Asie mais s’étend aux possessions américaines dans le Pacifique et même au territoire continental américain. En mer de Chine du Sud, la Chine a lancé des assauts contre des installations militaires vietnamiennes dès 1988 et philippines en 2012. La mer de Chine du Sud intéresse la Chine pour ses richesses halieutiques, ses réserves en hydrocarbures, ses gisements miniers et bien sûr pour son intérêt militaire. La Chine s’implante dans les archipels Paracels conquis contre le Vietnam en 1974 et Spratleys. Elle y construit des installations militaires, des ports et aéroports. Imposant une stratégie du fait accompli, elle veut assurer la sécurité des navires de guerre, notamment des sous-marins, stationnés dans la base de Sanya, au sud de l’île de Hainan. Opérant par sa marine, ses garde-côtes et ses milices, la Chine harcèle en permanence les États riverains de la mer de Chine méridionale. Elle n’a tenu aucun compte du jugement émis par la Cour permanente d’arbitrage en faveur des Philippines. Elle défie le droit de la mer, contestant notamment la légalité du passage inoffensif des navires de guerre dans les mers territoriales. Elle proteste lorsque les navires de guerre des États-Unis, de la France et d’autres pays franchissent le détroit de Taïwan.
La Chine adopte les principes de Sun Tzu, estimant que le combat doit être le dernier recours. Pékin accuse Washington de pratiquer une guerre froide. Les pays de l’ASEAN s’accommodent en commerçant avec la Chine et en ayant des relations de sécurité avec les États-Unis. Ils ne sous-estiment pas la menace chinoise et s’efforcent de l’amortir. Une tâche difficile car la Chine agit avec dextérité sur deux tableaux, la force militaire et la diplomatie. Le Japon et la Corée du Sud coopèrent sur le plan militaire. Certains pays se rapprochent de la Chine, d’autres des États-Unis. Mais le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et les Philippines expriment un certain doute à l’égard de l’engagement américain.
Dans cette période d’incertitude, d’affirmation de la puissance chinoise, tous les pays de la zone renforcent leurs appareils de défense, modernisant notamment leurs bases industrielles et technologiques mais recourant aussi à des importations de systèmes haut de gamme. La Corée du Sud transforme sa marine en véritable force océanique. Un porte-avions devrait entrer en service en 2033, des sous-marins de conception nationale sont en cours de fabrication. Elle envisagerait peut-être même de se doter de sous-marins à propulsion nucléaire. L’armée de l’air dispose de 500 avions de combat. Un avion multirôle, de conception nationale, devrait entrer en service en 2026. Le Japon se réarme en développant son industrie de défense notamment pour de nouveaux avions de combat et des missiles à longue portée. L’Indonésie, le Vietnam et la Birmanie ne sont pas en reste. La France a vendu des sous-marins à la Malaisie et fait des propositions de ventes de systèmes d’armes à l’Indonésie et aux Philippines. Mais la Corée du Sud s’affirme comme le principal vendeur d’armes y compris de haute technologique aux pays de la région, l’Indonésie, les Philippines et la Thaïlande comptant parmi ses plus importants clients. Le Japon aussi s’affirme dans l’exportation d’armement, fournissant notamment des navires et des radars côtiers à la Malaisie et aux Philippines. Les circuits d’armement s’asianisent. Par ailleurs, les exercices militaires se généralisent. Et Tokyo propose une alliance trilatérale Japon-Philippines-États-Unis.
Le chapitre 5 « Développement politique : le défi d’autres trajectoires » affirme que la désoccidentalisation s’exprime aussi dans le domaine politique. La greffe occidentale n’a pas prise. Bien que les sociétés refusent les régimes autoritaires, les procédures démocratiques n’ont pas été copiées. Néanmoins, Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et l’Indonésie adoptent certains principes démocratiques occidentaux. Des dynasties politiques s’installent au Japon, en Indonésie, en Chine, au Cambodge, en Thaïlande et aux Philippines. Les modes de fonctionnement de l’économie ne copient pas l’Occident. La Chine, affirmant que son système favorise davantage la croissance que les démocraties, inspire certains pays d’Asie orientale. Des États-partis ont vu le jour au Vietnam, au Cambodge, à Singapour, en Malaisie, et même au Japon (dans ce pays, le parti libéral a presque toujours dominé l’exécutif). La Thaïlande a subi une régression politique. Au Japon, la liberté de la presse diminue et la participation électorale chute (elle dépasse à peine les 50 %), les abstentions concernant surtout les jeunes. La démocratie n’apparaît pas comme nécessaire à la modernité. Elle est souvent perçue comme étant corrompue et instable, comme l’affirment la Chine et d’autres pays. Elle est de plus coûteuse. À Singapour, la restriction des libertés publiques se justifie pour maintenir l’ordre et la croissance. En Chine et ailleurs, la croissance constitue la priorité.
Le chapitre 6 « L’Asie-Pacifique, discours régionaliste et construction idéologique » aborde la question identitaire. L’Asie-Pacifique cesse d’admirer l’Occident et le rejette de manière argumentée. Les colonisations européennes puis américaines ont produit des chocs violents et influencé les regards que les Asiatiques portent sur eux-mêmes et sur le monde. Les pays de la région ont très tôt réfléchi à leurs racines historiques et leurs traditions communes. Au début du XXe siècle, le Japon prônait l’idéologie panasiatique, reprise plus tard par la Chine, l’Indonésie et le Cambodge. La conférence des relations asiatiques tenue à New Delhi en mars 1947 soulignait l’identité asiatique. Les pays de la région préconisent le consensus et accordent la priorité aux convergences. L’Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), créée en 1967 par la Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines et Singapour, élargie en 1984 avec Brunei (ce qu’oublient de mentionner les auteurs), en 1995 avec le Vietnam, en 1997 avec la Birmanie et le Laos et en 1999 avec le Cambodge, consacre la volonté des pays d’Asie du Sud-Est de régler leurs problèmes eux-mêmes, en se soustrayant aux influences communistes et américaines, pacifiquement, en respectant la souveraineté de tous. L’ASEAN s’est affirmée au plan régional et aussi sur la scène mondiale. L’ASEAN Regional Forum (ARF), l’East Asia Economic Association (EAEA), l’ASEAN + 3 et le Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) participent de la même logique de concertation. La création à Singapour d’un Institut pour les philosophies d’Asie orientale mérite d’être soulignée.
Les politiques américaine et européenne d’imposer les droits de l’homme et les normes démocratiques sont d’autant plus mal perçues que les pays occidentaux ne sont pas exempts de critiques dans ce domaine.
Les auteurs reprennent les critiques de la démocratie faites par la Chine (énoncées dans le chapitre précédent). Selon la Chine, la démocratie ne garantit nullement un avenir meilleur. Les résultats qu’elle a obtenus pour sortir de la misère des millions de gens, pour l’éducation, pour la sécurité, prouvent la supériorité de son système. Elle utilise Confucius pour créer un fonds de civilisation commun dans la région.
Dans le chapitre 7 « L’Europe à la recherche de sa juste place » les auteursaffirment que l’Europe s’intéresse à l’Asie-Pacifique mais qu’elle manque de confiance. La désoccidentalisation de cette région ne doit pas conduire à son effacement. Les pays de l’Asie orientale considèrent que l’Europe leur est utile car elle fait preuve de modération et contribue ainsi à assagir les États-Unis. Sans abandonner leur demande de démocratisation, les pays européens accordent la priorité aux relations économiques. L’Europe reste solidaire des États-Unis et partage globalement les mêmes vues en ce qui concerne l’Asie orientale. Au contraire, celle-ci apparaît divisée, certains pays affichant leur proximité avec la Chine et d’autres leur rapport privilégié avec l’Occident. L’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) concerne les relations entre les pays asiatiques et les États-Unis alors que les Asia-Europe meetings (ASEM) portent sur les relations entre les pays asiatiques et l’Europe. L’APEC et l’ASEM ne sont en réalité que des clubs de discussion. Les pays européens ne participent pas aux sommets de l’Asie orientale mais l’Europe reste un partenaire économique important. Sur le plan de la sécurité, les États-Unis et l’Europe se retrouvent ensemble avec les pays de l’Asie du Sud-Est au sein de l’ASEAN Regional Forum (ARF).
Dans la conclusion intitulée « La désoccidentalisation de l’Asie-Pacifique : risque et opportunité », les auteurs constatent que le processus de distanciation avec l’Occident relève d’une logique d’autonomie et d’émancipation naturelles. Les Américains et les Européens ont longtemps nié leur déclin. La modernisation de l’Asie-Pacifique se fait sans occidentalisation. Deux pays d’Asie orientale affichent des ambitions globales, le Japon sur un mode pacifique et la Chine de manière offensive.
*
* *
Ce livre décrit parfaitement les mécanismes de montée en puissance des pays d’Asie orientale, leurs distanciations à l’égard des États-Unis et de l’Europe et leurs interactions. Les logiques, les mécanismes et les ambitions du processus de construction régionale méritent toute notre attention. L’ouvrage sera sans nul doute utile aux experts comme aux non-initiés.
La Chine occupe une place prépondérante dans l’ouvrage, ce qui ne saurait surprendre. Mais « l’arbre chinois ne saurait cacher la forêt asiatique » comment l’affirment les auteurs.La réussite de la Chine ainsi que celle de nombreux autres pays de la zone Asie-Pacifique expliquent la confiance en l’avenir dont font preuve les populations que soulignent à juste titre les auteurs.