

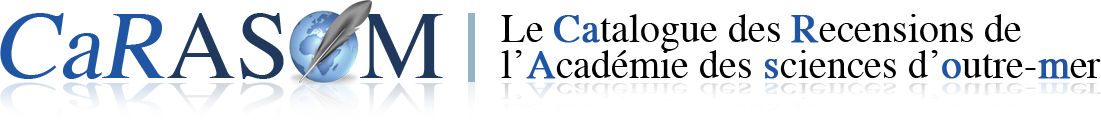
| Auteur | Carole Diop, Xavier Ricou |
| Editeur | de l’Aube |
| Date | 2024 |
| Pages | 351 |
| Sujets | Politique urbaine Dakar (Sénégal) Rénovation urbaine Dakar (Sénégal) Urbanisme Dakar (Sénégal) Urbanisme durable Dakar (Sénégal) Patrimoine culturel Dakar (Sénégal) |
| Cote | In-4 2348 (Delafosse) |
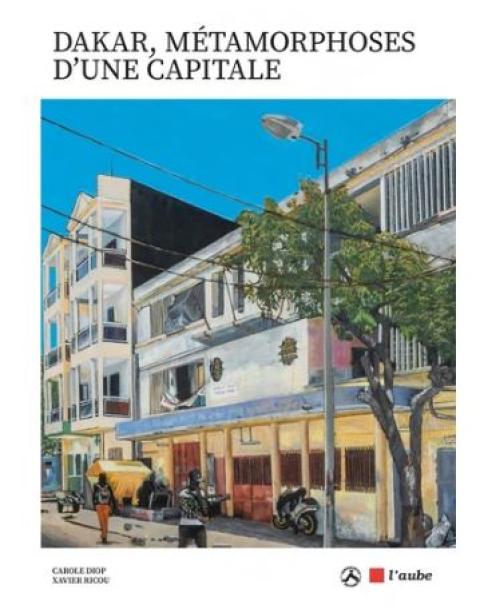
Dakar, métamorphoses d’une capitale est un livre d’architectes. Réalisé à l’initiative de la chaire d’Économie urbaine de l’ESSEC, il est l’aboutissement d’un projet piloté par Carole Diop et Xavier Ricou avec les contributions de quatre autres architectes, tous Sénégalais ou Français ayant des liens affectifs et professionnels très forts avec Dakar.
Un mot du maire, Barthélémy Toye Dias, une préface de l’écrivain Felwine Sarr, introduisent un ouvrage qui présente à la fois un tableau des transformations de la capitale sénégalaise depuis ses origines, une réflexion sur ses défis d’avenir et un « catalogue raisonné des bâtiments et sites remarquables », objet d’un ultime chapitre. Ce dernier comprend 457 photos numérotées de bâtiments avec leur adresse. Leur localisation figure sur 35 photographies aériennes couvrant l’espace bâti. Cette iconographie exceptionnelle constitue un inventaire unique du patrimoine architectural de Dakar, à la fois témoignage mémoriel et document au service des acteurs de la production urbaine. La réalisation de ce projet éditorial a bénéficié de l’appui de nombreux sponsors, diversement concernés par la vie quotidienne des Dakarois, la promotion du tourisme international ou l’aménagement d’une agglomération de près de 4 millions d’habitants.
Le livre, dans sa matérialité, présente en lui-même une forte architecture. Des pages de couleurs vives, vert, rouge, jaune, bleu introduisent les deux parties et 9 chapitres qui le composent. Le bleu distingue aussi les encadrés des contributeurs : « Le peuple Lebu » de Abdou Khadre Gaye, « Bioclimatisme 2.0 » de Caroline Geffriaud, « L’architecture néo-soudanaise entre architecture coloniale et africaine » d’Alyssa K. Barry, et un « Entretien avec Thierry Melot ». C’est aussi la couleur du manifeste signé Carole Diop et Xavier Ricou qui clôt la première partie « Qu’est notre Dakar devenue ? Manifeste pour sauver son âme ». Les deux auteurs s’insurgent contre la nouvelle « face hideuse » de leur ville, où les lieux de mémoire sont « victimes de la furie destructrice des marchands de sommeil qui transforment la ville en une gigantesque cité sans âme » avec « ses forêts d’immeubles de verre, sans identité, sans style, mal adaptés au climat, mal construits et mal entretenus ». Ce cri du cœur de deux amoureux de Dakar, ce cri d’alarme donnent tout son sens à un livre engagé dont le but est de porter à la connaissance la richesse et la diversité d’un patrimoine architectural édifié depuis la fondation de Dakar en1857, aujourd’hui menacé par une urbanisation de masse irrespectueuse des traces du passé.
La première partie, « Épopée urbaine d’une presqu’île mythique » décrit en 200 pages et 6 chapitres les métamorphoses de la ville, suivant un plan chronologique. Un premier chapitre, « avant la ville », évoque l’arrivée des Lebu au Cap Vert, leur organisation en « une sorte de république parlementaire » indépendante du Cayor en 1801, leur place dans l’imaginaire dakarois.
Suivent deux chapitres, « Fondation et développement (1857-1918) » et « Extension des limites (1918-1938) » consacrés à l’implantation de la ville coloniale sur le « Plateau » que le plan d’urbanisme Pinet-Laprade dote du réseau viaire qui structure encore l’extrémité de la péninsule.
Le chapitre « transformation du tissu urbain (1938- 1970) » escamote curieusement l’indépendance qui n’apparaît que dans le chapitre suivant « Dakar indépendante (1970-2000) », sans que l’on comprenne la raison de ce découpage chronologique décalé.
Le chapitre final « Empêtrée dans le présent et tournée vers le futur (depuis 2000) » traite des transformations contemporaines du « Grand Dakar ».
Ce tableau des « métamorphoses » de Dakar s’appuie sur une riche iconographie, notamment de très nombreuses cartes postales, provenant de collections privées (Ricou, Crespin, Trottet). La plupart ne sont malheureusement pas datées, ce qui en limite la portée documentaire. Quelques illustrations n’ont ni date ni source. La cartographie est abondante mais pas toujours très lisible (reproduction de documents anciens), souvent à grande échelle, celle d’un quartier, d’un lotissement, par exemple, qu’il n’est pas aisé de situer dans l’ensemble urbain dont l’extension est par ailleurs difficile à suivre faute de cartes de synthèse simplifiées et claires. L’histoire des transformations urbaines manque parfois de rigueur, y compris dans la chronologie (les parcelles assainies des années 1950, par exemple, n’ont rien à voir avec les programmes d’ajustement structurel de la Banque mondiale quelques décennies plus tard). C’est la rançon d’une prestation à plusieurs voix pas toujours en parfaite cohérence les unes avec les autres.
Le chapitre 6 portant sur les transformations contemporaines est sans aucun doute le plus novateur, associant les grands travaux qui reconfigurent l’agglomération dakaroise à une analyse critique des modes d’urbanisation. Les auteurs dénoncent la « frénésie urbaine » et la « course effrénée au profit », la privatisation du littoral sur la côte ouest prisée par les hôtels internationaux, l’étalement d’une « banlieue de béton grise, sans végétation, sans identité et sans âme », la monstrueuse décharge de Mbeubeuss qui empoisonne l’environnement.
Comme toutes les métropoles africaines, la capitale sénégalaise est confrontée au défi de la mobilité, des embouteillages automobiles, des carences des transports collectifs, défi accru par les contraintes du site, l’étroitesse du Cap Vert faisant du « Plateau » un entonnoir, et par l’engorgement d’un port saturé, avec ses défilés incessants de camions et ses nuisances industrielles qui « rendent urgent de repenser la place du port dans la ville ». Quelques pages sont dédiées aux infrastructures les plus importantes, aux grands chantiers entrepris depuis les années 2010, sous l’impulsion du Président Macky Sall : autoroute en direction du nouvel aéroport Blaise Diagne à Diass, remplaçant celui de Yoff ; ville nouvelle de Diamniadio, conçue pour accueillir 350 000 habitants, ministères, universités etc…, reliée au centre-ville par un TER, mais qui peine encore à trouver ses marques ; port en eau profonde de Ndayane et projet de ville nouvelle de Daga-Kholpa. La reconfiguration du Grand Dakar aurait mérité une présentation plus structurée que la simple énumération des travaux réalisés. Les critiques envers les défaillances de la planification ou un plaidoyer pour « désapprendre » l’architecture internationale, condamnant le béton et la climatisation, font perdre de vue le projet d’ensemble de l’actuelle métamorphose de Dakar.
La deuxième partie intitulée « Une capitale culturelle », revient dans le chapitre 7 sur la question du « patrimoine exceptionnel mais en danger » en soulignant la grande variété des styles architecturaux successifs, néo-classique, orientaliste, brutaliste, art-déco, néo-soudanais, international… et sur les menaces de sa disparition, l’exemple emblématique étant la démolition du marché de Sandaga en 2021. Les auteurs déplorent que la Pointe des Almadies subisse depuis des décennies « les agressions perpétrées par des opérateurs de tourisme » ou que « l’ex plus belle corniche d’Afrique » soit « sacrifiée aux dieux de la promotion immobilière ».
Le chapitre 8 enfin, « Dakar point chaud culturel », évoque le rôle particulier de Dakar dans le domaine artistique, héritage de Léopold Sedar Sendgor : École des arts en 1960, théâtre national Daniel Sorano, premier festival mondial des Arts nègres en 1966, aujourd’hui biennale de l’Art africain contemporain alternant avec « Gorée, regards sur cours ». Le kaléidoscope dakarois s’achève sur cette ouverture culturelle. Mais que peut la culture face à l’explosion démographique de la capitale sénégalaise, à la pression foncière et à la spéculation immobilière ?
Les auteurs ne proposent pas de solution en restant dans le registre de la nostalgie. Leur livre restera avant tout le catalogue illustré d’un riche patrimoine architectural, avec l’espoir que la publicité qui lui est ainsi donnée contribuera à le sauvegarder.
NB : Je ne retiendrai pas ce livre pour un prix en raison des réserves que j’ai émises, nonobstant l’importance de la nomenclature et de l’illustration.