

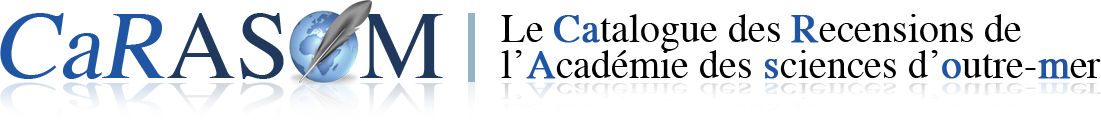
| Auteur | Ella Shohat ; traduit de l'anglais par Joëlle Marelli |
| Editeur | EHESS |
| Date | 2025 |
| Pages | 189 |
| Sujets | Judéo-arabe (langue) Juifs Identité collective Pays arabes |
| Cote |
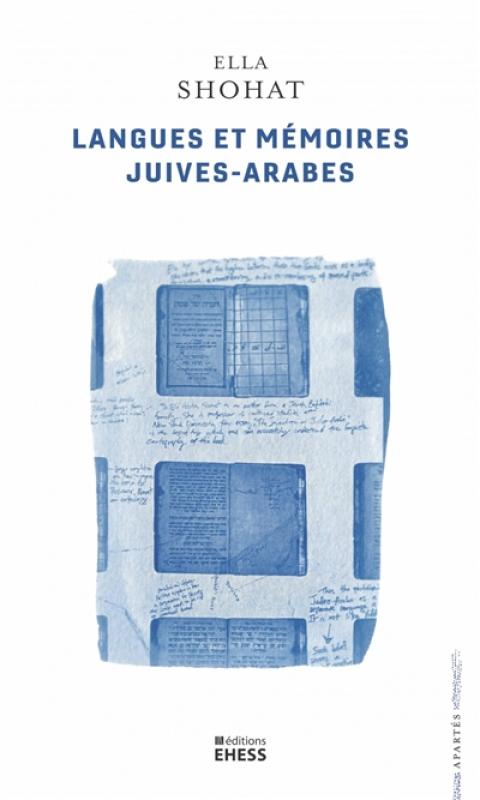
Ella Shohat, propose ici dans la collection Apartés des éditions de l’EHESS un recueil de textes autour de son thème de prédilection, la mémoire juive-arabe, à l’exception du dernier « perdre ses cheveux, perdre la mémoire » qui mêle à sa réflexion des analyses qui relèvent plutôt de l’art contemporain.
Ella Shohat, qui vit à New-York et y enseigne, est une juive israélienne d’origine irakienne et elle s’est attachée à rappeler l’importance du judaïsme en terre d’Islam et la qualité de la cohabitation entre juifs et musulmans. L’importance du judaïsme irakien a été largement documentée (par exemple par Esther Meir-Glitzenstein « juifs et musulmans en Irak des origines à nos jours », éditions Tallandier 2022) et Ella Shohat apporte bien des informations utiles. On sait peu et on peine à imaginer aujourd’hui que jusqu’en 1950, Bagdad était à 25% une ville juive.
L’excellente connaissance de la culture juive irakienne permet à l’auteur de décrire de manière fort intéressante les échanges linguistiques entre les différents niveaux de judéo-arabe irakien, de dialectes irakiens et le melting-pot des emprunts dans la littérature et la chanson populaire.
Naturellement, le moteur d’Ella Shohat est politique. Il y a d’abord la nostalgie et la blessure irréparable d’un paradis perdu de cohabitation judéo-arabe en Irak et d’un arrachement. Il y a surtout le ressentiment à l’égard du discours fondateur de l’État israélien, fondé en grande partie par des « blancs » d’Europe de l’Est et qui ont voulu nier l’apport des juifs arabes. Elle dénonce l’embarras israélien à admettre les heures heureuses de la vie des juifs en terres musulmanes et le problème que pose à beaucoup de sionistes la figure même du juif arabe alors que l’arabe est devenu, après tant de guerres et d’attentats, la figure de l’ennemi.
Ces réflexions sont justes et profondes et les informations qu’apporte Ella Shohat sur ce monde judéo-arabe quasi disparu donnent à penser en effet que rappeler ce passé pacifique permettrait de sortir des logiques de haine. On peut regretter que, sans doute pour épouser la mode et les tendances politiques des campus américains, Ella Shohat se soit fait annexer par les discours « post-coloniaux », ce qui n’enlève rien à l’intérêt de ses informations sur la problématique, appuyée sur une connaissance érudite du judaïsme irakien et des dialectes de Bagdad et Mossoul, mais colore son discours sur un sujet qu’elle connaît bien de connotations idéologiques qui le desservent.
On n’en dira pas autant de la pathétique préface de la traductrice Joëlle Marelli, galimatias post colonialiste woke, truffé de concept creux et de formules amphigouriques destinés à cacher la vacuité de la pensée, le militantisme haineux et parfois, quasiment, la justification du terrorisme. En annexant Ella Shohat à un discours woke sans respect pour son véritable apport universitaire pour ne retenir que la logomachie anticolonialiste, les éditions de l’EDHESS qui d’ailleurs utilisent l’écriture sectaire soi-disant inclusive au point de rendre la lecture pénible, n’ont probablement pas rendu service à l’auteur ni aux valeurs universalistes de la recherche universitaire.