

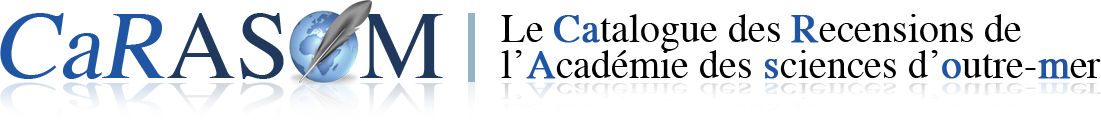
| Auteur | Giuliano da Empoli |
| Editeur | Gallimard |
| Date | 2025 |
| Pages | 151 |
| Sujets | Prévision technologique Dystopies Pouvoir (philosophie) Despotisme Essai de langue française XXIe siècle |
| Cote | 69.604 |
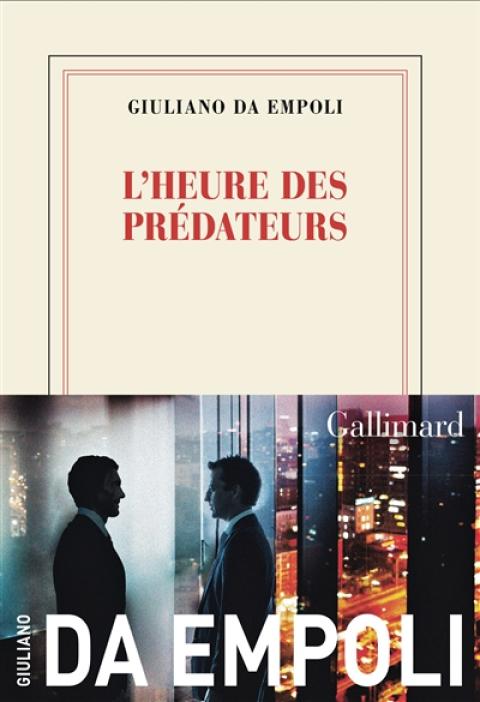
Les images se pressent à l’esprit pour évoquer le flamboyant, très italien dernier essai de Giuliano da Empoli, « l’heure des prédateurs ». Est-ce une méditation sur la marche de l’Histoire, avec ses marées humaines alternant flux et reflux, époques d’attaque et époques de défense ? Est-ce une réflexion sur la violence protéiforme de l’État et du Prince à travers les âges ? Une galerie de portraits de personnages du monde, riches en couleurs et volonté de puissance ? Pour les besoins de sa démonstration - et pour sa mise en scène digne d’un opéra de Verdi -, Da Empoli prétend se glisser dans la peau d’un scribe aztèque du XVIe siècle, observateur des derniers jours de liberté de son peuple (pourtant l’un des plus puissants et avancés de son époque), subjugué par des conquistadors à peine débarqués de leurs caravelles. Sur Moctezuma son dernier empereur, le jugement du scribe est sans appel : par pusillanimité et aveuglement, Moctezuma cause la perte des siens. Il n’avait pourtant, face à lui, qu’une poignée de soudards, sous les ordres d’Hernan Cortez. Mais leur apparition inédite aux commandes de chevaux, armés de tromblons et d’escopettes (toutes choses jusqu’alors inconnues en Amérique Latine), avaient tétanisé le peuple Aztèque et son leader : « pris en étau, dit Da Empoli, entre les avis opposés (de ses conseillers), Moctezuma fit ce que les politiques, de tout temps, font en ce genre de situation : il décida de ne pas décider […] Le résultat fut celui qui, de tout temps, a tendance à découler de ce genre d’hésitation : ayant voulu éviter la guerre au prix du déshonneur, Moctezuma eut et le déshonneur et la guerre »…
Le fil rouge du livre est donc l’action des dirigeants de tous pays et toute époque, quand ils sont confrontés à l’inconnu. Leur prudence devient peur du risque, fuite et réponse dilatoire là où seule la clairvoyance et la bravoure auraient permis d’éviter la catastrophe - invariablement après coup, l’agresseur s’avère bien moins fort qu’il n’apparaissait. L’existence d’un peuple riche et hors de ses gardes, mal préparé - voire disposé - à se défendre, génère des appétits : des candidats au pouvoir s’élèvent, pragmatiques et opportunistes, qui trouvent dans la faiblesse ambiante l’audace nécessaire à la conquête, moyennant l’imposition d’un ordre nouveau. Sous cette perspective, cette histoire des aztèques apparait une parabole de notre époque. Da Empoli tente de nous prévenir que la malédiction de Moctezuma est en train de se reproduire sous nos yeux. Nos sociétés européennes risquent le même châtiment d’une prise de pouvoir par l’internet et l’intelligence artificielle : les nouveaux conquistadors, les « prédateurs » sont une poignée de faux prophètes de l’informatique. L’incompétence et la lâcheté des classes dirigeantes de l’Ouest, tous partis confondus, met leurs pays à risque, pour n’avoir pas osé brider l’internet, ni mettre l’IA et leurs inventeurs sous le joug de la loi. Pour les besoins de sa démonstration, l’auteur fait succéder une série de scènes alternant personnages et actions, aidé en cela par une faconde brillante et une érudition sans faille.
Premier tableau à New York, dans l’édifice dessiné par Oscar Niemeyer pour abriter les palabres des Nations Unies. Ce « Palais de verre » des 193 pays membres, da Empoli le connaît comme sa poche, pour en avoir durant des années hanté les couloirs dans le sillage de ministres français ou italiens qu’il servait comme « sherpa » ou conseiller. L’ambiance qu’il y décrit est une cacophonie, causée par le choc de leaders aux egos surdimensionnés. Tous, « même celui du Tuvalu » partagent l’inébranlable conviction d’être le centre du monde. Dans un style tanguant entre rigueur pascalienne et satire bouffonne, da Empoli daube ces politiciens de carrière, invariablement inaptes à faire passer les besoins ou la morale universels avant l’intérêt de son pays, ou de sa propre carrière.
En septembre 2024 à l’ONU, une initiative française tente d’arracher à Israël une trêve à son impitoyable guerre à Gaza, sous prétexte d’obtenir la libération des otages kidnappés par le Hamas. Les chances sont infimes, vu le soutien des États-Unis à Israël, l’intérêt personnel de Netanyahou d’éviter tout procès suite au retour à la paix, et l’intérêt du Hamas de garder ses otages comme monnaie d’échange. Contre toute attente pourtant, en fin de journée, Paris semble avoir obtenu gain de cause, un « deal » prévoyant un cessez le feu immédiat. Le chef d’État israélien est censé venir à New York signer le lendemain matin - le temps du voyage en avion. Mais l’annonce du deal aura été une fausse nouvelle, et toute cette agitation, une journée des dupes : le lendemain matin, pas de Netanyahou à la tribune, la guerre continue, l’accord tombe à l’eau.
Second Tableau, à Florence autour de 2010, autour d’une fresque de Léonard de Vinci reproduisant la violence d’État telle que vue à l’époque de la Renaissance. Da Empoli saisit ce prétexte pour étayer sa réflexion sur la guerre vue à travers l’évolution technologique. Selon lui, en fonction des moyens techniques, à travers le monde et selon les époques, la paix règne quand les moyens de défense sont les plus forts, et la guerre éclate dès que prévalent les moyens offensifs. Avant Leonardo, en Italie, les fortifications suffisent à repousser la plupart des attaques. Mais quand apparaissent les canons à boulets de fonte, elles deviennent inopérantes. C’est alors qu’attaquent les armées de François 1er, aguerries par leur artillerie et un siècle d’expérience acquise sous la Guerre de cent ans : les Français peuvent envahir le Piémont, mettant fin à une longue ère de paix.
De la même manière, après 1945, la bombe atomique apporte la dissuasion, et 70 ans de paix mondiale. Puis l’instabilité revient sous l’effet d’innovation technologique réduisant le coût des agressions. La destruction des tours jumelles à New York n’a coûté à Ben Laden qu’un petit million de dollars, et en 2025, pour tout drone à 200$ tiré par le Hezbollah depuis le Sud-Liban, Israël doit mettre à feu un missile Patriot au prix de 3 millions de $. C’est dire que dans l’art de la guerre, le pendule paix-guerre a rebalancé vers l’attaque, redevenue plus tentante que la défense. Or, avec l’attaque, c’est l’ordre établi qui chancelle, c’est-à-dire chez nous, la démocratie. Ce qui pousse da Empoli à conclure que « comme au temps de Léonard, les défenseurs de la liberté paraissent singulièrement mal préparés à la tâche qui les attend ».
Ces progrès techniques inspirent et lancent à travers la Terre une nouvelle espèce de leaders populistes. Tel « MBS », Mohamed Ben Salman. Par ruse et violence, l’héritier saudien n’a besoin que de quelques mois pour faire disparaître du royaume l’entièreté de la classe qui tenait le pays, et de réaffecter ses richesses vers ses propres plaisirs ainsi qu’une série de projets géants rapidement hors contrôle. Un autre dictateur d’un genre nouveau est Nayib Bukele, élu en 2019 président du Salvador - à 37 ans. Le Salvador est alors le plus violent pays du monde, sous la coupe de puissants gangs de la drogue et du rapt que les deux partis traditionnels ont été incapables de combattre. Bukele imagine une méthode radicale pour nettoyer le chancre du pays : « remplacer le code pénal par un manuel de tatouage illustré ». Puisque les 80.000 gangsters, sûrs de leur impunité, marquent leur statut par des tatouages sur tout le corps, Bukele instaure l’état d’urgence et les fait tous flanquer, les 80.000 mafiosi, dans une prison de haute sécurité, qu’il fait ensuite filmer dans d’invraisemblables scénarios torse nus, recroquevillés en rang devant la caméra pour mieux montrer les tatouages et la déchéance de leurs porteurs. Le résultat aura été un retour immédiat à la paix au Salvador. Ainsi que la reconnaissance sans limite des citoyens qui, au prochain scrutin de février 2024, réélisent Bukele triomphalement avec 84% des voix. La nouvelle serait sympathique, si elle ne sanctionnait, ici aussi, un grand bond en arrière pour la démocratie, pouvant préfigurer un modèle mondial. Brrr…
La suite du livre est tout aussi captivante. Elle propose des pistes pour interpréter le retour de Trump avec des arguments pour comprendre, sinon justifier sa victoire sans appel à deux reprises, sur des démocrates à court d’idées et un système socio-politique en panne. Elle se penche sur les caractéristiques et méthodes de ces nouveaux prédateurs que l’auteur décrit comme « borgiens », de César Borgia, le sanglant dictateur devenu héros du « Prince » de Machiavel. Ils visent le chaos, favorable à leur révolution. Ils n’aiment pas les discours, à part les leurs. Ils n’aiment pas lire non plus. Trump, par exemple, ne lit « pas les notes d’une page, voire d’une demi-page que lui remettent ses conseillers avant un entretien. Il ne fonctionne qu’à l’oral… Ce qui compte est l’action, dont la connaissance est l’un des pires ennemis. Un environnement chaotique exige des décisions audacieuses qui captivent l’attention du public, tout en sidérant les adversaires ». Da Empoli ajoute que Trump, « analphabète fonctionnel, peut atteindre une forme de génie dans sa capacité à résonner avec l’esprit du temps ».
De même, les Borgiens font dans le concret, et promettent de résoudre les vrais problèmes du peuple, criminalité, immigration, coût de la vie. Face à eux, aux USA, les démocrates parlent de règles, de démocratie en péril, de minorités et de morale. En 2020, Kamala Harris mettait en son programme aux primaires démocrates l’abolition de la police des frontières et un financement pour le changement de sexe des détenus et immigrants illégaux : thématique grisaillante, très éloignée des préoccupations des petites gens. Elle causa aux présidentielles de 2024 la défaite sans appel que l’on connait, face à Trump.
Da Empoli atteint son point culminant en analysant le métavers, le monde des données sous les seigneurs de la tech : « pour la première fois, dit-il, ces conquistadors se sentent assez fort pour déclarer la guerre aux anciennes élites ». On pense ici bien sûr d’abord à Elon Musk qui a misé sur la campagne de Trump 100 milliards de $ qui ont été déterminants dans sa victoire. L’ouvrage va surtout se pencher sur Eric Smith, le dirigeant de Google au début des années 2000 qui en a fait le colosse actuel. En 2011, il met Google à disposition de la campagne de réélection d’Obama. Durant des mois, des dizaines d’ingénieurs du groupe sont prêtés, avec d’autres de toute la Silicon Valley. C’est l’opération Narval qui va identifier sur internet quasiment tous les 70 millions d’Américains ayant voté pour lui avant le 1er mandat. L’effort de Narval va alors porter sur les scores de probabilité des États charnière de nouveaux soutiens (entre 45 et 55%). Maison par maison, chacun de ces votants ainsi identifié va alors recevoir un message adapté à ses idées et à ses intérêts. De la sorte, la réélection de 2012 sera gagnée haut la main.
Mais le prix à payer sera démesuré : dans cette campagne, la qualité des arguments a compté moins que celle des logiciels ; la victoire n’a pas été de nature politique, mais technique. Et surtout, après cela, ni Obama ni les États-Unis n’auront plus rien à refuser à Google ni à la Silicon Valley. Le Parti démocrate a oublié d’imposer la moindre règle aux plateformes sur lesquelles va désormais se dérouler la vie politique de la nation. Pas la moindre responsabilité n’est déployée pour contrôler les « nerds », princes de l’internet et autres nouveaux maîtres du jeu. Ce parti au pouvoir restera même indifférent, je cite, « lorsque le match se déplacera sur le terrain de l’intelligence artificielle… C’est grâce aux patrons de Google et de Microsoft qu’au lieu de se développer sous la houlette du gouvernement, comme ce fut le cas pour les armes atomiques et autres technologies militaires, l’IA se déploie à présent sans contrôle, aux mains d’entreprises privées qui s’élèvent au rang d’États-nations » : l’ère des prédateurs est ouverte !
Cette IA a évidemment le potentiel de confisquer le pouvoir à ses inventeurs. Elle partage bien des traits communs avec les autocrates moyenâgeux et les Borgiens. Comme eux, elle gère un pouvoir reçu par sidération. Comme eux, elle se nourrit du chaos, en extrait la surprise et ne s’embarrasse ni de règles, ni de procédures. « Plus qu’artificielle », remarque da Empoli,elle est une forme d’intelligence autoritaire, qui centralise les données et les transforme en pouvoir… Dans l’opacité totale, sous contrôle d’une poignée d’entrepreneurs et de scientifiques qui chevauchent le tigre en espérant ne pas se faire dévorer ». De la sorte, l’auteur prédit que« le clivage décisif devient celui entre l’humain et la machine ». Quels aspects de la vie réserver à l’intelligence humaine, à l’IA ou à une collaboration entre les deux ? Curieusement, Giuliano conclut qu’en cas de choix « en faveur de l’humain, là où une IA aurait pu garantir plus d’efficacité, il y aura un prix à payer. » Serait-ce une manière de contester la vérité acquise, selon laquelle la liberté n’a pas de prix ? (fin)