


| Auteur | Olivier Cosson |
| Editeur | Olivier Cosson |
| Date | 2013 |
| Pages | 379 |
| Sujets | Guerre des Boers (1899-1902) Influence Guerre russo-japonaise (1904-1905) Influence Guerres balkaniques (1912-1913) Influence Militaires France 1870-1914 Art et science militaires 1870-1914 Planification militaire France 1870-1914 |
| Cote | 59.169 |
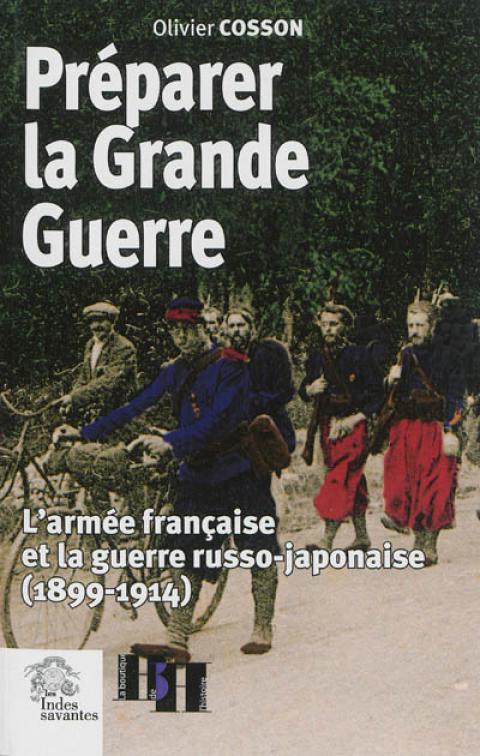
Olivier Cosson, historien de notre Grande Guerre, fait ici, de son sujet préféré, une approche bien pertinente. Les 45 années de paix qui ont précédé la Première Guerre mondiale ont été vécues par les militaires français dans une attente à la fois impatiente et anxieuse. Comment donc se sont-ils préparés à « la prochaine » ? Que la Première Guerre mondiale ait été une folie criminelle – ce que ne fut pas, du côté allié, la Seconde –, la cause est entendue. Ce n’est pas cette stupidité-là qui intéresse l’auteur, mais une autre, stupidité dans la stupidité : la doctrine de guerre française est pour beaucoup dans l’affreux massacre d’août 1914.
Nos stratèges avaient pourtant du grain à moudre. Trois guerres leur en ont donné, Boers contre Anglais en Afrique du Sud, Japonais contre Russes en Mandchourie, mélange confus de peuples en révolte contre les Ottomans dans les Balkans. De façon significative, seule la guerre russo-japonaise retint leur attention. Les deux autres nous apparaissent pourtant, instruits que nous sommes par le cours de l’histoire, de plus grande portée. Les Boers luttent pour leur indépendance, ils mènent la guérilla, inventent les « kommandos », traquent les collabos et recrutent des résistants, cependant que les Anglais élaborent une contre-guérilla – Kitchener est leur Gallieni –, inaugurent les camps de concentration et pratiquent la terre brûlée. Dans les Balkans compliqués – l’auteur éclaire peu ce qui, à vrai dire, ne saurait l’être tout à fait –, la sauvagerie est à nos portes et on l’y retrouvera à la fin de notre XXe siècle. Tout cela n’est pas de saison. C’est la guerre classique qui intéresse nos observateurs. Ils la voient en Mandchourie, pratiquée par les Russes à l’ancienne, par les Japonais à la moderne c’est-à-dire sous un déluge de feu.
L’auteur titre l’un de ses chapitres comme Raymond Aron son Clausewitz. Il se trompe. Ce n’est pas à « penser la guerre » que s’appliquent nos militaires, mais à répondre à la question : en dépit des conditions nouvelles du combat, comment encore guerroyer ? Certains, pas tout à fait idiots, et même en notre haut état-major, osent mettre en cause la guerre elle-même, « si l’on ne peut attaquer et vaincre, à quoi bon partir en campagne ? ». Pétain, discrètement, s’annonce comme un modèle de lucidité. Le feu tue, martèle-t-il ; comment éviter le massacre, voilà la question. Jaurès est sur la même ligne, apôtre de la dissuasion populaire.
Pour les autres, que les armes modernes et la mobilisation générale des citoyens rendent la guerre immaîtrisable, c’est ce qu’il ne faut pas accepter. Le colonel Grandmaison tient la solution, qui deviendra le catéchisme nouveau, simple rajeunissement de l’ancien. Il faut en finir avec les incertitudes. L’offensive à outrance est le remède, foncer oblige à ne plus penser. Foin de la mitraille, attaquons ! Attaquons ! Comme des c…, lui répond l’écho. Ce choix stratégique, si l’on ose l’appeler ainsi, s’accorde avec le goût français du sacrifice et de la jolie mort, debout et tête haute. La guerre à l’horizontale – couchés, casqués, en habit couleur de terre, terre dans laquelle on s’enfouit –, très peu pour nous ! C’est en pantalon rouge qu’on marchera.
En août 14, Grandmaison est le chef du 3e bureau de Joffre. Dès le deuxième mois de guerre, on « limoge ». Pour excès d’audace ? Pas du tout, pour pusillanimité. On s’en sortira, tant bien que mal, sur la Marne. On imaginait la guerre courte, c’est parti pour quatre ans. On voulait galoper, la stagnation s’impose. Le plus dur reste à venir, braves poilus. Pétain attend son heure.
Les recensions de l' Académie des sciences d'outre-mer sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrite.
Basé(e) sur une œuvre à www.academieoutremer.fr.