

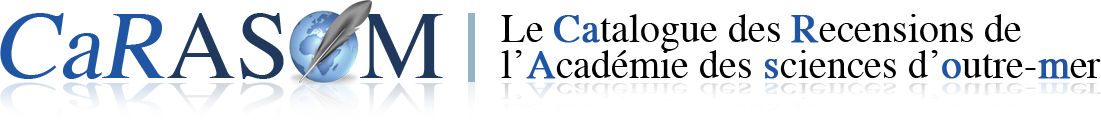
| Auteur | Abdelmajid Kaddouri ; [traduit de l'arabe par Abdelhak Lamsalmi] |
| Editeur | la Croisée des chemins |
| Date | 2012 |
| Pages | 303 |
| Sujets | Maroc Histoire Maroc Relations Europe Europe Relations Maroc |
| Cote | 59.245 |
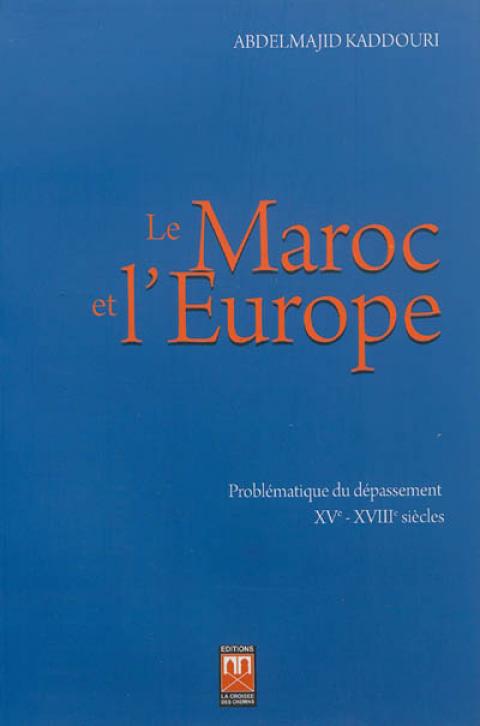
Dans cet ouvrage traduit de l’arabe, Abdelmajid Kaddouri éclaire d’un regard nouveau
un chapitre de l’histoire du Maroc allant de la prise de Ceuta par les Portugais (1415) au règne
du sultan réformateur Mohammed ben Abdellah (1757-1790). Par une analyse fondée sur la
notion de dépassement, il entend mettre en évidence les raisons pour lesquelles le royaume
fortuné s’est trouvé dans l’incapacité de faire face aux défis de la modernité et de résister à la
suprématie européenne consécutive aux grandes découvertes. Il s’est mis en quête d’identifier
les facteurs qui ont compromis le développement du pays. Il en a cherché l’origine à la fois
dans des ingérences externes et dans des entraves internes.
L’occupation ibérique des ports a eu pour effet de négliger les affaires maritimes et de
s’exclure du commerce mondial tandis qu’une préférence était maintenue pour le trafic
caravanier. Dans le même temps, le pouvoir s’attribuait le monopole des échanges extérieurs,
accompagné au détriment des commerçants locaux d’un soutien aux négociants étrangers que
la diplomatie européenne cherchait à favoriser. D’autres facteurs relèvent du plan interne : le
poids des crises politiques et des catastrophes naturelles (épidémies, famines), la discontinuité
dans l’exercice du pouvoir, l’inexistence de règles de succession, l’influence des confréries
religieuses qui passaient de l’assistance mutuelle à l’affrontement, le désintérêt des détenteurs
de capital pour le processus d’accumulation, le système d’enseignement, appuyé sur la religion
et la mémorisation. Tout cela contribuait à freiner les tentatives de changement inscrites dans
la perspective d’un développement.
Pourtant à la fin du XVIIIe siècle, Mohammed ben Abdellah qui avait accédé au
pouvoir grâce à l’unanimité des Marocains, manifeste la volonté de créer un Maroc moderne
par un renouvellement de ses structures. Il entreprend de consolider l’institution du Makhzen,
de réformer la justice dans sa logique islamique. Il se préoccupe de garantir par l’éducation et
un encadrement religieux la stabilité de l’État et de la société. Son désir d’édifier un espace
atlantique et de s’intégrer à l’environnement international s’incarne dans la fondation du port
d’Essaouira. Malgré la réalité de ses efforts, la modernité n’est pas au rendez-vous.
Pour mieux en comprendre les raisons, il est bon de rappeler les conditions énoncées il
y a quelques dizaines d’années par W.W. Rostow pour que le développement puisse véritablement s’effectuer. La phase décisive du développement est celle du « décollage »
(auquel la dénomination d’« émergence » est aujourd’hui préférée). Elle implique un faisceau
substantiel de bouleversements et d’innovations aux niveaux politique, économique, social et
culturel qui se conjuguent pour entraîner le pays dans un processus de développement. Faute
de quoi, le démarrage ne se produit pas et à cet égard la thèse de Rostow a le mérite de mettre
en évidence les phénomènes qui participent au blocage de la croissance. Au Maroc, les
conditions propres à déclencher et soutenir le développement se heurtaient à une situation
globalement peu favorable : la société n’était pas préparée au changement ; ses bases
économiques et culturelles étaient inadaptées ; l’enseignement refusait l’expérimentation. Par
ailleurs, le pouvoir disposait d’une liberté d’action atténuée par des conventions diplomatiques
avantageant les intérêts étrangers. Les conditions de la modernité n’étaient réunies pour
produire un mouvement continu et accumulé de développement.
De nos jours, le décalage Europe-Monde arabe persiste et à l’issue d’un travail de
synthèse rigoureux l’auteur pose en filigrane la question de savoir si son pays va rester
fatalement dans l’inaptitude de suivre l’Europe !
En langue arabe et s’appuyant sur des sources marocaines, il a avec intérêt renouvelé le
sujet en faisant appel à de nombreuses références tirées d’historiens arabes et de ce fait peu
connues des spécialistes français. Néanmoins la traduction a entraîné quelques désagréments :
la graphie de certains noms européens a été estropiée et des confusions naissent du mélange
des ères chrétienne et musulmane. La qualité de l’ouvrage a été reconnue puisqu’il a bénéficié
du soutien de l’ambassade de France au Maroc.