


| Auteur | Metka Zupancic |
| Editeur | Karthala |
| Date | 2013 |
| Pages | 342 |
| Sujets | Littérature Femmes écrivains Histoire et critique Féminisme Dans la littérature Mythologie Dans la littérature |
| Cote | 58.837 |
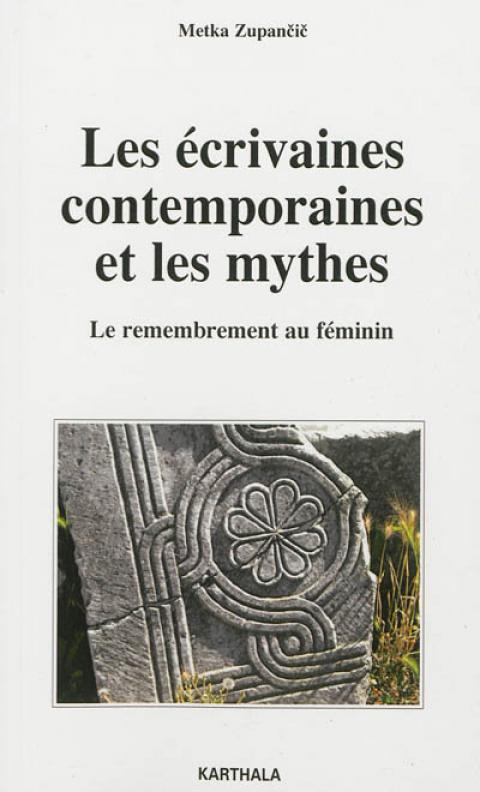
Professeur de French / Modern Language à l’Université de Lettres d’Alabama, la slovène d’origine, Metka Zupanéiè, francophone passionnée, plonge le lecteur dans les abysses de mythes féminins à travers les œuvres d’une dizaine de femmes
écrivaines - elle est attachée à la féminisation du mot - vivant entre l’Ontario, le Québec, la Tunisie, la France et la Belgique. Après un long travail de maturation, elle s’est livrée à une variation sur le thème du rassemblement du corps féminin ou du remembrement des parties éclatées de ce corps symbolique. D’après les archétypes féminins, elle s’est mise à la recherche des « rhizomes », des connexions visibles ou cachées. Par remembrement, dans l’imaginaire orphique auquel l’auteure (c’est le terme que l’on gardera au cours de la recension), s’est consacrée dans ses propres œuvres (L’Orphisme réécrit au féminin Montréal 1995), elle entend l’opération de rassemblement du corps éclaté et de la mémoire au féminin. Les mythes sont semblables à la variété des corps humains, étant des systèmes où tout se tient, où aucune particule ne peut exister indépendamment de l’autre.
À travers ses essais, elle analyse ses consoeurs francophones dans la perspective du renouveau constant des paradigmes anciens, et dans leur rôle de
« réveilleuses des consciences », « de guérisseuses de plaies que nous portons en nous de génération en génération ». Des figures sont revues depuis celle d’Eurydice avec une transposition du dépeçage d’Orphée par les Ménades ou de Philomèle, violée par son beau- frère qui lui coupa la langue et la tint prisonnière, et communiquant par son tissage, à sa sœur Procné, l’horreur de son sort et le nom de son bourreau. Précisons qu’Ovide a décrit la mansuétude de Zeus la changeant en hirondelle, ce qui expliquerait, bien qu’elle n’aille pas jusqu’au bout du mythe, que l’œuvre de tisserande soit pour Metka Zupanéiè, l’emblème « de la femme artiste transposant son art guérisseur en parole alternative ». Mais outre ces rapports masculin–féminin, l’auteure, dans un autre contexte, s’attarde sur les rapports mère–fille avec les généalogies féminines. Elle nuance cependant : toute la littérature féminine contemporaine de ces auteures ne vise pas le remembrement. Mais dans son champs d’investigation, elle tente de retrouver « la force unificatrice derrière toutes ces différences scripturales, philosophiques ou intellectuelles ». Toujours à la recherche de l’Amour avec une majuscule comme elle le souligne, elle en déchiffre la trace dans les secrets quotidiens de l’amour passion dévastatrice, dans la quête du double platonicien comme Hélène Cixous dans son Philippines ; la gémellité chez France d’Amour, la Canadienne, avec le respect de l’autre dans sa civilisation et celui de la nature chez Pierrette Fleutiaux, organisatrice de L’Expédition.
Mythes classiques revisités aussi, transposés comme celui d’Ariane. Et elle nous conduit dans le dédale des interprétations renouvelées depuis le classique Dictionnaire des symboles de Chevalier et Gheebrandt. Dans son ouvrage surabondant et luxuriant, riche en notations psychanalytiques et littéraires, Metka Zupanéiè, pour déchiffrer la condition anthropologique de notre état d’humain, considère que la littérature, déclinant ses objets thérapeutiques « peut être utilisée comme espace privilégié de l’activité mentale, émotive et spirituelle des femmes ». Ainsi le mythe d’Isis serait-il revenu à l’horizon des perceptions contemporaines toujours dans le sens du remembrement. L’accent remis sur l’importance de la spiritualité féminine chez ses écivaines choisies, l’auteure insiste sur le « révisionisme » de leur mythologie des années 80. Et son choix s’explique par leur originalité dans le décodage des mythes évoqués plus haut et un essai de mise en relief des difficultés issues des différences, croyances ou refus des croyances. Elle perçoit « la force simplificatrice de la féminité repensée, porteuse d’amour, de sagesse en plus, incarnée dans les corps avec les implications qu’entraîne un tel engagement global. Metka Zupanéiè dans son « approche du mythe antique » revisité, oppose le corps d’Orphée, démembré par les Ménades, à l’opération de reconstruction d’Isis sur celui d’Osiris, redevenu « capable d’engendrer » Horus et donc « guérisseuse ».
Et dans le processus romanesque, elle constate qu’un autre voyage est entrepris par la femme écrivaine contemporaine : une intériorisation du parcours, une découverte de soi On assiste donc à la fin du roman - masculin de la conquête sociale : celui de Stendhal avec son Julien Sorel tendu vers la réussite ou des héros balzaciens. Mais en toute honnêteté, elle s’interroge sur la typologie féminine de Flaubert avec sa Madame Bovary, avide de promotion sociale au point de rater l’amour et sa vie. Elle démontre enfin qu’elle a retrouvé tous ces mythes : Eurydice, Démeter, Perséphone, Ariane, Athéna, Marie et Marie-Madeleine dans cette constellation d’écrivaines qu’elle présente au lecteur.
Le livre de Souad Guellouz, Tunisienne francophone est considéré comme « une thérapie par le récit, par l’écriture, par la lecture ». Myriam ou le rendez- vous de Beyrouth (1996), l’a profondément « ébranlée ». Dans l’aventure de cette Myriam- Perséphone, partie à la recherche de son amie Mary-Ann O’Hara, médecin, Américaine et volontaire dans l’enfer de Beyrouth en guerre. Elle veut la retrouver et la ramener à son amant, Riadh, un peintre druze, mutilé d’un bras et qui soigne sa plaie et ses traumatismes à Sidi- Bou-Saïd où vivent le mari, Mustapha et les enfants de Myriam. Elle se substitue donc à cet Orphée empêché pour retrouver l’amie et l’amante. Mais l’engagement de Mary-Ann auprès des blessés et sous les bombes, ne fait pas d’elle une fugitive après la tentative de viol d’Aristée. Plutôt qu’une touchante Eurydice, il s’agit de l’archétype d’Artémis, nouveau rôle de femme indépendante au secours de l’humanité. Souad Guellouz, dans sa narration, participe donc au « processus guérisseur » évoqué dans l’introduction ; mais il faut noter que l’auteure des essais s’est, à plusieurs reprises, plainte de l’effacement des femmes au sein de l’Olympe des dieux et des déesses, et de leur rôle secondaire dans les mythes classiques qui, peut être, étaient la représentation d’une société patriarcale.
Avec Fabienne Pasquet, on est à la recherche des archétypes féminins. Née d’une mère franco- russe et d’un père haïtien, actrice, traductrice puis dramaturge, dans un ouvrage Au fil du fer (2004), elle avait tenté d’établir « d’une manière fascinante, la généalogie féminine des forgeronnes » et, partant de là, des alchimistes, autre thème favori de M Zupanéiè. Mais dans Le Récit de Madeleine (2005), un pont est lancé entre « les forgeronnes, sorcières devenues thérapeutes, voyantes conscientes des mondes possibles » et un autre mythe, celui de Marie-Madeleine avec une réécriture de la place de la femme dans la chrétienté. Elle n’est plus la pécheresse de la Bible. Dans le recensement de sa place dans les bibliothèques, plus de 2 .800 ouvrages lui ont été consacrés. Celui-ci, même après le Da Vinci Code, cité dans l’essai, a le mérite de l’originalité. Marie de Magdala fut abandonnée au soir de ses noces par Jean- Baptiste car il veut suivre le « Grand papillon » Jésus. En parallèle se forge le paradigme d’une femme qui « mise tout sur un homme tout en se donnant à tous les hommes ». Dans le même temps, elle se rend utile par ses dons de guérisseuse, soignant avec les plantes et soulageant Jésus sur la croix du Golgotha où elle a suivi Marie. Fabienne Pasquet insiste sur la femme « qui a tout donné et qui est reconnue donneuse », sorcière devenue thérapeute.
Autre figure de femme forte, celle d’Athéna ou l’œuvre au noir, mise en scène dans Une belle éducation(2006) par France Théoret, Québécoise reconnue pour avoir la voix la plus solide dans la défense de la cause des femmes. Engoncée dans un milieu à la limite du sordide, son héroïne Evelyne, qui s’élève par sa volonté et « la seule force de l’esprit » jus qu’au professorat, est l’archétype d’une nouvelle Athéna. S’était créé un véritable processus alchimique de transmutation jusqu’au nigredo, le noir de la matière, lié à la mort suivi de la régénération .Ne pouvant se reposer ni sur sa mère ni sur son père, donc « ni matricide, ni parricide », elle sera entravée dans son processus de libération de la misère, culpabilisée dans son succès par les valeurs chrétiennes de l’humilité enseignées par les religieuses, dans une société du Québec marquée dans les années 50 par le patriarcat étouffant et la domination de l’Eglise catholique. La nouvelle Athéna ne sortira donc pas du cerveau de Zeus, sa mère n’étant pas non plus une autre Métis, mais une femme falote. L’auteure s’appuie sur son expérience post- jungienne pour décrire dans le récit de France Théoret, cet « idéal de la femme intellectuelle qui par la parole, par l’écriture » fera son chemin, « à travers les ténèbres psychiques » qui lui rappellent L’oeuvre au noir de Marguerite Yourcenar.
L’auteure salue chez Francine d’Amour, la prose à la fois limpide et d’une intensité rare de son Retour d’Afrique, écrit en 2004. Il retrace la descente aux enfers orphiques modernes d’une Eurydice bien particulière. Rongée par l’alcool et la solitude, Charlotte dialogue dans son cœur avec son Orphée, Julien, parti discrètement mourir d’un cancer en Egypte. Loin du « fleuve vert » où il s’éteint, dans la froideur de Montréal, elle rencontre le locataire de son mari, grâce à Maria, son amie qui l’a conduite à une conférence de cet égyptologue, Iskander, un Egyptien. Et dans « le cheminement littéraire, intellectuel et spirituel des femmes contemporaines », elle va revivre le destin d’Hatchepsout, la grande reine « qui fut allaitée par les déesses ». Se dessine aussi l’image d’Hathor, la déesse à tête d vache. Aspirée par son amour pour Julien, Charlotte va partir le retrouver, menée par Iskander, double de Julien, mais les événements du 11 septembre empêchent son envol de New- York et elle y apprend la mort de son mari. Elle ne sera pas l’Isis qui reconstitue le corps d’Osiris et ne pourra accomplir son travail de « rassembleuse ».Mais elle reste, comme dans les romans de l’écrivaine égypto-britannique Ahdaf Soueif, l’archétype de la guérisseuse. Evelyne aura au moins tenté de remonter jusqu’aux sources dans cette Égypte « ressentie de loin et vécue en rêves ».
L’Ariane des mots est pour Louise Dupré, écrivaine et poète, membre de l’Académie des lettres du Québec, une entité symbolique féminine qui aide à « cheminer dans le plus noir de la chair ». Le dialogue que mène l’auteure avec la Québécoise, à travers le roman La mémoria (1996) est axé sur le processus de « remembrement » et elle joue avec l’étymologie : remember, remembrer, les termes britanniques et provençaux, memoria étant à l’origine des deux mots modernes. On retrouve aussi une autre Ariane « aidant à retisser notre être le plus intime et le plus authentique » ; ce qui constitue la trame du roman avec la recherche d’une fille disparue de Montréal à l’âge de 17 ans. Sa sœur Emma part pour Los Angeles, bien plus tard car sa propre fille s’y serait enfuie. Un amant, Vincent, l’aidera dans sa quête : il lui servira de guide, « d’ange vers la cité des Anges » ! Intervient une autre mythologie, avec l’Amour, Ariane et son fil conducteur, Minos et le Minotaure, ressentie profondément par Emma, après une lettre envoyée de Crète par une amie qui y guérit du deuil d’un époux. Mais Emma devra seule, s’avancer vers les « Barrières qui la séparent de la Cité des Anges ». Dans un autre de ses romans, La voie lactée(2001),Louise Dupré démêle les nœuds entre mère et fille et évoque leur reconstruction réciproque car il s’agit de « vivre une vie dont il faut chaque jour recoller les morceaux ». C’est alors Démeter et Perséphone qui s’invitent mais Ariane, tissage refait, tend toujours son fil qu’il ne faut surtout pas rompre.
Andrée Christensen, grande voyageuse, poète, artiste en collage et photographe, explore dans son roman La Mémoire de l’aile (2010), « les rapports entre les cultures différentes entre le Nord et le Sud, le froid et la chaleur avec un symbolisme très varié ». Ce qui donne, « du noir au blanc, toutes les cultures du mythe ». La figure centrale « est une femme-oiseau, femme-corneille », « au centre de la nature, sorte de chamane, et de tout un réseau d’antagonismes et de superstitions ». Mais Andrée Christensen conduit aussi le lecteur « dans le labyrinthe de sa prose comme une Ariane qui en connaît l’issue ». Angéline qui a échappé au « meurtre initiatique » par une mère alcoolique, démente puis internée, est devenue un « être ailé », « gardienne elle-même d’une corneille albinos, Icare ». Les allusions mythologiques foisonnent avec l’arrivée d’un homme Beltran, « taureau du sacrifice », « Dionysos halluciné ». Entre le noir de la corneille, couleur de la destinée de la mère folle et le « blanc stérile de la beauté plastique » de la demeure d’Angéline et de Beltran, Angéline préfère la noirceur. Interviennent alors les Ménades, Lilith, une femme entourée d’oiseaux tandis qu’Angéline prend la forme de Mélusine et met au monde une fille Ariane. « Le tout se perd dans le labyrinthe de l’hérédité ». Ariane deviendra-t-elle aussi une
femme-oiseau, femme de rêves, artiste comme Mélusine-Angéline, honorée dans sa
« dignité par les croassements des corneilles dans la forêt » ?
Melka Zupanéiè évoque les dialogues menés dans les années 70 par six femmes québécoises dont France Théoret, Louise Dupré et Claire Lejeune sur l’identité culturelle et linguistique. Elle souligne que l’élan avant-gardiste des Québécoises avait assuré un bon nombre de transformation dans la pratique langagière au quotidien et qu’il avait été sous-estimé « en France métropolitaine, mais davantage apprécié en Belgique ». Notamment par Claire Lejeune, élue à l’Académie royale de langue et de littérature française de Belgique mais considérée comme une écrivaine du Québec par ses consoeurs. Ainsi « les femmes se parlent, les femmes s’influencent ». Aussi, Le livre de la sœur, en 1992, fut-il « accueilli avec joie dans les cercles féministes de Montréal et d’Ottawa ». « Mais ce n’est pas seulement la lutte pour la parité linguistique et sociale qui intéressa Claire Lejeune ; à un niveau plus profond, elle « fonctionne dans le remembrement », en insistant sur les liens qui unissent les femmes et la nécessité de les renforcer ». En 2006 avec La Lettre d’amour, elle souligne l’urgence de retrouver l’orygine, terme crucial selon elle, pour la dévoiler. A cette fin, elle recourt aux grands mythes : Orphée, Antigone et Lilith.
On retrouve le mythe d’Ariane, décidément un classique de la mythologie féminine nouvelle dans Le dit d’une femme de Jacqueline DeClerq, en 2008. Le dit signifiant au Moyen-âge, une petite pièce littéraire traitant d’un sujet familier. Le thème en est revisité après la lecture, parmi d’autres auteurs, de Jean Shinoda Bolen, d’un livre sur les dieux et les déesses (non traduit de l’anglais) et qui a contribué à l’analyse psychique moderne. Ce mythe a été renforcé par d’autres mais « le portant en une longue gestation », Jacqueline De Clerq décide de mettre au jour l’épouse de Dyonisos le deux fois- né, (issu de la cuisse de Zeus pour terminer sa gestation. A.K.K.) et de
« remembrer cette Ariane » avec, sous- jacent, le processus alchimique et le contexte de cette cour royale de Crète avec ses mensonges et ses horreurs. Une Ariane que Minos marie de force à Thésée, en un temps où il n’y avait pas d’autre issue pour la femme que de se soumettre. Son exil à Naxos représente aussi l’éloignement de la famille, la séparation de la mère et de la famille, thème récurrent semble-t-il et qui hante les écrivaines québécoises. Il s’agit donc d’une réflexion sur le patriarcat et le matriarcat sous « l’égide de la figure d’Ariane », avec la possibilité par ce biais, de la découverte d’elles – mêmes par les femmes.
Pierrette Fleutiaux, Prix Fémina 1990 pour Nous somme éternels, avait déjà, avec L’Expéditionsituée à l’île de Pâques (1999) séduit Melka Zupanéiè ; ce roman, comme le Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier, a transformé le roman d'aventure classique en une initiation et une exploration des profondeurs des mythes et de la sensibilité. Avec La Saison de mon contentement (2008), elle évoque plus personnellement son fait d’être femme à l’écoute des autres femmes en faisant appel à un autre mythe, indien celui-là : Lalita Sahasra Nama ou les mille noms de la déesse, ou encore principe féminin sacré, titre d’un mantra que seule les femmes sont autorisées à réciter. Elle fait aussi référence à Françoise Héritier l’anthropologue et à son Masculin / féminin, la pensée de la différence, publié en 1996 : « si pouvoir, elles (les femmes) ont, de quelle nature est-il ? Simple influence sur l’homme ou capacité de décider au même titre que lui ? ». Face à la candidature à l’élection présidentielle en France, en 2007, d’une femme (jamais nommée), Pierrette Fleutiaux se gardant d’une construction utopique ou d’une idéalisation, s’interroge sur sa propre variante d’une forme « d’Athéna qui s’identifierait aux hommes », « mais dans l’approche féminine, il y a mille chemins et on y va de contradictions en contradictions » convient-elle. Mais elle va effectuer le même travail de recomposition ou de « remembrement ». Elle constate pourtant qu’il n’y a pas de différence notable et irrécusable qui permette de distinguer un livre d’homme et un livre de femme .Il n’y a qu’une différence de réception ». C’est aussi une œuvre engagée selon Metka et qui traite des images stéréotypées des femmes. Mais il faut noter, et c’est notre point de vue de lectrice, et que n’a pas fait l’essayiste dans son commentaire de L’expédition, que les trois organisatrices : l’auteur de livres de voyages dite la Commandante, la botaniste du Muséum et la Professeure, s’engloutissent dans la nature et disparaissent, cédant à l’envoûtement délétère et panthéiste de l’île de Pâques et non leur compatriote masculin, indéfectible !
Après Ariane abandonnée à Naxos, puis transfigurée dans une constellation ou Eurydice perdue aux Enfers, l’auteure des essais saisit avec empressement la perche que lui tend Hélène Cixous qui, dans Philippines ; Prédelles (2009) affirme « Je me remembre », son expression favorite, on l’a vu plus haut, dans son exploration de la littérature féminine. Mais un autre ouvrage se superpose : il s’agit du livre favori de la Française car « chacun de nous a son livre secret » ; celui d’Hélène Cixous est le célèbre Peter Ibbetson (1891) de George Du Maurier. Il fut tiré un film avec Gary Cooper de l’histoire d’un jeune garçon, Peter, élevé en Angleterre, chez son oncle le colonel Forsytthe mais qui prend le patronyme de sa mère défunte. Devenu adulte, il rencontre un cousin de cette dernière, épris d’une duchesse des Tours (Towers), en qui il reconnaît son amie d’enfance Mary. Ce fanfaron, menteur et coureur de femmes, prétend être son véritable père. Après l’avoir provoqué, Peter le tue et se voit condamné à perpétuité. L’attirance d’Hélène Cixous s’explique par le contenu ésotérique et le jeu des langues pratiquées par les deux héros, Mary et Peter depuis leur enfance « dans ces mondes d’avant le temps nous parlions le masculin féminin, le français à l’anglais et les deux langues, comme des anges ». Nature double (Philippines pour Mary et Peter) avec aussi avec la mention de Platon, de son Banquet et son mythe d’amour, lié à celui de l’androgyne. La « rivière Léthé » s’installe dans l’œuvre de Cixous et sépare deux mondes menant aux secrets de l’au-delà chez « les orphiques anciens » La Léthérature sera donc la littérature entre la vie et la mort. Mary est d’ailleurs identifiée, au terme du livre, comme la magicienne qui possède la clef des mystères tandis qu’Hélène Cixous reconnaît qu’elle a fait Philippines avec Peter du roman de Du Maurier, son double imaginaire, s’étant unie avec lui dans la même Mandorla. C’est le nom italien de l’amande qui figure dans les tableaux médiévaux où s’inscrivent les figures du Christ ou de « la Vierge, amande mystique, Philippine étant l’amande androgyne ». Le côté ésotérique est à demi voilé dans l’œuvre de Du Maurier, mais il était vraisemblablement proche de la société de Théosophie car il avait pour ami le romancier Sir Walter Besant, beau- frère de la célèbre Annie Besant, fidèle d’Hélène Blavatsky, sa fondatrice, militante d’autre part de l’indépendance de l’Inde. Hélène Cixous pense d’ailleurs que « les grilles ouvrent grand les barreaux » pour « une maçonnerie mystique des chercheurs de mots à l’aide des rêves ».
En conclusion, l’auteure recense les mythes dans les manifestes féminins pour établir le fil des continuités, des filiations, des reconnaissances à l’égard aussi de romans comme celui d’Agnès Gray d’Anne Brontë. Avec les figures de Marie,
Marie-Madeleine, Démeter et Perséphone, Eurydice, Lilith jusqu’à la Méduse d’Hélène Cixous, tandis que l’éternelle Arian aide à démêler les fils pour permettre « une remontée des forces féminines permettant le rassemblement et le remembrement des aspects éclatés du corps symbolique féminin ».
Mais au terme de cette enquête minutieuse, riche et très fouillée des mythes conducteurs, on peut se demander si l’engouement pour celui d’Ariane, comme pour les ouvrages de Jane Austen, dans le monde féminin anglo-saxon ou francophone, ne tient pas à son « happy end » : la jeune fille défavorisée qui, par un mariage avec un personnage important, acquiert un statut social enviable : en l’espèce l’accès à l’Olympe des divinités ! Les destins de héroïnes de Flaubert ou de Balzac : Madame Bovary ou Eugénie Grandet, pire encore de la malheureuse Pierrette ne présentent pas un idéal. Mais devant cette ascension due à la seule passivité féminine, on comprend que les féministes aient retravaillé le mythe d’Ariane, transformée en magicienne, ou exalté une forme plus volontaire mais masculinisée avec Athéna et Artémis !
Basé(e) sur une œuvre à www.academieoutremer.fr.