


| Auteur | Flora Amabiamina |
| Editeur | P.I.E. Peter Lang |
| Date | 2017 |
| Pages | 319 |
| Sujets | Femmes écrivains africaines Sexualité féminine Cameroun Dans la littérature Cameroun Moeurs et coutumes |
| Cote | 62.114 |
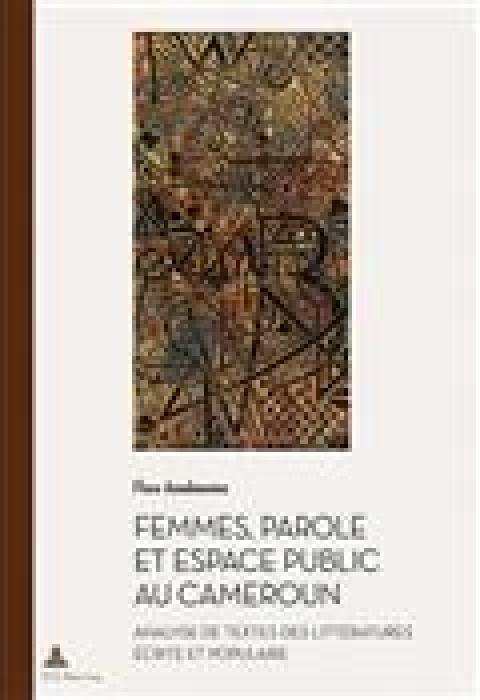
Le catalogue de la BNF demeure muet quant à l’auteure et naturellement aussi quant à ses écrits, somme toute relativement abondants, depuis une thèse soutenue à Strasbourg, en 2001, relative au bestiaire dans le roman ouest-africain d’après les Indépendances.
Constatation de nature à rassurer le lecteur pour qui les francophonies sont multi centrées et n’ont pas de lieux saints, malgré d’évidents liens de parenté ?
Trêve d’ironie facile, revenons-en à l’ouvrage proprement dit, d’abord à son titre. Car il s’agit, ici, d’analyser non pas des particularités linguistiques d’un langage en français tel qu’exprimé oralement ou par écrit par des Camerounaises. Mais bien plus, d’examiner comment et par quels processus ces langages féminins participent à une revendication, par d’innombrables femmes, de liberté et d’autonomie dans un monde camerounais qui serait résolument phallocratique.
L’avant-propos – recommandons au lecteur de commencer par-là, avant de pousser plus loin sa lecture – relate avec ironie une scène de mariage camerounais à Strasbourg, ville où alors étudiait l’auteure, en 1999. Lors de la soirée dansante qui suivit le mariage, le disc-jockey fut sommé par un étudiant de retour du Cameroun, de passer une chanson dont il affirmait qu’au « pays », elle connaissait un immense succès : elle avait pour auteure une « sulfureuse musicienne », K-Tino, et racontait l’histoire d’une femme libre, prostituée ou à tout le moins à la sexualité libérée.
Partie depuis près de huit ans de son Cameroun natal, Flora Amabiamina, découvrait l’ « effronterie », chantée par une femme. Effronterie à la source du présent ouvrage, car cette auteure en fait partir sa réflexion, ancienne aujourd’hui de presque deux décennies, laquelle aboutit à ce livre. Il se trouve qu’en outre, après son affectation à l’université de Douala, en 2003, un enseignement de « paralittérature » fut introduit dont elle eut la charge. « Tout de suite, le souvenir de ma soirée strasbourgeoise, le constat quotidien de la présence permanente et engagée de la femme dans le paysage musical camerounais… » la conduisent à proposer à ses étudiants le choix « de la présence féminine camerounaise comme corpus ».
À tort ou à raison, Douala est considérée comme une sorte de melting-pot représentatif de l’Afrique de l’Ouest, à ce titre représentant les spécificités africaines des modernités postcoloniales dans un contexte de francophonies. On peut donc espérer de l’ouvrage de Flora Amabiamina la part de ces modernités qui concerne l’émergence d’une revendication féminine, voire féministe.
Si l’anecdote d’avant-propos concernait l’ « effronterie » des chanteuses en vogue à la fin du XXe siècle, l’ouvrage proprement dit est plus ambitieux puisqu’il annonce une « Analyse de textes des littératures écrite et populaire ».
En six chapitres l’auteure invite son lecteur à un parcours qui suit les modalités d’une prise de parole féminine et va de l’espace privé à l’espace public.
On sait que la gent féminine, en Afrique comme ailleurs, est bavarde. Dans les sociétés « traditionnelles », elle est d’abord bavarde entre elle et doit généralement respecter un domaine public, phallocratique et réservé aux discours, voire littératures et autres expressions masculines. On rappellera ici que notre Académie française attendit plus de deux siècles et demi pour enfin s’ouvrir aux écrivaines alors qu’un certain nombre de celles-ci avaient déjà envahi et convaincu, avec succès, un public cultivé des deux sexes.
La prise de parole « en public » et sans soumission ou subordination, de type traditionnel, ne peut donc être le fait que de « rebelles » qui finissent par s’imposer. Pas seulement, on y reviendra à plusieurs reprises dans la suite de l’ouvrage, dans le domaine de la parole ou de l’écrit, mais aussi dans le domaine d’une sexualité libérée et libre de s’exprimer. Telles les chansons, les « one woman shows » dans lesquels cette sexualité s’exprime sans fausse honte.
Cette quête à la fois de l’espace public et d’une sexualité revendiquée n’est pas le seul fait de la prise de parole populaire (chanson, théâtre populaire…) mais encore d’une prise de parole dans l’espace de « la culture lettrée ».
L’auteure affirme qu’il existe des « techniques et des modélisations » de la sexualisation du discours féminin. Elles passent par la moquerie de la convenance, ce qui n’empêche pas la combinaison de la crudité et d’une certaine forme de douceur…
C’est bien, in fine, à travers la conquête d’un espace public clairement sexualisé que se construit une « idéologie libératrice ».
En conclusion, « soumission ou indocilité, quel modèle pour le féminisme camerounais ? ». Sur ce point, il est possible qu’un féminisme camerounais, représentatif d’un féminisme subsaharien, ait encore à choisir entre ces deux termes. Il serait cependant un peu surprenant que « l’indocilité » soit la bonne réponse. Dans d’autres régions du monde, le statut biologique, sociologique et culturel de la femme n’est plus une question « d’indocilité », même si certains aspects peu reluisants d’une goujaterie masculine persistante donnent lieu à dénonciations et procès.
On ne tranchera pas ici la question de savoir si en Afrique subsaharienne francophone on en est encore à cette « indocilité », l’auteure est mieux placée que son recenseur pour en juger. On relèvera la qualité et la rigueur de son enquête et de son appareil critique. On renouvellera les regrets exprimés en début de recension : comment se fait-il que dans le contexte postcolonial et francophone, on ait si peu d’informations sur l’auteure et son ouvrage, au point qu’une recherche sur catalogue BNF, voire sur le site de l’Organisation internationale de la francophonie est improductive…
Les recensions de l'Académie des sciences d'outre-mersont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrit.
Basé(e) sur une œuvre à www.academieoutremer.fr.