


| Auteur | sous la direction de Emmanuelle Chérel et Fabienne Dumont |
| Editeur | Presses universitaires de Rennes |
| Date | 2016 |
| Pages | 171 |
| Sujets | Postcolonialisme Dans l'art Actes de congrès Art France 1970-.... Thèmes, motifs Actes de congrès |
| Cote | 61.310 |
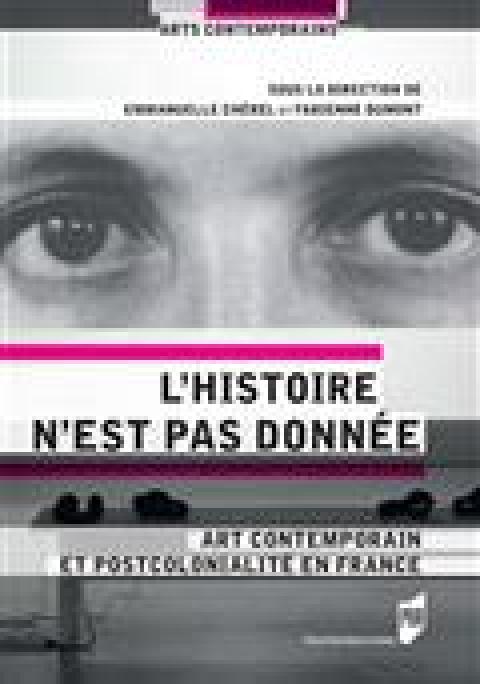
Cet ouvrage regroupe les douze communications présentées à la journée d’études qui s’est tenue le 30 janvier 2014 à l’école supérieure des beaux-arts de Nantes-Métropole, sur le thème : « Histoire de l’art et postcolonialité en France : quels enjeux ? »
Nous observerons d’emblée que le terme de colonialité (tout comme celui de postcolonialité) n’appartient pas à la langue française[2]. Ils sont l’un et l’autre absents du TLF autant que du Littré. Ils semblent exister dans la langue anglaise très contemporaine (coloniality).
Le titre peut paraître étrange : chacun sait que rien n’est gratuit et que, comme dit le poète, rien n’est à l’homme jamais acquis, et ajouterons-nous, pas plus la connaissance historique que les autres richesses de ce bas-monde.
Dans leur introduction, les deux coordinatrices de l’ouvrage, l’une et l’autre historiennes de l’art, Emmanuelle Chérel, professeure à l’Ecole supérieure des Beaux-arts de Nantes-Métropole et Fabienne Dumont, professeure à l’Ecole Européenne des arts de Bretagne (antenne de Quimper) retiennent l’année 1989 comme point de départ de l’irruption des théories post-coloniales dans le domaine de l’art contemporain en France. Cette année-là fut celle de l’exposition « Magiciens de la Terre » qui s’est tenue au Centre Pompidou et est comme il se doit qualifiée d’incontournable par les deux auteures qui lui reconnaissent le mérite d’avoir introduit le multiculturalisme en art. Elle a suscité à travers le monde d’intéressants débats, mais ils ont peu retenu l’attention des Français, la France ayant, comme il est écrit à la p.4 de couverture, un oubli très sélectif de son passé. Est-ce propre à notre pays ?
La première partie, intitulée : « Histoire paradoxale de quelques expositions » regroupe trois contributions : Maureen Murphy (Paris I) s’intéresse à l’exposition Modernités plurielles (2013-2014) qui a mis en évidence l’absence des arts modernes africains dans les collections du Centre Pompidou tandis que Sophie Leclercq (Sciences-Po Paris) remarque que les principaux acteurs du surréalisme se sont opposés à une vision coloniale des arts africains. Emmanuelle Chérel insiste sur les difficultés des Français à penser le présent postcolonial dans sa relation à l’art : La triennale « intense proximité » en a, selon elle, donné l’illustration en 2012.
La deuxième partie : « Migrances culturelles » s’attache aux questions de transculturalité : Sophie Orlando (Paris 1) nous donne un article au titre un peu abscons « Cloche-pied, saute-mouton et autres stratégies d’évitement. Lexiques du champ postcolonial dans les pratiques discursives depuis les années 1990 en France ». Elle étudie l’évolution sémantique des termes de migration et de diaspora sur les scènes artistiques française et anglaise. Fabienne Dumont, historienne de l’art, développe le concept de migritude (jusqu’à présent inconnu de nous) pour nous entretenir des influences du pays d’origine sur la production de deux artistes immigrés, l’une venue d’Algérie (Zineb Sedira) et l’autre de Turquie (Nil Yalter). Dans la même veine, Marie-Laure Allain Bonilla (Rennes 2) étudie l’impact de trois expositions restées peu connues.
Les lecteurs parcourront avec agrément le cahier de dessins et de caricatures inséré aux pp. 99-107, œuvre des artistes Patrick Bernier et Olive Martin et intitulé : « scènes d’intrusion ». Nous apprenons qu’il s’agit de photogrammes avec dialogues extraits de films présentés à Quimper.
Dans la troisième partie, « L’art africain écrit depuis la France », Lotte Arndt (universités de Berlin et Paris 7 Diderot) nous entretient des débats suscités autour des premiers numéros de la Revue Noire, dans les années 1990. Anne Bourdié, docteure en sciences sociales et professeure agrégée d’EPS à l’Université de Paris XII-Val de Marne, s’intéresse à la chorégraphie et aux rencontres « Afrique en créations » organisées par la coopération culturelle française, qui devraient permettre à la France de conserver une certaine influence dans ce domaine en Afrique.
De la dernière partie : « Nouvelles propositions curatoriales » nous retiendrons des réflexions sur les musées fictifs (Aliocha Imhoff et Kantuta Quiros) qui évoquent « la nuit des colonisés d’histoire de l’art » tandis que des entretiens relatifs aux méthodes, entre Lotte Arndt et Mélanie Bouteloup (organisatrice de séminaires) et entre Lotte Arndt et Olivier Marbœuf (auteur et critique) complètent heureusement ce texte.
Des communications qui ont le mérite d’ouvrir d’assez nombreuses pistes d’analyse et de méditation, ainsi que nous venons de le voir, et qui pourraient permettre un jour, ainsi que l’espèrent les organisatrices, de refonder la discipline d’histoire de l’art. Toutefois nous ne déplorerons jamais assez la tendance des participants à s’enfermer dans un langage ésotérique et à abuser de néologismes qui confinent au pédantisme et ne facilitent ni la lecture ni la compréhension.
[1]
Les recensions de l'Académie des sciences d'outre-mer sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrit.
Basé(e) sur une oeuvre à www.academieoutremer.fr.
[2] Le terme de colonialité apparait pour la première fois, à notre connaissance, dans un article de feu notre consœur Roselène Dousset-Leenhardt, paru dans la revue française d’histoire d’outre-mer en 1977.