


| Auteur | cahier coordonné par Sophie Basch et Nilüfer Göle |
| Editeur | Éditions de l'Herne |
| Date | 2017 |
| Pages | 294 |
| Sujets | Pamuk , Orhan 1952-.... Critique et interprétation |
| Cote | In-4 1990 (Delafosse) |
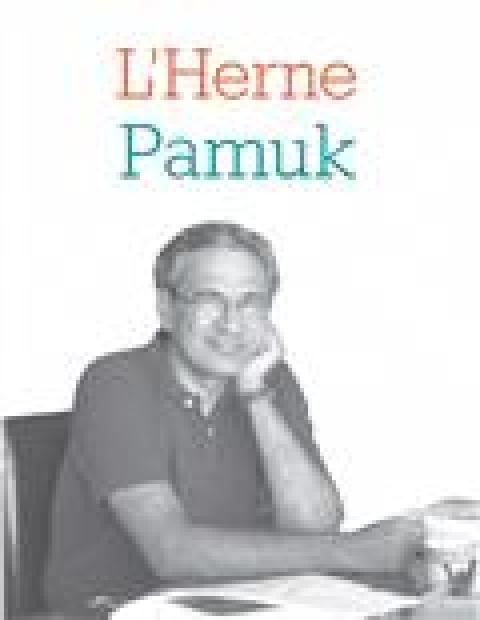
Un cahier de l’Herne est toujours un monument et pour un écrivain, qu’il soit vivant ou disparu depuis longtemps, une consécration.
De cette consécration, Ferit Orhan Pamuk était digne à plus d’un titre. Né à Istanbul en 1952, auteur d’une quinzaine de romans qui ont pour la plupart, connu un grand succès de librairie (11 millions d’exemplaires vendus et traduction en plus de 60 langues) et lui ont valu le prix Nobel de littérature en 2006, il est le premier Turc à avoir reçu cette distinction. La parution de ce cahier aura le mérite de conforter la notoriété d’une œuvre romanesque qui, bien qu’elle ait été en grande partie traduite et publiée chez Gallimard, reste encore peu connue en France, par rapport à d’autres pays européens tels que la Grèce, l’Italie ou la Grande-Bretagne.
Dans leur avant-propos, les deux coordinatrices, Sophie Basch (Paris IV) et Nîlüfer Göle (EHESS), nous rappellent que cet écrivain « hors-normes » est également exceptionnel par la diversité de ses talents (puisqu’il est aussi architecte, muséographe, dessinateur, peintre et photographe, voire caricaturiste) et par l’éventail de son audience. Elles soulignent avec justesse que le souci principal de Pamuk est de « dégager de la mode ce qu’elle peut contenir de poétique dans l’historique et de tirer l’éternel du transitoire » (p .19). Pamuk est connu comme un travailleur infatigable et son art d’écrire consiste à rechercher, fouiller, creuser.
Trente-quatre auteurs ont apporté leur contribution à ce cahier[2]. On trouve parmi eux des noms illustres de la presse et de la littérature mondiales tels que Pietro Citati, John Updike, Claudio Magris. Nous ne saurions avoir l’ambition de les résumer toutes. Romancier turc, Pamuk est aussi et avant tout, un écrivain stambouliote et s’il a parcouru le vaste monde, notamment pour enseigner la littérature comparée à Columbia, séjourné à Rio ou à Milan, sa vie s’est essentiellement écoulée aux rives du Bosphore. Issu d’un milieu aisé et cultivé, (son père, francophile, fréquenta Sartre et Beauvoir et traduisit Valéry) mais appartenant à une bourgeoisie qu’il juge un peu décadente, (Il se qualifie lui-même de candide fils à papa de la bourgeoisie) il a étudié le journalisme et les beaux-arts dans sa ville natale dont le cadre a imprégné la plupart de ses œuvres.
Une première partie regroupe huit contributions, dix si l’on compte deux extraits inédits de l’œuvre de Pamuk. Elle est opportunément intitulée « Istanbul et mélancolie ». Titre évocateur de cette buée de tristesse qui s’élève aux rives du Bosphore et dans laquelle ont baigné l’enfance et la jeunesse de Pamuk. Istanbul, Byzance, Constantinople, jadis ville cosmopolite, ville de synthèse, (Mais Pamuk ne l’a pas connue sous cet aspect), aujourd’hui « décapitalisée » au profit d’Ankara, garde-t-elle la nostalgie des fastes ottomans, de ces temps révolus ? C’est probable.
Traductrice grecque née à Istanbul, où elle a vécu ses jeunes années, Stella Vretou a intitulé sa contribution « Souvenirs de Constantinople ». On se doute que le choix de ce titre-et de ce nom- n’est pas innocent. Elle observe justement que Pamuk est le biographe d’Istanbul comme Joyce celui de Dublin, Pessoa celui de Lisbonne, Mahfouz celui du Caire, Kafka celui de Prague : son œuvre s’incarne dans cette ville (cf. Istanbul, souvenirs d’une ville). Pour Stella comme pour Pamuk, Constantinople-Istanbul est La Ville par excellence. Un peu comme l’Orsenna du Rivage des Syrtes. Mais il ne s’agit pas d’une ville fantôme ou imaginaire.
Max Liu constate (p. 62) que les meilleurs romans de Pamuk ont été écrits postérieurement à l’obtention du prix Nobel, ce qui est en soi assez original. Il s’attarde sur une des dernières œuvres : « Cette chose étrange en moi », saluée par une critique enthousiaste. Quarante années (1969-2012) de la vie d’un petit berger anatolien, Mevlut Karatas, venu à douze ans chercher sa subsistance à Istanbul. Il n’évoque en rien Rastignac et vit pauvrement comme vendeur des rues. Mais tout au long de ses déambulations, il observe la Ville. Il s’éprend d’une jeune fille entraperçue dans un mariage, lui adresse des lettres enflammées (en se trompant de destinataire car il a été berné par un cousin). Il finira par retrouver et épouser sa bienaimée qui lui donnera deux filles. Ayant un peu, mais un peu seulement, amélioré sa condition en exerçant d’autres petits métiers, il connaîtra enfin le bonheur. Mais à l’arrière- plan de la narration des aventures sentimentales et professionnelles de Mevlut, se profile le spectre de la Ville, personnage essentiel, qui compte trois millions d’habitants au début du récit et va devenir une mégapole de treize millions d’âmes quarante ans plus tard. Et le vendeur ambulant observe la métamorphose des mentalités et des activités, tandis que cités et bidonvilles prolifèrent sur les collines environnantes. Les villes tentaculaires…
Istanbul, ville-pont entre Orient et Occident, rive d’Europe : Roum Ili et rive d’Asie : Anad Olu. Le cliché a trop servi et Pamuk semble enclin à penser qu’il s’agit surtout d’un pont aux ânes…
Une deuxième partie, précisément nommée Est-Ouest, contient d’intéressants commentaires de Pamuk sur deux de ses œuvres (Le Livre Noir et le Château blanc) et sur le regard qu’il porte sur Goethe et Dostoïevski. Suivent quelques contributions de valeur parmi lesquelles nous avons remarqué celle de la journaliste madrilène Mercédès Monmany, « Pamuk l’Européen ». Se définissant comme « intellectuel occidentalisé de culture musulmane », assez peu religieux, apparenté à la gauche de la modernité (?), Orhan Pamuk se revendique en tant qu’Européen et considère que son pays a vocation à intégrer l’Union européenne. Il s’élève contre les extrémistes religieux aussi bien que contre les nationalistes laïques intransigeants qui lui reprochent de porter atteinte à l’image du pays. Ces derniers lui ont plusieurs fois adressé des menaces de mort et des poursuites ont même été engagées contre lui, notamment après qu’il eût reconnu la responsabilité de la Turquie dans le génocide arménien et désavoué la politique suivie à l’égard des Kurdes : elles ont été abandonnées après l’attribution du prix Nobel. Il n’en est pas moins surveillé de près ou de loin. Il fut le premier intellectuel turc à s’élever contre la fatwa rendue contre Salman Rushdie et s’il reconnait certains mérites à Tayep Erdogan, il déclare n’avoir jamais voté pour lui ni pour son parti.
Albertine Simonet, l’héroïne de Proust, s’est-elle noyée dans les eaux du Bosphore au lieu de périr d’une chute de cheval en Touraine ? Telle est la question que se pose Karen Haddad (Université de Nanterre) en étudiant l’influence du Temps Retrouvé sur Orhan Pamuk et notamment sur son œuvre Le Livre Noir.
Dans la troisième partie (Espaces) Pamuk nous entretient de ses pérégrinations à travers le monde, de ses impressions de séjour à Rio (centre-ville et favelas) à Jaipur et à Calcutta, tandis que Daniel Lefort, spécialiste de littérature latino-américaine, compare les regards portés sur la ville (et sur la vie) dans les œuvres de Pamuk, de Mario Vargas Llosa et de A.B. Yehoshua.
Dans une quatrième partie : « Mémoire et musées », Pamuk, collectionneur invétéré d’objets hétéroclites, nous rappelle qu’il est aussi fondateur d’un musée. Sa passion de collectionneur lui a inspiré un roman « Le musée de l’innocence ». Est-ce le roman (84 chapitres) qui lui a inspiré l’idée du musée (84 vitrines) ou est-ce l’inverse ? Muséeimaginaire ou réalitaire, il existe bel et bien dans une maison acquise par Pamuk en 1999 au quartier de Cukurcuma à Istanbul. Le musée a certes des aspects de bric à brac, mais les objets qui y sont rassemblées sont rétroviseurs selon l’heureuse formule de Bertrand Tillier (Paris I). Ce contributeur et quatre autres s’interrogent avec minutie sur l’œuvre muséographique de Pamuk.
Bien que nous n’aimions guère le terme, Pamuk est un écrivain engagé en ce sens que, loin de se retirer dans une quelconque tour d’ivoire, il prend position dans les luttes politiques de la société turque de son temps. Telle est la question que se posent les contributeurs de la cinquième partie, précisément intitulée Engagement. Une part discrète sans doute, mais nul n’ignore qu’il a refusé le statut d’artiste national dans lequel il voit une récupération par les pouvoirs publics. Les milieux laïques lui reprochent de puiser son inspiration dans le passé ottoman et islamique du pays, tandis que les milieux religieux lui font grief de son agnosticisme. On lira avec admiration son discours de réception du prix danois Sonning (2012). Les contributions s’attardent sur le septième roman de l’auteur, Neige (2009), l’un des seuls dont l’action ne se situe pas à Istanbul. Le héros, Ka, dont le nom signifie Neige, revenu en Turquie pour l’enterrement de sa mère après douze ans d’exil, se rend à Kars, ville perdue d’Anatolie, et enquête sur le suicide de jeunes filles, contraintes par la législation laïque de retirer leur voile à l’école. La romancière canadienne Margaret Atwood nous apprend que Pamuk est considéré en Turquie comme une espèce de gourou et aussi comme un analyste politique à la manière de Raymond Aron ou d’Ortega y Gasset.
La sixième et dernière partie : « Dans l’atelier de l’écrivain » est une manière de conclusion dont on retiendra d’intéressantes réflexions de Pamuk sur l’art du roman et notamment sur le roman historique (pp.244-246).
Pietro Citati nous donne un passionnant aperçu du regard que Pamuk porte sur Flaubert et Tolstoï.
Un autre Prix Nobel, J.M.G. Le Clézio, se définit comme « un homme des îles qui regarde au loin passer les cargos ». Des cargos, Pamuk a dû en voir passer plus d’un, non pas au loin, mais presque sous ses fenêtres, se faufilant dans le détroit entre deux continents, très lentement pour éviter les collisions (les abordages avec les bacs traversiers sont fréquents, malgré l’habileté des pilotes) et aussi pour éviter d’endommager les berges par les remous. La nuit, sa chambre a du se trouver plus d’une fois inondée par la lueur de leurs projecteurs[3]. Le meuglement plaintif de leurs sirènes dans la brouée ajoute peut-être à la mélancolie des Stambouliotes et à celle d’Orhan Pamuk, le plus illustre écrivain turc de notre temps.
[1]
Les recensions de l'Académie des sciences d'outre-mer sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrit.
Basé(e) sur une œuvre à www.academieoutremer.fr.
[2] Trente-six en incluant Jean-Michel Bélorgey et John Updike qui, à la différence de leurs co-contributeurs, n’ont droit ni à une mention en p.4 de couverture ni à une notice biographique.
[3] Voir le cahier de dessins pp.65-67.