


| Auteur | Rémi Dalisson |
| Editeur | Armand Colin |
| Date | 2018 |
| Pages | 318 |
| Sujets | Commémorations France 1945-.... Algérie 1954-1962 (Guerre d'Algérie) Mémoire collective |
| Cote | 61.916 |
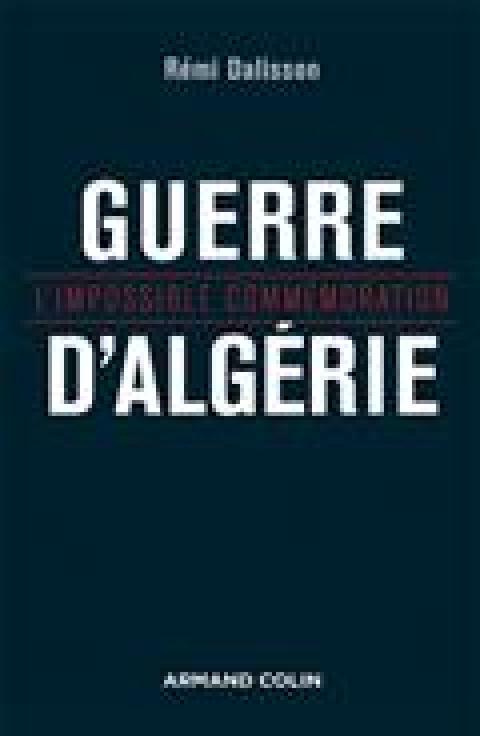
Le titre de l’ouvrage, si celui-ci n’est pas replacé dans son contexte, peut prêter à malentendu. Écrit par un historien qui s’est fait, entre autres, une spécialité des commémorations, fériées ou non, reconnues par des lois ou décrets, ou plus festives ou de propagande. Sa longue bibliographie le démontre. Commémorations qui sont entrées dans les mœurs, notamment en France, à travers diverses manifestations (monuments, rassemblements populaires, défilés militaires ou civils) : qui songerait aujourd’hui à contester le 1er mai, le 8 mai, le 14 juillet, le 11 novembre, quelle que soit l’opinion politique ou sociale personnelle ? Aucune de ces quatre dates n’est apparue spontanément, leur commémoration, toujours républicaine, remonte au mieux à la seconde moitié du XIXe. Elle a, au-delà d’un fait précis, historique et documenté, une signification de mémoire collective, à honorer et à fêter.
Il peut arriver qu’à la commémoration de l’évènement initial – l’auteur l’a rappelé ailleurs que dans le présent ouvrage - celle par exemple du 11 novembre, aient été adjointes d’autres mémoires : celles, successives au fil des décennies, des morts dans tous les conflits. Il y a beau temps que le 11 novembre institué au début des années 1920 n’est plus celui des seuls poilus tombés au champ d’honneur, s’y sont rajoutés au fil des ans les morts de toutes les guerres.
En particulier, depuis les débuts de la IIIe République, la commémoration des guerres ou des batailles, gagnées de préférence ou perdues, fait partie des rites républicains. Sous réserve de s’entendre sur ce que signifie «guerres perdues », ces dernières font la plupart du temps l’objet de commémorations ambigües.
On peut s’étonner que Rémi Dalisson ne mentionne nulle part que la fin de la guerre française du Vietnam, peu après Dien-Bien-Phu, n’a jamais fait l’objet d’une commémoration républicaine et nationale, reconnue officiellement. Certes encore aujourd’hui se tiennent ici ou là des commémorations plus ou moins discrètes ou solennelles. Qui se souvient encore qu’un an après la défaite, il y eut à l’Opéra Garnier une triste et pitoyable « commémoration » ? Et que notamment lors du cinquantenaire de cette défaite, ici ou là en divers points de France, des anciens combattants d’Indochine se réunirent sur les places des mairies ou devant le monument aux morts, avec drapeaux, décorations pendantes, pour rappeler le souvenir de leurs camarades tombés alors au combat ou morts d’épuisement dans les camps de prisonniers ? Il est vrai que dans un tableau annexe de son ouvrage, l’auteur cite le 8 juin parmi les « journées nationales » mais non chômées dédiée à un « hommage aux morts pour la France en Indochine », soit l’une des dix commémorations de guerre… Il s’agit ici non pas de la fin d’une guerre, mais d’un « hommage » d’une certaine façon hypocrite, à tout le moins discret, en raison de sa généralité. Ce n’est pourtant pas faute que depuis près de huit décennies, y compris à leurs débuts, cet Alésia lointain et longtemps mythologisé n’ait fait l’objet d’articles, d’ouvrages où souvent s’affrontaient les mémoires.
Il est vrai que la guerre du Vietnam n’avait pas mobilisé le contingent, qu’il n’existait pas de colonat français important sur place, capable de mobiliser l’opinion en France, ceci étant dit en simplifiant au point d’être simpliste.
Mais qui d’autre part songerait à commémorer la loi-cadre dite Defferre (1956), étape d’autonomie interne annonciatrice d’une proche indépendance des Territoires français d’Afrique subsaharienne, accordée en 1960 sans véritable lutte armée et sanglante ? Il s’agit pourtant de la seule décolonisation française pacifique et sans rupture avec les anciens colonisés, si l’on excepte, avec des nuances, les cas un peu différents du Maroc et de la Tunisie en 1956. Dès lors qu’il n’y aurait pas eu « guerre » mais éventuellement quelques « combats », une décolonisation menée dans le calme et pour l’essentiel en accord avec les bientôt ex colonisés, celle-ci ne mériterait pas une commémoration ?
Qui songerait, toujours, à commémorer l’abrogation, à partir de 1944, des régimes d’indigénat, par conséquent et entre autres de certaines formes de travail forcé, à tout le moins de hiérarchie des peuples « sujets » ? Pourtant, pour le colonisateur et les colonisés, ces abrogations ont eu, à l’époque un sens très fort… Il est vrai que ce régime a connu des formes et des textes règlementaires très divers selon les départements ou colonies concernés, rendant là aussi la commémoration « impossible »…
Ce trop long préambule pour expliquer les interrogations que se pose le lecteur lorsqu’il prend en main cet épais ouvrage et que tout naturellement il en lit d’abord le titre. Pourquoi commémorer, de toutes les aventures souvent pénibles de la décolonisation, celle-ci en particulier ? Et en quoi est-ce « impossible » ? Rémi Dalisson a choisi de se consacrer ici à une commémoration qu’il semble trouver « impossible », acceptons ce choix et voyons-en les raisons, probablement fortes et spécifiques par rapport à bien d’autres commémorations possibles du passage de la situation coloniale à une situation postcoloniale. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : comment les gouvernements, l’opinion publique, les différentes populations concernées ont-elles vécu, immédiatement et dans le long terme, cette transition ?
De quel type de commémoration cet auteur veut-il parler ? Au premier abord, il ne s’agit évidemment pas d’instituer une journée fériée du type 11 novembre ou 14 juillet. Plutôt et sauf erreurs d’interprétation, de retenir une date symbole qui permette de commémorer, vue du côté français, la fin d’une guerre, c’est-à-dire de permettre à la communauté nationale de se souvenir, à une date donnée, de la fin d’une épreuve. L’on commence ici à deviner de quelle nature est « l’impossibilité » : pour quelle communauté nationale était l’épreuve passée ? Cette communauté était-elle homogène, ou hétérogène au point de ne pouvoir partager la même mémoire ?
Mémoire ne signifie pas pour autant histoire. Cette dernière prétend à prendre du recul derrière une recherche disciplinaire en principe dégagée de tout a priori. Encore que, comme beaucoup d’autres sciences sociales, voire de la nature, elle est rarement dégagée d’a priori. Notation très générale qui ne vise évidemment pas l’ouvrage ici recensé : l’évolution des sciences en général, y compris celles dites exactes, est le reflet à la fois de novateurs géniaux et de leur regard révolutionnaire, et du contexte dans lesquels ils vivaient. Galilée qui renonça au géocentrisme et remodela l’astronomie de son temps, Newton et sa célèbre pomme, ignoraient les trous noirs et ne pouvaient les imaginer.
Dans sa courte introduction, l’auteur précise ses intentions : expliciter la ou les problématiques d’une nécessaire commémoration de la fin de la guerre d’Algérie, « …mais sans confondre mémoire et histoire…La première relève de l’affectif et de la subjectivité, la seconde de la mise à distance à travers toutes les sources… ». Si l’histoire correctement étudiée est effectivement une « mise en distance » et qu’elle ne néglige aucune source, elle n’est pas forcément sans a priori. Cette observation générale ne vise pas l’approche de l’auteur qui s’intéresse d’abord à la mémoire et à ses commémorations. Selon lui, et dès l’introduction, celle de la guerre d’Algérie est « impossible ».
Auparavant, il aura dans un bref panorama, repris plus à fond dans le corps de l’ouvrage, évoqué les différentes dates proposées depuis la fin des années 1990, toutes contradictoires en raison des « subjectivités » en présence. Et les raisons pour lesquelles la date officielle – 19 mars, date du cessez-le-feu, ce depuis …2012 – est toujours contestée.
L’auteur, toujours en introduction, précise qu’il entend faire œuvre d’historien « …sans éluder les différentes mémoires… ». Et œuvre d’historien seulement pour le « côté français ». On comprend bien ici le sens de ces affirmations : comment l’histoire s’est faite de ce côté-ci de la Méditerranée et quel a été éventuellement le poids des « mémoires » dans ce travail d’histoire ?
On notera – remarque générale qui ne concerne pas directement l’ouvrage – que d’autres commémorations persistent sans peser sur l’histoire ni sur les relations ultérieures entre gagnants et perdants de l’évènement commémoré : par exemple le 11 novembre ou le
8 mai n’ont pas empêché Allemands et Français, dans la seconde moitié du XXe siècle et au XXIe, les pages douloureuses tournées,d’être ensemble les moteurs de la construction européenne et de la zone euro. Ces deux dates correspondent à des capitulations allemandes, les choses sont claires et ne prêtent à aucune discussion.
D’autres, près de cent ans après l’évènement, le 14 juillet par exemple, commémorent un évènement dont on connaît exactement la date et les circonstances, ils n’ont cependant de signification qu’en raison des enjeux sociaux, politiques et mémoriels de la période à laquelle leur commémoration a été instituée. Dans ces cas, peu importe le temps écoulé depuis le ou les évènements commémorés, la fête nationale du 14 juillet est d’abord la consolidation symbolique, en 1880, d’une République jusqu’alors fragile.
On pourrait supposer qu’après bientôt sept décennies depuis la fin de ce que l’on a fort tardé, du côté officiel français, à qualifier de guerre, et si commémoration il doit y avoir, le moment en serait venu. D’après l’auteur, il le précise dans le titre de son ouvrage, rien de tel. Alors que neuf sur dix des commémorations de guerre officiellement reconnues (par lois ou décrets) ne prêtent pas ou plus à contestation, celle du 19 mars, date du cessez-le-feu, instituée par une loi de 2012, « Journée nationale du souvenir et du recueillement en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et Tunisie », donne toujours lieu à contestations, oppositions et malentendus.
L’auteur fait remonter les analyses qui le conduisent à l’impossibilité de la commémoration dans une histoire qui part justement du 8 mai 1945, alors que l’Allemagne capitulait et que du côté de Sétif et de Guelma se déroulaient des manifestations qui commencèrent précisément ce 8 mai et durèrent plusieurs jours, elles provoquèrent désordres et massacres, avec un nombre toujours inconnu avec précision de morts, de toutes façons significativement plus élevé du côté « indigène » que du côté « européen ». Ce, dans la relative indifférence de l’opinion publique hexagonale et des jugements sévères pour lesdits « indigènes » notamment des autorités de l’État, de la presse et plus généralement de l’opinion publique métropolitaine. Malgré une mise en garde prémonitoire.
Dans une première partie, il traite des « racines du problème commémoratif, 1945-1999 ». Soit près de six décennies… et de quatre depuis le cessez-le-feu…Il explique ces longues durées par les différences, au début (1945-1962), de compréhension et de vécu par les protagonistes, militaires, supplétifs divers, appelés, civils des deux rives, les politiques et leurs hésitations, les engagements ou incompréhensions des intellectuels… Puis par « la mémoire trop longtemps enfouie des acteurs de la guerre », ce de 1962 à 1999, dont vingt-cinq ans de « non mémoire ».
Une notation toute personnelle au passage : ayant été pour cause de conscription et à un niveau très modeste d’appelé du contingent l’un des « acteurs » de la guerre, je n’ai pas le souvenir d’avoir fait preuve, par la suite, de « non mémoire » ou de « mémoire enfouie », malgré quelques incidents graves dont j’avais eu connaissance, parfois de très près. Il me souvient d’avoir été convaincu, dès mon arrivée sur le terrain, en 1959, d’une inéluctable et pas trop lointaine indépendance de l’Algérie, évidemment sans en prévoir de façon claire les circonstances dramatiques. On reviendra sur cette notation personnelle en fin de note de lecture.
La « non mémoire » en question est donc d’une autre nature. Elle serait le fait de la diversité des acteurs concernés comme suit : l’État tout d’abord, les « pieds-noirs » évacués dans une forme de panique, les divers supplétifs musulmans ou harkis livrés au massacre et pour quelques milliers parqués en France, les militaires de carrière qui n’avaient pas réellement perdu la guerre, ceux du contingent, seul cas lors des décolonisations françaises ou autres de conscrits impliqués dans une guerre coloniale.
L’État a dû, au fil des ans, comme pour l’Indochine, faire une sorte de grand écart entre ne pas qualifier les combats de « guerre », et reconnaître aux diverses parties prenantes les torts subis, la qualité de combattants et les diverses médailles qui l’accompagnent. Alors que le mot était rentré dans l’usage commun de l’opinion en tout cas métropolitaine, chez les journalistes et nombre d’écrivains, dès 1956.
Les diverses « parties prenantes » ont maintenu pendant des décennies (aujourd’hui à travers leurs descendants) des mémoires ou des non mémoires divergentes.Tout d’abord, puisque le cessez-le-feu n’a pas signifié la fin des massacres, attentats et autres manifestations relevant d’une guerre civile (OAS) dont certains aspects ont débordé en métropole. À ce propos, Rémi Dalisson aurait pu signaler les contorsions officielles de l’État dans d’autres circonstances, par exemple lors de la Libération et quelques années plus tard, lorsque le désir d’apaiser les tensions sociales et politiques, après des jugements sévères sur certaines formes plus ou moins atténuées de collaboration, chez les écrivains et le monde artistique par exemple, des amnisties générales furent prononcées en 1952/1953 à l’égard des quelques milliers de condamnés à « l’indignité nationale ».
La première partie de l’ouvrage se termine par l’évocation des « commémorations » privées mais tolérées, à partir de 1977, faites par diverses parties prenantes qui cultivaient évidemment des mémoires différentes sinon divergentes.
Dans sa seconde partie, Rémi Dalisson traite des « enjeux de la commémoration de la guerre d’Algérie », de 1999 à nos jours. Car il aura fallu plus de dix ans avant qu’une loi du 12 décembre 2012 ne retienne la date du cessez-le-feu du 19 mars comme date de commémoration officielle « du souvenir et du recueillement en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie », en y ajoutant la commémoration « des combats au Maroc et en Tunisie ».
Alors que cette date avait depuis longtemps, vers 1999, un large accord de l’opinion publique, parmi d’autres dates que Rémi Dalisson qualifie de « neutres » (accords d’Évian, 18 mars, ratification de cet accord, 8 avril, reconnaissance par la France de l’indépendance algérienne, 1er juillet, transfert de souveraineté, 3 juillet), d’autres avaient un caractère plus polémique (les morts de Charonne, les morts de la rue d’Isly, les accords clandestins OAS-FLN…) et restaient donc utilisées de façon partisane.
Toujours en 1999, la « guerre d’Algérie » était officiellement reconnue comme telle, des décennies après sa reconnaissance de facto par l’opinion au moins métropolitaine, la presse…Il aura donc fallu plus d’une décennie, de 1999 à 2012, pour conclure une loi déjà en principe acquise. Dans l’intervalle, Rémi Dalisson s’en explique, le mémorial Chirac « complique la question commémorative », tout comme les mémoires de groupes, les enjeux électoraux, les « embarras mémoriels ».
L’auteur rappelle également « les enjeux des mémoires algérienne et coloniale » : il signale à ce sujet la création contestée d’une Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie (implantée aux Invalides), les différentes initiatives muséales en province, « La guerre d’Algérie devient alors le symbole de toute la mémoire coloniale et chaque camp fourbit ses armes pour affirmer son seul point de vue, avec parfois une réelle mauvaise foi et beaucoup d’approximations ».
Il affirme également que, loin de faire place à l’histoire, les mémoires suscitent des représentations opposées et fantasmées. Elles seraient les métaphores des débats identitaires actuels, évidemment très subjectifs. Or la France d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier, elle est bien plus complexe et a absorbé de nouvelles populations tout aussi françaises que les précédentes plus longtemps implantées.
Prenant du recul, il prend soin cependant de préciser que la colonisation, ancienne ou récente, n’est en soi « ni uniquement criminelle, voire fascisante, ni non plus réussite exemplaire et apport de civilisation à des inférieurs ». En d’autres termes, pas de caricature d’un phénomène à replacer dans son contexte historique. Et source d’échanges sociétaux transposables à la société française d’aujourd’hui.
Dans sa conclusion, il prend clairement parti. Il regrette l’absence même de nos jours de l’historicisation de cette guerre d’Algérie et la poursuite des « complotismes » partisans. Les jeunes générations, descendantes des divers protagonistes de départ, cependant ne sont plus confrontées aux mêmes enjeux. Pour elles, la « commémoration » reste indispensable pour exercer le « devoir d’histoire ».
L’ouvrage, fort riche en références évènementielles, se lit avec grand intérêt. Pour les générations qui ont vécu les « évènements », il ravivera des souvenirs et des appréciations (ces dernières pouvant naturellement, ici ou là, différer de celles de l’auteur). Pour les suivantes, il pourra servir de manuel pédagogique. Car son appareil critique est de très bonne qualité et le texte lui-même reprend dans le détail des évènements qui peuvent relever de la construction, enfin, de l’histoire.
Reste à comprendre pourquoi la commémoration est impossible quoique nécessaire. On risquera une hypothèse : elle l’est à cause du poids des mémoires sur la construction d’une histoire. Si cette hypothèse est exacte, elle ne tient pas suffisamment compte des publications d’historiens depuis trois ou quatre décennies. Mais il s’agit ici d’une observation peut-être trop subjective, au lecteur « d’aller y voir », il ne perdra pas son temps.
Les recensions de l'Académie des sciences d'outre-mer sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrit.
Basé(e) sur une œuvre à www.academieoutremer.fr.