


| Auteur | Lisa Anteby-Yemini |
| Editeur | Albin Michel |
| Date | 2018 |
| Pages | 240 |
| Sujets | Falashas Intégration Israël 1990-.... Falashas Histoire |
| Cote | In-12 2471 (MSS) |
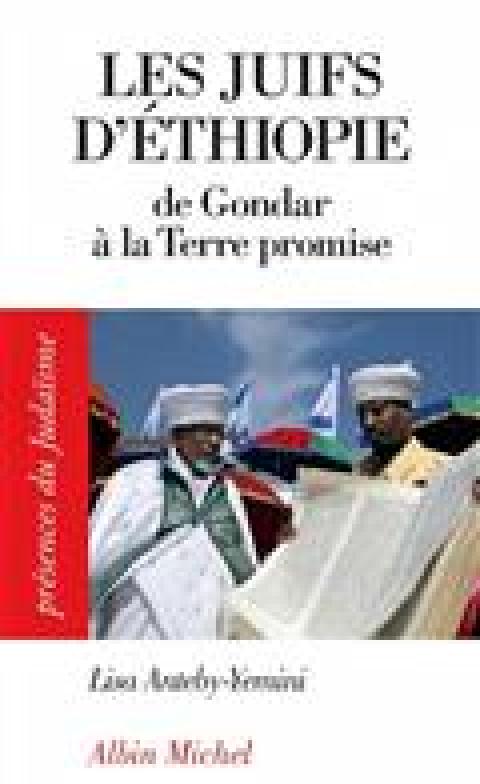
Deux opérations déjà anciennes de transport aérien de migrants juifs inhabituels en Israël, originaires d’Éthiopie, eurent lieu dans les années 1980 et au tout début des années 1990. Elles furent organisées par l’État d’Israël. La première « Moïse » concerna quelques milliers de migrants. La seconde dite «Salomon » en concerna plus de quinze mille. Elles firent l’objet de quelques articles dans la presse occidentale. Elles étaient et restent peu ou mal connues du grand public. Il n’est pas sûr que le présent ouvrage la fasse mieux connaître : il appartient à une collection spécialisée dans les « présences du judaïsme », donc sans doute destinée à un certain lectorat. Dans ce cas précis, on ne saurait trop souhaiter qu’il soit connu d’un lectorat plus généraliste, pour des raisons que l’on comprendra après analyse de son contenu.
Le lecteur remarquera en premier lieu que désignés sous le nom de « falashas » au moment où ils immigrèrent en Israël, aujourd’hui cc qualificatif n’est plus utilisé, l’ouvrage sous revue évoquant plutôt les « Beta Israël » ou encore « les Juifs d’Éthiopie » ou « Juifs éthiopiens ». L’ethnonyme « falasha » n’est évoqué qu’en tout début d’introduction puis dans quelques passages où il fait sens, alors que ces Juifs étaient connus sous ce nom, en Occident, depuis au moins le XIIIe siècle. Il est vrai que selon certaines étymologies discutées et toutes discutables, ce terme aurait autrefois été dévalorisant, qualificatif de gens sans terre, artisans voire forgerons, donc sorciers.
L’auteure s’en explique indirectement : « Beta Israël » est le nom que se donnent les intéressés eux-mêmes, « falasha » celui donné par les autres.
Contrairement à d’autres fort anciennes implantations de royaumes ou d’entités politiques juives en Afrique du Nord, au Sahara ou le long de la Mer Rouge, pour lesquelles tant les historiens que les études génétiques ont démontré une origine du Proche-Orient, rien de tel pour les Juifs éthiopiens.
Mais suivons la logique de présentation de l’auteure. Celle-ci n’a apparemment pas une bibliographie très fournie, elle est pour l’essentiel consacrée aux Juifs d’Éthiopie, objets d’une thèse du début des années 2000 (elle le rappellera à plusieurs reprises dans son texte), aux femmes juives et les mêmes mises en parallèle avec les femmes musulmanes.
Très logiquement, elle traite ici et tout d’abord des origines de cette « tribu perdue », restée pendant des siècles totalement isolée de toute autre communauté juive. Elle évoque les traditions des Beta Israël eux-mêmes, les hypothèses émises à ce sujet par les Occidentaux et les Juifs et les nombreuses inconnues qui subsistent. Et, logiquement, de ce que l’on connaît aujourd’hui des spécificités d’un judaïsme longuement isolé d’Israël, l’ancien et antique, celui du sionisme plus récent et celui enfin de la création de l’État moderne israélien.
Il n’existe aucune explication convaincante des origines de la société Beta Israël, sinon qu’elle a historiquement occupé des régions refuges, qu’elle ignore l’hébreu, qu’elle a été profondément influencée par le christianisme local (avec un clergé, un monachisme) un peu moins par l’islam proche, à travers deux ou trois ouvrages (La mort de Moïse, Le testament d’Abraham), qu’elle suit des rites particuliers et des interdits inconnus des Hébreux anciens et d’autres catégories de Juifs d’aujourd’hui.
Puis elle traite des contacts avec l’Occident : dès le XVIIe siècle, des voyageurs et des missionnaires signalent l’existence des « falasha », plus tard, au XIXe,des missionnaires protestants s’intéressent à eux et en convertissent un certain nombre, qui seront par la suite connus sous le nom de « falashmora », non sans susciter de vives réactions des falashas eux-mêmes qui tentent de faire interdire ces conversions.
Sous l’égide de l’Alliance israélite universelle, association philanthropique, Joseph Halévy prend, en 1867, contact avec les falashas en se présentant à eux comme un « falasha blanc ». Mais il conclut que « le judaïsme des Falashas est le mosaïsme pur », soit des « bons sauvages juifs », à la Rousseau. Il fait quelques propositions pour aider « ces frères abyssiniens et les rapprocher du judaïsme occidental ». Et notamment, dès alors, « si la société de colonisation de la Terre sainte tient fermement à son projet, et les moyens ne lui manquent pas, on peut facilement ramener en Palestine des milliers de colons falashas, qui sont tous des agriculteurs ou des ouvriers des plus habiles ». On voit là poindre l’un des nombreux malentendus qui caractériseront à la fin du XXe siècle l’arrivée et l’insertion des Beta Israël dans l’État et la société d’Israël.
Mais les dirigeants de l’Alliance firent la sourde oreille, « peut-être en raison de l’identité raciale de ces juifs noirs » suppose l’auteure. Exactement les mêmes raisons qui expliqueront plus tard, dans les années 1960-1970 les réticences initiales de l’État d’Israël : formation sur place et aides diverses également en Éthiopie, oui. Accueil ou immigration de masse, non tout d’abord « le nouvel État d’Israël semblait vouloir cesser ses contacts avec la communauté juive éthiopienne afin de ne pas encourager l’aliya de cette population noire, peut-être en raison du racisme des dirigeants israéliens de l’époque, des doutes sur la judéité des Beta Israël et leur capacité à s’adapter en Israël… ». Mais surtout, selon l’auteure, le désir d’éviter tout malentendu, tout désaccord avec Hailé Séliassé,
Le renversement de ce dernier en 1974 par une junte révolutionnaire changea la donne. De plus en plus persécutés, les Beta Israël commencent à fuir le pays, dans des conditions dramatiques, pour se retrouver dans des camps de réfugiés au Soudan, en familles dispersées par les circonstances de la fuite. Dans les villages d’origine comme dans les camps, la mortalité est élevée, mises en esclavage et viols se multiplient.
Sous notamment la pression d’associations de Juifs américains qui pensent, dit l’auteure, avoir été autrefois trop passives lors des prémisses de la Shoah, les autorités rabbiniques d'Israël finissent par reconnaître en 1973 et 1975 la judéité des Beta Israël, sous certaines conditions (une « conversion symbolique », une « re ciconcision emblématique »…). À la suite de quoi, la Knesset « vota en faveur de l’application de la loi de retour aux Beta Israël ». Dorénavant, plus rien n’empêche ce retour, d’où des centaines d’immigrants qui arrivent par leurs propres moyens et les deux opérations « Moïse » et « Salomon ».
Les chapitres suivants traitent des étapes de l’intégration, de ses difficultés. Certes l’État hébreu n’a pas ménagé ses efforts mais il semble avoir commis bien des erreurs. Tout d’abord, la première génération était constituée pour l’essentiel d’illettrés, qui n’eurent jamais la maîtrise de l’hébreu. Et d’illettrés fort attachés à leur vision traditionnelle de leur religion, peu ou pas préparés à intégrer un marché du travail de type occidental, donc condamnés à végéter dans des emplois de manœuvres et non d’artisans dont ils étaient crédités. Sans compter leur naturelle tendance à rester entre eux et à s’efforcer de faire venir leurs proches, y compris des parents falashmoras. En outre, cette première génération connut la pire des désillusions, celle de ne pas trouver dans ce pays, rêvé depuis des siècles, le paradis terrestre.
Outre des erreurs du type de celles commises par une administration moderne, dans le domaine de l’état-civil par exemple (noms de famille contraires aux coutumes des immigrants, incompréhension des structures familiales et claniques…), l’incompréhension des raisons des difficultés de l’intégration de cette première génération a conduit l’opinion à une piètre appréciation de cette catégorie de concitoyens.
L’analyse de la seconde génération, maîtrisant l’hébreu et bien scolarisée, est plus nuancée, entre quelques réussites économiques spectaculaires et une meilleure compréhension de leur société globale mais avec parfois des réflexes de même nature que celle des Afro-Américains de revendications égalitaires.
Les « Éthiopiens Israéliens » ne représenteraient que 2 % de la population d’Israël. Mais ils constituent un cas particulièrement intéressant et significatif de problématiques largement répandues : comment intégrer dans une communauté nationale des personnes ou des groupes qui ont théoriquement des droits reconnus à l’être mais qui restent en partie et pour de longues années peu ou mal assimilés ? L’analyse de Lisa Anteby-Yemini apporte, dans un cas concret et mal connu, des éléments de réponse fort intéressants. Plus précisément, ils soulèvent dans le cas d’Israël des questions gênantes, celle éventuellement d’une forme possible de racisme dans un pays né sur les conséquences d’un abominable génocide. Certes l’auteure ne pose pas une telle question mais son lecteur – ou certains lecteurs – peuvent se la poser.
C’est la raison pour laquelle le rédacteur de la présente note souhaitait en la commençant que cet ouvrage soit lu par tous ceux qui s’intéressent évidemment à une minorité mal connue en Occident et plus généralement aux questions plus générales que soulève ce cas particulier.
Une dernière notation : l’appareil critique (bibliographie, notes de bas de page…) est évidemment réduit dans ce format d’ouvrage « livre de poche ». On relèvera cependant qu’il est de fort bonne qualité et qu’il permet de guider le lecteur si celui-ci souhaite compléter son information et rassembler d’autres éléments de réflexion.
Les recensions de l'Académie des sciences d'outre-mer sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrit.
Basé(e) sur une œuvre à www.academieoutremer.fr.