


| Auteur | Odile Moreau |
| Editeur | Armand Colin |
| Date | 2020 |
| Pages | 335 |
| Sujets | Politique et gouvernement Empire ottoman 19e siècle Nationalisme Empire ottoman 19e siècle Identité collective Aspect politique Empire ottoman 19e siècle |
| Cote | 63.056 |
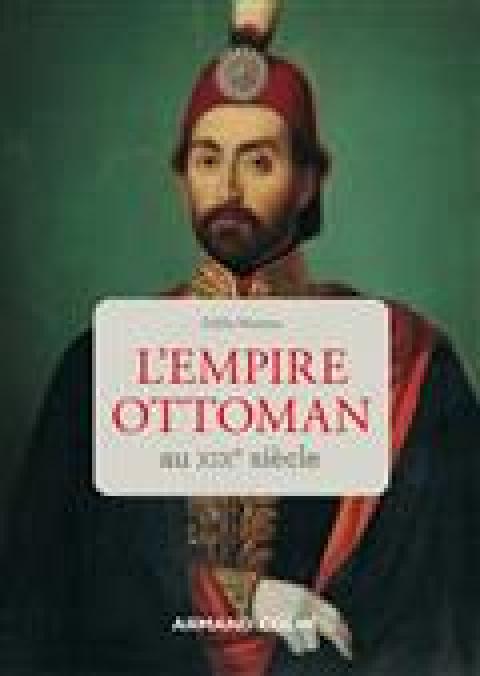
Dans son dernier ouvrage, L’Empire ottoman au XIXe siècle (Armand Colin, 2020, 336 p.), Odile Moreau, Maître de Conférences habilitée à diriger des recherches à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (Département d’Histoire), commence par donner un éclairage intéressant sur les précurseurs des Tanzîmât, l’ère des Réformes (p. 13-37).
Elle fait remonter les prémices de ces réformes à Abdülhamid Ier (1774-1789), qui amorça la modernisation de l’armée et de la marine, à la suite de ses défaites face aux Russes et aux Autrichiens, et à Sélim III (1789-1807), « Homme des Lumières », qui se heurta violemment aux janissaires, dont le rôle grandissant mettait en péril le pouvoir du Sultan. L’approche du règne de Mahmud II (1808-1839) est très novatrice : l’auteur rappelle à juste titre que ces deux décennies inaugurent le véritable début de l’interventionnisme européen, en particulier à l’occasion de la révolte de la Grèce, marquée par le soutien de la Russie - elle-même « recadrée » par l’intervention de la France et de l’Angleterre -, et débouchant, en 1829/1830, sur la reconnaissance d’un État grec (ainsi que sur l’autonomie de la Serbie). Mais, surtout, l’auteur éclaire d’un jour nouveau, l’ère des Réformes. Celle-ci, pour Odile Moreau, est réellement ouverte par Mahmud II, lorsque, en 1826, il élimine le corps des janissaires qui, depuis longtemps, bridaient le pouvoir du Sultan, en les faisant presque entièrement massacrer (p. 87-98). Le successeur de Mahmud II, Abdülmedjid Ier (1839-1861) est ainsi en mesure de promulguer, dès son avènement, la Charte de Gülhane, texte emblématique des Tanzîmât, visant à promouvoir un État de droit à l’instar des nations européennes, sans référence explicite à l’islam, par la création de ministères, générateurs d’une véritable bureaucratie ottomane, et par l’institution d’écoles de type moderne, entre autres dans le domaine militaire (p. 97-108).
Le Sultan, sorti victorieux, avec le concours de la France et de l’Angleterre, de la guerre de Crimée (1853-1856), qui limite, au traité de Paris, l’influence russe dans la région de la mer Noire, est en mesure, la même année, de promulguer le deuxième texte emblématique des Tanzîmât, le Hatt-i-Hümayûn - Rescrit impérial - de 1856, qui reconnaît, sans discrimination religieuse, l’égalité de tous les sujets, en matière fiscale, éducative, judiciaire, militaire, non sans susciter les critiques du mouvement disparate des Jeunes-Ottomans (p. 117-126). L’auteur évoque de manière plus rapide les événements du règne d’Abdülaziz (1867-1876), entre autres les mouvements nationaux chez les Slaves des Balkans, la naissance de la Dette ottomane.
Les événements du règne d’Abdülhamid II (1876-1909), occupant quasiment un quart de la partie rédactionnelle de l’ouvrage (p. 132-216), sont examinés en profondeur et, nous semble-t-il, « revisités » (au sens le plus neutre du terme).
L’auteur souligne tout à fois les carences éducatives du Sultan et l’attraction pour la modernité (que manifestera la modernisation de l’armée avec l’aide de l’Allemagne, celle de la police, avec le concours de la France), à l’occasion d’un voyage de jeunesse en Europe. Elle souligne qu’Abdülhamid II infléchit l’esprit des Tanzîmât, à la fois par l’exercice d’un pouvoir personnel à l’excès - la centralisation étant dirigée non depuis la Sublime Porte, mais depuis le Palais - et par la réactivation de la référence à l’islam.
Abdülhamid II eut le mérite très provisoire, sous l’inspiration du Grand Vizir Mihdat Pacha - disgracié par la suite - et avec le concours de Krikor Odian (qui avait déjà contribué à l’élaboration de la Constitution arménienne de 1863, limitant le pouvoir du Patriarche et des notables), de promulguer en 1876, l’unique Constitution ottomane (en vigueur de 1876 à 1878, puis de 1908 à 1921), inaugurant une monarchie constitutionnelle, le pouvoir du Sultan étant partagé avec le Parlement, bicaméral (députés, élus par le peuple, sénateurs, désignés par le Sultan), que le Sultan s’empressa de suspendre pendant la guerre russo-turque de 1877-1878.
Cette période, « moment charnière dans l’évolution de la Question d’Orient », selon Odile Moreau, voit interférer l’ingérence des Grandes Puissances dans les affaires intérieures de l’Empire ottoman. C’est à cette époque, en 1875 exactement, que l’Empire est frappé par une grave crise financière et qu’apparaît la « Dette ottomane » et le « déferlement d’une vague de nationalismes ». Au terme d’une campagne victorieuse, la Russie, par le traité de San Stefano (mars 1878), outre la reconnaissance de diverses autonomies dans les Balkans, se faisait céder, comme le rappelle l’auteur, des villes de l’Anatolie orientale et de ses confins, en obtenant, en outre, l’autonomie administrative des vilayets à majorité arménienne, dont elle avait à garantir la sécurité. Inquiètes de l’expansion russe, les Puissances imposèrent le traité de Berlin (juillet 1878), qui plaçait les réformes arméniennes sous la responsabilité du gouvernement ottoman, surveillé par des États européens (l’Angleterre gagnant l’administration de Chypre) aux intérêts divergents, ce qui, à notre avis, limitait le danger d’ingérence. Dès lors, selon l’auteur, la situation, dans les vilayets orientaux se dégrade, les troupes russes s’étant retirées des territoires occupés avant la mise en œuvre des réformes.
Qu’il nous soit permis de dire que nous n’adhérons pas entièrement aux réflexions d’Odile Moreau sur le « nationalisme » arménien (p. 180-185). Lors du traité de San Stefano, c’est en tant que patriarche arménien de Constantinople et du fait de sa charge, que, mandaté par l’assemblée nationale arménienne, Nersês II Varjabédian (1873-1884) est présent aux négociations, sa participation ayant un aspect plutôt protocolaire que décisionnel. En fait, c’est le tsar Alexandre II qui impose ses volontés par l’intermédiaire du Grand-Duc Nicolas Romanov. Nersês II n’a jamais demandé, à San Stefano, par l’intermédiaire de la délégation arménienne, « l’indépendance de l’Arménie », contrairement à ce qu’écrit Odile Moreau. D’ailleurs, un peu plus loin, à propos du Congrès de Berlin, l’auteur attribue au même patriarche la demande d’une « Arménie autonome ». Il ne s’agit pas alors, comme il est écrit par erreur, de Nersês II, mais de Meguerditch Khrimian (surnommé par les Arméniens Hayrig « Petit Père » par affection et admiration), ci-devant patriarche de Constantinople (1869-1873) et futur catholicos de tous les Arméniens (1892-1907). En fait, plus ou moins tenu à l’écart au Congrès de Berlin, où il conduisait la délégation arménienne, mandaté par l’Assemblée nationale arménienne, le prélat n’en demanda pas moins une certaine autonomie pour les Arméniens des provinces orientales, ainsi que des réformes pour leur assurer la sécurité des personnes et des biens.
Odile Moreau, par ailleurs, tout en admettant sans équivoque « les conditions de vie misérables des communautés arméniennes en Anatolie » (p. 180), pense, en évoquant les conséquences du Congrès, puis du traité de Berlin, qu’« ils contribuèrent à détériorer la coexistence pacifique préexistante entre les communautés chrétiennes et les communautés musulmanes en Anatolie » (p. 181). Or cette coexistence, envisageable depuis le Hatt-i-Cherif de Gülhane, pouvait être compromise par les abus des fonctionnaires locaux, souvent corrompus, et l’était, de fait, par les exactions de nombreux beys kurdes ayant sous leur « protection » un ou plusieurs villages arméniens et exigeant en échange une redevance qui venait s’ajouter aux impôts de l’État et dont le montant excessif provoqua, en 1894, l’insurrection - durement réprimée - des Arméniens du Sasoun. François Georgeon le confirme dans son livre Abdülhamid II : le Sultan calife, 1876-1909 (Paris, Fayard, 2003), en soulignant, à propos de la révolte des paysans du Sasoun contre les Kurdes nomades, que « depuis longtemps, un conflit oppose les deux groupes ». À propos des demandes d’émancipation administrative, l’auteur, évoquant « l’éclosion des organisations révolutionnaires », le parti Hentchak (Genève, 1887) et le Dachnaktsoutioun (Tiflis, 1890) - auxquels il faudrait ajouter le parti Armenakan, créé à Van en 1885 -, dit à juste titre, à propos du parti Dachnaktsoutioun, que « son but n’était pas l’indépendance de l’Arménie, mais d’obtenir une autogestion des Arméniens dans les six provinces orientales ». Il faut préciser ici que, en fait, c’était un partage de la gestion entre chrétiens et musulmans qui était demandé par ce parti comme par les autres, les chrétiens voulant être, au même titre que les musulmans, membres des conseils régionaux. Les partis politiques arméniens, dans leur majorité, n’opéraient pas, comme semble le suggérer l’auteur, seulement à partir de la Russie. Même le parti Dachnaktsoutioun, créé à Tiflis, donc dans l’Empire russe, se divisait géographiquement et dans la diversité des directives suivies : il se trouvait, en effet, dispersé dans différentes provinces ottomanes.
Pour ce qui concerne la condamnation de la prise de la Banque ottomane (p. 185), il s’agit bien, comme le dit l’auteur, de Bart‛oughiméos, locum tenes du patriarcat du 26 juillet au 6 novembre 1896 (et non de Matt‛êos III Izmirlian, 1894-1896, 1908-1909, défenseur courageux des provinces arméniennes, ni de Maghakia Ier Ormanian, 1896-1908, qui tenta de rétablir des relations positives avec le Sultan).
Il nous semble que Madame Moreau majore l’impact des partis révolutionnaires arméniens sur la vie politique de l’Empire en général et sur la vie des habitants des provinces arméniennes en particulier (p. 182-183). Néanmoins, étant relativement structurés, les partis arméniens purent inspirer, à la fin des années 90, le rituel des Jeunes-Turcs, parti né en 1889 : serment sur l’Évangile avec le révolver à la main pour les premiers, même rituel pour les seconds, le serment étant prêté sur le Coran. Leurs revendications, dans les années précédant et suivant immédiatement la révolution constitutionnelle de 1908, rejoignirent celles des Jeunes-Turcs, en particulier des tenants de l’ottomanisme, bientôt mis en minorité par les partisans du panturquisme. On pourrait dire que l’action des partis révolutionnaires arméniens ne visait que l’absolutisme sultanien, de même que, dans l’Empire russe elle s’en prenait à l’autocratie tsariste. À la limite, dans les premières années de leurs contacts, partis arméniens - surtout le Dachnaktsoutioun - et Jeunes-Turcs avaient des objectifs communs.
L’affirmation d’Odile Moreau selon laquelle il y avait une coupure entre les Arméniens de la capitale (appelée indifféremment, à l’époque ottomane, Kostantiniyye ou Istanbul, mais, de manière officielle, exclusivement Istanbul uniquement à partir de 1930, ce qui nous fait préférer finalement l’appellation classique de Constantinople pour la période étudiée), et ceux de la province (p. 184) doit être nuancée. Les Dadian, par exemple, chefs des poudreries ottomanes de 1795 à 1889, purent entretenir des relations étroites avec la Congrégation mékhitariste de Venise, inspiratrice d’une véritable renaissance arménienne, et croire fermement que la nation arménienne pouvait s’épanouir dans le cadre de l’Empire ottoman. Cette dynastie d’amiras (l’aristocratie financière de Constantinople) se soucia - comme d’autres patriciens arméniens ottomans - de développer le réseau éducatif dans les provinces et fit confirmer, par l’intermédiaire de Boghos Bey Dadian, le firman de 1618 accordant l’exemption de taxes et l’autonomie administrative à la principauté arménienne de Zeyt‛oun, en Cilicie (A. Alboyadjian, Les Dadian, Le Caire, 1965).
Le traité de San Stefano (mars 1878) porte le nom du « fief » le plus important des amiras Dadian. Comme le rappelle Anahide Ter Minassian (« Une famille d’amiras arméniens : les Dadian », dans Daniel Panzac, dir., Histoire économique et sociale de l’Empire ottoman et de la Turquie, 1326 - 1960, (Éditions Peeters, Louvain, 1996, p. 517), sur l’ordre d’Abdülhamid, Arakel Bey Dadian doit accueillir dans sa demeure le Grand-Duc Nicolas Romanov, dont les armées campent aux portes de Constantinople, peut-être parce que le Sultan était sûr du faste de l’accueil, peut-être également en raison du rôle joué dans la guerre russo-turque par le général - futur ministre de l’Intérieur - Mihaïl Loris-Melikov, d’ascendance princière arménienne, comme, selon toute vraisemblance les Dadian. À ces amiras, Onnik Jamgocyan a consacré une série d’ouvrages, scrupuleusement référencés, publiés aux Éditions du Bosphore (Paris), comme Le temps des Réformes, l’Arménie ottomane (2015) et La Fin de l’Arménie ottomane. Constantinople d’Abdül-Hamit II aux Jeunes-Turcs (2018). On observera, à la lecture du livre d’Odile Moreau, que les frontières n’étaient pas étanches entre les États : par exemple, Abdülhamid II et les Romanov s’étaient accordés pour lutter contre les partis politiques arméniens qui menaçaient leur absolutisme. La création de la cavalerie légère des Hamidiye - à majorité kurde - créée pour assurer l’ordre dans les provinces arméniennes, mission dont elle s’acquitta avec des violences sans nombre - fut soutenue, comme le rappelle l’auteur, par l’envoi à Saint-Pétersbourg d’un groupe d’officiers ottomans qui devaient étudier les techniques de combat des cosaques (p. 187).
On peut être surpris que, après le rappel circonstancié du rôle des régiments Hamidiye (p. 185-190), il ne soit fait aucune mention du rôle des tribus kurdes - instrumentalisées par les dirigeants jeunes-turcs - dans le génocide de 1915-1916 (mis à part les Kurdes du Dersim et les Yézidis), alors que d’éminents historiens d’origine kurde, ont l’honnêteté - et l’intelligence - de le rappeler à propos de l’« ingénierie démographique » mise en œuvre par le Comité Union de Progrès. Paradoxalement, l’auteur met les Kurdes parmi les victimes (ce qui serait vrai pour la révolte kurde de 1938, réprimée avec férocité par Mustafa Kemal), disant que « l’ingénierie démographique du Comité Union et Progrès qui mena une politique démographique destructrice conduisit à l’élimination d’une partie de sa population : Arméniens, Grecs, Kurdes » (p. 260), oubliant que les Assyro-Chaldéens et les Syriaques comptèrent en nombre parmi les victimes, comme l’ont rappelé respectivement Joseph Yacoub (Qui s’en souviendra ? 1915 : le génocide assyro-chaldo-syriaque, Éditions Ellipses, Paris, 2002) et Sébastien de Courtois (Le Génocide oublié. Les derniers Araméens, Éditions du Cerf, Paris, 2014). Pour ce qui concerne le nombre des victimes du génocide, il ne nous paraît pas utile, comme le fait l’auteur (p. 259) de donner le chiffre (deux cent mille) d’un premier groupe d’historiens qui ressortit à la propagande, mais celui que proposait Erik Jan Zürcher, mais en le « gonflant » vers le million de victimes, chiffre retenu dans des estimations plus récentes (le livre de Zürcher, Turkey : a Modern History, remonte à 1993). Par ailleurs, on ne peut qu’être surpris par le fait que le génocide des Arméniens ne soit mentionné qu’une seule fois en tant que tel, et encore, avec une alternative typographique, puisque l’auteur parle « du début des massacres/du génocide » (p. 258). Ailleurs il est fait allusion soit à l’« élimination » (cf. supra), soit une dernière fois aux « massacres des Arméniens » (p. 278).
Pour ce qui concerne la famine au Liban (p. 260), on ne peut pas mettre en cause uniquement « le blocus franco-britannique du Liban et de la Syrie » par voie maritime, destiné à générer la famine et une révolte contre les Ottomans. Une lourde responsabilité est à imputer à Djemal Pacha - l’un des membres du triumvirat jeune-turc organisateur du génocide des Arméniens - qui avait la haute mais sur l’administration du Moyen-Orient : de fait, Djemal refusa de faire transporter par train, au Liban, les riches récoltes de blé de Syrie, comme le montre la principale source sur la question les mémoires de Ohannès Pacha Kouyoumdjian, gouverneur du Mont Liban (Revue d’Histoire arménienne contemporaine, Tome V, Paris, 2003).
La période de la révolution jeune-turque de 1908 - causée par le retour à l’absolutisme sultanien - et de la seconde monarchie constitutionnelle (1908-1919) fait l’objet d’une analyse extrêmement minutieuse. Odile Moreau montre clairement le caractère hétéroclite de la contre-révolution de 1909 (que l’on perçoit bien si l’on cherche les responsables des massacres d’Adana qui font environ trente-mille victimes arméniennes), dont une des causes reste sans doute l’absence de référence à la Charia. L’échec de cette contre-révolution provoque la déposition d’Abdülhamid II et l’intronisation de Mehmet V (1908-1918), qui, pendant son règne, joue plutôt un rôle de figurant.
Le rétablissement du gouvernement jeune-turc, bientôt débarrassé de son aile ottomaniste, est total en 1913, comme le rappelle l’auteur. Les échecs essuyés dans la guerre de Tripolitaine avec l’Italie (1911-1912), dans les guerres balkaniques (1912-1913) ont pu stimuler le panturquisme, idéologie qui nourrit les Jeunes-Turcs et, plus précisément leur élément dirigeant, le Comité Union et Progrès, qui impose la langue turque dans le domaine éducatif et judiciaire.
L’étude de la fin de l’Empire ottoman, qui couvre les années 1914-1933 (p. 231-279), nous apparaît très complète et s’avère très intéressante. Elle éclaire de manière remarquable, l’exploitation, par les Germano-Turcs, de l’appel au Djihâd, et le déploiement, sur de nombreux fronts, de leurs agents – parfois des orientalistes allemands de renom – qui font de la propagande jusque parmi les contingents musulmans de l’armée française (p. 239-243).
Les problèmes de la mobilisation - manque d’instruction militaire, rôle persistant de l’exemption, difficultés des communications - sont exposés dans le détail (p. 245-246). La question des bataillons de soldats ouvriers - où l’on enrôla en masse les Arméniens - pour les massacrer ensuite - est évoquée avec d’intéressantes nuances, puisque les chefs militaires protestèrent parfois contre leur extermination, en raison de l’utilité des travaux effectués (sur le front du Caucase, à Gallipoli), en matière d’aménagement de voies de transport, voire dans l’agriculture.
Quelques pages d’un grand intérêt sont consacrées aux « Forces spéciales », fondées en 1913, au lendemain des guerres balkaniques, sous le nom de Techkilat-i-Mahsusa (p. 248-252). Leurs activités couvraient « un vaste spectre dépassant le renseignement et les bandes armées irrégulières ». D’abord à vocation régionale, cette organisation conduisit bientôt ses opérations dans l’Empire ottoman lui-même, mais surtout à la périphérie, dans les pays neutres, dans les colonies des Puissances de l’Entente, et en Russie, comme le montre l’auteur. Ces « Forces spéciales » furent liquidées en 1918.
Agrémenté de nombreuses photos, gravures, soutenu par une indispensable cartographie, l’ouvrage est pourvu d’un très utile « Glossaire » (p. 281-285), de substantielles « Notices biographiques » (p. 287-315), d’une commode chronologie (p. 317-319) et d’une « Bibliographie » (p. 321-327).
Comme on peut le constater, le livre de Madame Moreau est d’un grand intérêt. Mais, étant donné l’importance cardinale du sujet, on peut regretter que les différents chapitres ne soient pourvus d’aucune note, pas même d’une orientation bibliographique à la fin de chacun d’entre eux, pour étayer un exposé très souvent novateur.
On se rassurera sur la qualité de cet exposé en se référant à l’abondante production scientifique antérieure de Madame Moreau (souvent consacrée aux Réformes et à l’armée ottomane, en s’intéressant aussi aux provinces arabes (Égypte et Tunisie), traduite en turc et en arabe, accueillie, entre autres, par d’excellents éditeurs français ou américains, et qui atteste qu’elle est une des plus savantes turcologues de la nouvelle génération.
Basé(e) sur une oeuvre à www.academieoutremer.fr.