


| Auteur | Carole Reynaud-Paligot |
| Editeur | Champ Vallon |
| Date | 2020 |
| Pages | 348 |
| Sujets | Éducation coloniale France 19e siècle 20e siècle |
| Cote | 64.097 |
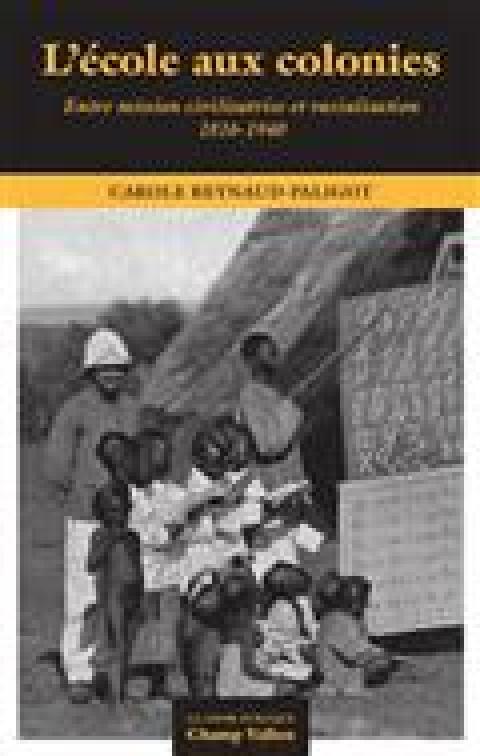
L’auteur s’appuie sur une abondante documentation archivistique consacrée aux différents aspects de l’école dès le lendemain du Ier Empire, et ce, jusqu’à la veille de la Deuxième Guerre Mondiale. La création, la gestion de l’école ne constitue pas des sujets neutres, étant étroitement liés aux orientations sociétales et politiques ; ceci reste toujours vrai de nos jours.
Ce livre est organisé en sept chapitres qui se succèdent par ordre chronologique, quelque peu particulier, intitulés comme suit :
1)-1816-1848 : Les premiers pas de la politique scolaire coloniale : l’éducation au service d’un projet colonial
2)-1848-1870 : Vers la fusion des races
3)-1870-1900 : Un enseignement différencié selon les races ?
4)-1880-1914 : Universalisme ou différencialisme
5)-1900-1918 : L’école entre opposition des colons et aspiration des colonisés
6)-Les années 1920 : Résistance à la ségrégation scolaire
7)-Les années 1930 : Entre psychologie et ruralisme.
Les colonisateurs français proclamèrent leur volonté de ‘civiliser’ les populations colonisées grâce à l‘école. Aussi est-il intéressant, ici, de suivre les démarches suivies pour y arriver, par époque, et les moyens mis en œuvre. En effet, dès le début, les colonies existèrent pour fournir des matières premières à la métropole et acquérir les biens que cette dernière produisait.
L’école fut aussi créée pour souligner la grandeur de la France, y associant à minima les enfants colonisés qui devaient apprendre le français, la culture française, l’amour de la France, être formés à des métiers manuels. Souvent les enseignants eurent un faible niveau. Les enseignements confessionnels furent plus ou moins mis à l’écart, notamment en Afrique et en Asie, mais leurs responsables furent ménagés car ils étaient de précieux intermédiaires avec le reste de la population.
L’école coloniale fonctionna surtout en ville, touchant ainsi peu d’enfants, et surtout peu de filles et la mixité sociale et religieuse y fut très relative, ainsi qu’entre enfants de colons et enfants d’indigènes. Les colons préférèrent confier leurs enfants à des écoles confessionnelles. Ce sont généralement eux qui accédèrent aux classes de fin de cycle, puis purent partir faire des études supérieures en France.
En métropole, le XIXe siècle, digne héritier du XVIIIe siècle, continua de classer les êtres humains en races distinctes, assorties de capacités elles aussi distinctes. Ceci aide à comprendre le regard jeté sur les colonisés au moins au début de la période coloniale, et le jugement porté sur les capacités intellectuelles de ces deux mondes, celui des colons et celui des colonisés, le tout sur fond d’une forme bien particulière d’analyse psychologique.
La métropole se devait de former les indigènes et de les porter vers la civilisation mais les degrés de capacité variaient selon les continents, notamment en Asie. Particulièrement en Afrique, les indigènes apparaissaient porteurs d’une lourde hérédité qui entraînait des capacités moindres, nécessitant un enseignement adapté et orienté vers les travaux manuels. Les fils de chefs restaient partout privilégiés, car on souhaitait s’appuyer sur eux pour assurer une bonne gouvernance. De cette approche découla un réseau scolaire inégal d’un territoire à l’autre.
Malgré les tentatives de plusieurs gouverneurs, à la fin du XIXe siècle, l’école resta élitiste, assurant un enseignement sommaire au plus grand nombre : apprendre à parler, à lire, former à un métier manuel en vue de limiter la mobilité sociale et d’éviter la production de déclassés. L’enseignement était une chose précieuse qui ne pouvait être distribué qu’à des bénéficiaires qualifiés.
Peu d’enfants purent franchir le cap de l’enseignement primaire, malgré, peu à peu la création d’un enseignement primaire supérieur, de collèges, encore moins d’accéder au baccalauréat et à des études supérieures, ce qui impliquait de partir à la métropole. Hors des villes, peu d’enfants, et surtout les filles, purent être scolarisés.
De ces inégalités naquirent des tensions : les colonisés aspiraient à d’autres formes de formation, peu d’entre eux y parvinrent au début du XXe siècle, et les colons voulaient s’en démarquer.
Avec la Première Guerre Mondiale, on chercha à ouvrir les écoles supérieures à plus de locaux ; alors, on souhaita substituer des personnels indigènes au personnel français. Les premiers manuels scolaires firent leur apparition à partir de 1920. L’entre Deux Guerres, vit s’ouvrir plus largement le primaire aux enfants, mais le nombre d’élèves resta faible, sur tous les territoires, même si se profilait une ouverture des élites vers les études supérieures.
Dans ce livre, une large place est faite au nord du continent africain, colonisé tôt, aux territoires de l’ouest africain, peu à ceux de l’Afrique centrale, assez peu à l’Asie et à Madagascar. Partout, apparut le souci d’organiser l’école, mais en même temps de se garder de trop instruire.
Il est intéressant de suivre les pratiques de l’administration en matière scolaire, ses mobiles, la formulation de ses objectifs, les modalités de leur application. Malgré les divergences de point de vue de certains gouverneurs, plus libéraux, l’esprit de départ évolua peu. En France, nombre d’acteurs politiques, une bonne part de la société, freinèrent les préoccupations d’ouverture vers une école plus formatrice. Et, de plus, l’école, cela coûte cher.
Dans ces pages denses et un peu touffues, il est dommage qu’il n’y ait pas un passage de mise en contexte de la documentation évoquant ce qui se passait à la même époque sur le sol métropolitain, les finalités fixées à l’école à travers les programmes envisagés, leur évolution, le poids des catégories sociales et professionnelles auxquelles les enfants étaient rattachés, sans oublier de rappeler la place des écoles confessionnelles et le regard qu’on y portait. Certes, serait ne pas coller à tout prix au document archivistique, mais expliciterait en partie la teneur de ces documents qui, en l’état, paraissent racistes, mais sont l’expression des orientations d’une époque.
La nôtre fait-elle mieux ? Restons modestes. Grâce à l’abondance et à la qualité de la documentation traitée, ce livre est une référence précieuse.
Les recensions de l'Académie de Académie des sciences d'outre-mer sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrit.