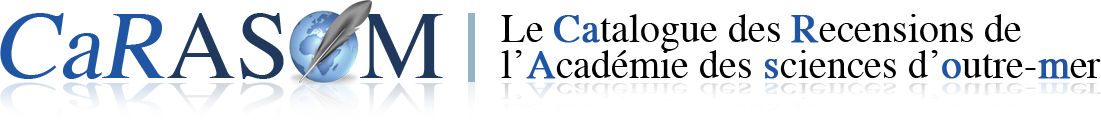
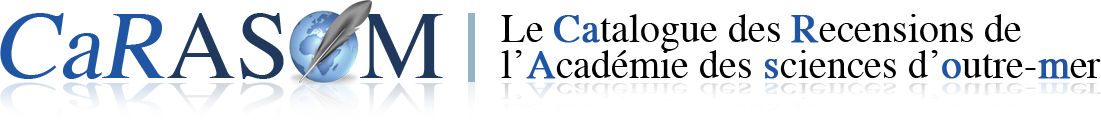
| Auteur | Bernard Lepoutre |
| Editeur | Copymedia |
| Date | 2025 |
| Pages | 333 |
| Sujets | Afrique Récits personnels XXe siècle |
| Cote |
La vie de Bernard Lepoutre ne fut pas de tout repos. Le 8 juin 1944, jeune bachelier, il fêtait, en Corrèze, la libération de Tulle par de jeunes maquisards, lorsque les Allemands reprirent la ville, pendirent 99 habitants et en déportèrent d’autres vers l’Autriche où 101 succombèrent. Durant l’hiver, il réussit à s’évader dans sa tenue légère estivale, épisode qu’il relata dans « Ma guerre sans fusil », ainsi que les souffrances endurées pour traverser les reliefs balkaniques afin d’atteindre la côte méditerranéenne libérée.
En janvier 1950, avec deux autres jeunes diplômés de l’Agro-Paris, il fut recruté par l’ORSTOM (devenu IRD) en Sciences de la terre, spécialité : pédologie, pour servir en Afrique centrale. Alors qu’ils venaient juste de passer leur permis de conduire, le professeur H. ERHART proposa de les accompagner avec deux véhicules 4x4 Delahaye neufs, via le Sahara. A partir des 87 lettres conservées par sa mère et reprises ici en seconde partie, Bernard Lepoutre entreprit de relater son périple et ses expériences africaines de terrain. Mais, malheureusement vaincu par la maladie, il ne put rédiger, au début de ce siècle, que son premier séjour, soit la première phase de ses souvenirs d’Afrique, de janvier 1950 à juin 1952.
Chacun, s’il les a vécus, ou à défaut, s’il a suivi les émissions télévisées intitulées à juste titre « Les routes de l’impossible », retrouvera, dans le témoignage de Bernard Lepoutre, les multiples incidents de ces parcours africains chaotiques, mis à mal par les intempéries tropicales. Certains problèmes ont connu des améliorations tels ces longs séjours de deux ans en Afrique, parfois sans eau courante ni électricité ; d’autres subsistent. La traversée du Sahara, bien qu’à l’époque, moins redoutable que dans les siècles antérieurs, restait néanmoins sujette à des aléas. Tel fut le cas de l’épopée de Bernard Lepoutre : leur remorque s’enflamma alors que la voiture transportait deux fûts de 200 litres d’essence ! l’équipe eut son lot d’enlisements répétés dans le sable (« fech fech ») ou dans la boue, le fameux « poto-poto », ceci impliquant l’utilisation répétitive de « grilles », plaques métalliques indispensables, puis, progressant vers leur destination, et par la suite travaillant sur leur terrain d’étude, ponts bringuebalants sinon cassés ou routes coupées par un arbre abattu, camions délabrés avec des chargements invraisemblables… forêt dense où, pour ouvrir un layon à la machette, on ne progresse guère que de 1,2 kilomètre par jour… pistes masquées par la végétation avec des ravines de près d’un mètre de profondeur ... rampes invraisemblables.
Dans la deuxième partie, l’auteur évoque des « stations de recherche agronomique » très isolées, comme celle de Ba Illi vers « le Haut Logone » tchadien, à 300 km des premiers secours, avec des pistes impraticables quatre à cinq mois, en saison des pluies, et des risques sanitaires inhérents à cette situation extrême. Lors de son second séjour, marié, sa jeune épouse faillit perdre sa vie à la naissance de leur fils. Lors de la naissance de leur fille, elle dut partir en pirogue vers Fort-Lamy … !). Il est vrai que le biotope de l’Afrique tropicale humide n’est pas toujours hospitalier : les gros animaux peuvent être dangereux (crocodiles, buffles, félins …), mais les petits le sont plus encore (tsé-tsé, moustiques, simulies, filaires …) ! Les mémoires de Bernard Lepoutre témoignent, comme beaucoup d’autres récits, des difficultés quotidiennes jalonnant le parcours des chercheurs dans les années 50 mais aussi des natifs de ces pays naguère et encore aujourd’hui, malgré des changements remarquables.
Au cours de ces deux années, outre la traversée saharienne, Bernard Lepoutre eut l’occasion d’effectuer les premières reconnaissances des divers types de sols dans les futurs États : Tchad, Centrafrique, Cameroun, Gabon, Congo. Après les deux guerres mondiales du XXe siècle, il put y constater l’état de sous-développement. A cette époque où l’on circulait partout librement, l’on n’avait que de très rares échos des troubles en Extrême-Orient (Indochine, Corée). « L’atmosphère est au moins beaucoup plus tranquille ici et pour un bon moment … ». L’auteur de ces notes ne pouvait imaginer que ces pays d’Afrique noire seraient indépendants avant une décennie ! Il a réussi à faire revivre une période où les conditions de travail étaient ingrates et très difficiles. Il a su donner vie au métier de pédologue qui demeure mal connu mais qui trouve des lettres de noblesse dans son esprit d’équipe.
Cet ouvrage édité par la famille établit un pont entre l’avant-Indépendance des pays de L’AEF et aujourd’hui.