

| Auteur | Hoda Charaoui |
| Editeur | Geuthner |
| Date | 2023 |
| Pages | 348 |
| Sujets |
Shaarawi, Huda (1879-1947) Féminisme Egypte 1900-1945 Autobiographie |
| Cote | 67.613 |
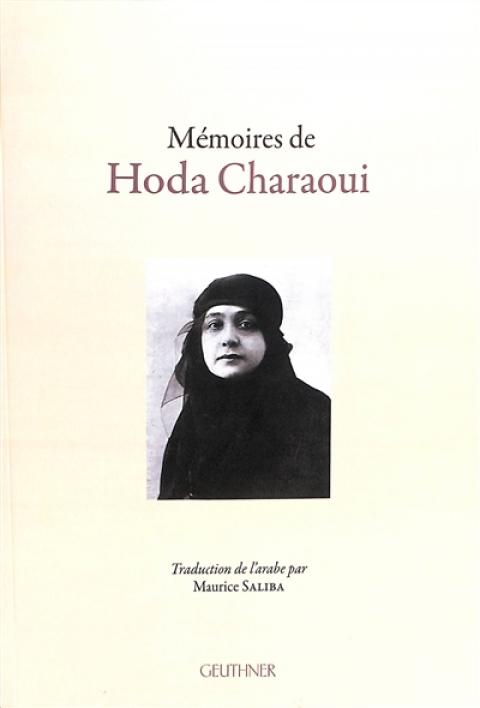
Commençons par le moins important : la forme. Le rédacteur de ces lignes voudrait exprimer son agacement - pour le moins - face au peu de soin donné à la ponctuation, aux majuscules et minuscules, au choix des bons mots, à la syntaxe, voire à toute la traduction de manière générale. Si le traducteur doit être remercié pour son travail, qui permet de faire connaître une œuvre intéressante et une période cruciale de l’Égypte moderne, il doit également être fort gourmandé pour avoir saccagé ce qui aurait pu être un livre faisant date. Mais l’éditeur lui-même mérite aussi tout le blâme pour ne pas avoir relu les épreuves. Sans même parler de Vaugelas, qui se serait arraché les cheveux plusieurs fois à chaque page, le rédacteur de ce compte rendu a fini par succomber, abattu, devant les multiples maladresses stylistiques, erreurs et fautes grossières de langue, anacoluthes maladroites et zeugmes involontaires, asyndètes gauches et autres inepties syntaxiques. Il a donc cessé la lecture à la page 216 pour ne pas, en enrageant contre la forme bâclée qui fait écumer le lecteur selon un rythme allant crescendo, finir par ressentir de l’aversion contre le sujet lui-même du livre qui mérite pourtant toute l’attention. Cet aveu est assurément regrettable, mais le constat est sans conteste que les mémoires de Hoda Charaoui méritaient beaucoup plus de soin.
Sur le contenu du livre : le prologue de Jacques Keryell rappelle que le mouvement féministe égyptien a une centaine d’années, avec Hoda Charaoui (1879-1947) comme figure de proue. Cette dame francophone, mariée à treize ans, fonda entre autres le journal L’Égyptienne, publié en français de 1925 à 1940. Cette femme musulmane polyglotte, issue d’une riche famille, créa en 1919 la Société de la femme nouvelle, pour encourager l’alphabétisation, l’enseignement et l’hygiène. Elle fonda en 1923 l’Union féminine (ou féministe, car c’est le même mot en arabe : nisâ’î) égyptienne. Son combat pour l’émancipation de la femme égyptienne s’inscrivit dans le cadre plus large de la lutte nationale - au sein du parti Wafd (délégation) - contre la présence britannique. La lutte contre le patriarcat allait ainsi de pair avec celle contre le colonialisme. Hoda fut la présidente du Comité central des femmes au sein du parti Wafd. Elle serait la première femme égyptienne à s’être dévoilée publiquement (en 1923), ce qui mérite d’être souligné tant le voile constitue le symbole par excellence de la domination masculine, selon une vision conservatrice - et certainement erronée - de l’islam (c’est d’ailleurs là une autre question qui mériterait de longs développements) que vient renforcer le poids de traditions rétrogrades qui négligent souvent, quand cela les arrange, les quelques orientations plus ou moins progressistes de la religion (ces tendances au progrès existent assurément en islam, même s’il ne faut pas en exagérer l’importance). Quoi qu’il en soit, Hoda ne voyait pas de contradiction entre l’islam - comme dogme, pratique et foi - et l’émancipation féminine.
Cela l’arrangeait peut-être de penser que l’islam, bien compris selon elle, pouvait être le fer de lance de la lutte contre l’arriération des femmes et le colonialisme étranger. Car si elle avait eu à lutter simultanément contre les traditions sociales soutenant le patriarcat, l’islam sunnite fermé sur lui-même (dans un pays où l’athéisme était inconcevable) et l’impérialisme avide du Royaume-Uni, elle ne serait parvenue à aucun résultat. Était-elle convaincue que l’islam promouvait intrinsèquement l’émancipation féminine ? De toute façon, on ne saurait lui demander l’impossible, car c’est une femme de son temps, prisonnière (comme nous le sommes tous) de paramètres culturels et sociologiques dont elle tenta de repousser raisonnablement (sans trop braquer les hommes) les limites.
Dans le propos liminaire, Maurice Saliba rappelle que la traduction suit fidèlement le texte arabe publié en 1981 au Caire, sauf bien sûr les notes de bas de page, ajoutées, mais peut-être parfois insuffisantes pour éclaircir tel ou tel point.
L’introduction de Christian Lochon jette la lumière sur plusieurs points importants : la modernisation du pays depuis Mohamed Ali, à la suite de la brève présence française, mais de manière peut-être trop rapide, en tout cas dans des conditions qui mènent à la banqueroute puis à la mainmise franco-britannique sur les finances égyptiennes, et enfin à la présence militaire directe (à partir de 1882). De 1914 à 1922, Londres imposa même un protectorat. Autre rappel de C. Lochon : la construction de barrages (sous impulsion britannique) et la bonification subséquente des terres ne profitent qu’à une certaine classe ; quant à la production du coton, aux fins d’exportation, elle ne se réalise qu’au détriment des cultures nourricières. Bref, le pays se développe mais selon un schéma de dépendance structurelle face à la puissance coloniale. Face au blocage politique (les officiers arabes demeurent inférieurs à ceux d’origine turco-circassienne), au blocage institutionnel (le Palais reste impuissant face aux ambitions de Londres), à l’exploitation économique (dont souffre la totalité des paysans), le sentiment national se développe, même confusément : en mars 1919, ce sont les premières manifestations, puis émeutes. Le leader politique égyptien de l’époque, le chef incontesté du parti Wafd, est certainement Sa‘d Zaghlûl (obivit 1928), dont le destin croise celui de Hoda.
En 1922, Londres consent à un traité accordant à l’Égypte la fiction d’une certaine autonomie, qui organise un équilibre tripartite entre le parti nationaliste Wafd, le Palais et la puissance occupante, qui domine. Mais en 1936, la crise éthiopienne rapproche Londres du Caire, et l’indépendance formelle est reconnue, l’Égypte entrant alors à la Société des Nations, mais avec un maintien des troupes d’occupation près du Canal de Suez et la préservation du condominium britannique sur le Soudan. La création de la Ligue arabe au Caire en 1947 renforce la présence égyptienne au sein du monde arabe, et plus généralement dans le concert des nations. Puis éclatera la révolution de 1952, avec les Officiers libres, et l’évacuation du Canal de Suez en 1956. Mais c’est une autre histoire…
Au niveau politique local, les bases de la monarchie constitutionnelle et d’une certaine forme de démocratie parlementaire sont jetées entre 1866 et 1882, date de l’immixtion britannique directe, ce qui créera des frustrations compréhensibles, qui exploseront en 1919. Outre l’animosité nationaliste croissante contre la présence britannique envahissante, une autre réaction virulente point : celle de la Confrérie des Frères musulmans, fondée en 1928, envers non seulement l’occupant étranger, mais aussi et surtout à l’encontre des valeurs occidentales importées, jugées anti-islamiques, dépravées, destructrices. Mais l’ire des Frères se dirige essentiellement contre les musulmans égyptiens eux-mêmes, accusés d’avoir renié l’islam, d’être devenus des apostats. Si juifs et chrétiens locaux sont loin d’être épargnés par la Confrérie - pour des raisons dogmatiques « suprémacistes » (selon un néologisme provenant de l’anglais qui résume à merveille la condescendance, le mépris, le racisme et la haine), et également en raison d’une surreprésentation des chrétiens dans les élites -, ce sont assurément les musulmans considérés comme mous, déviants, hérétiques, qui font les premiers les frais de la critique, qui sont les cibles privilégiées de l’aversion et de l’anathème, dérive violente que les personnalités musulmanes modérées et réformistes, cultivées et ouvertes, ne peuvent hélas endiguer. Dans un tel contexte, le combat féministe de Hoda était évidemment semé de dangereux écueils.
Hoda avait eu des précurseurs, comme Qâsim Amîn (1865-1908), favorable à une certaine émancipation de la femme (ce n’est en effet pas un féministe au sens où on pourrait l’entendre aujourd’hui, car il ne prône qu’une relative amélioration de la condition féminine). Mustafâ Fahmî (1886-1959), lui, estima que l’origine du voile était sociologique et non religieuse, thèse qui lui ferma les portes de l’Administration. Hoda suivit leur pas… Elle était la fille du premier président du Conseil consultatif, eut des précepteurs français, fut mariée très jeune à son cousin, polygame, par ailleurs haut dirigeant du parti nationaliste Wafd. On voit bien qu’elle ne pouvait qu’être tiraillée entre des orientations contradictoires, ou du moins très peu convergentes. En ce sens, dans quelle mesure sa lutte était-elle plus féministe que nationaliste ? Ce n’est pas un point facile à évaluer… Le poids suffocant du religieux était alors en effet un paramètre irréfragable et la cause nationale, qui nécessitait une union de toutes les composantes du peuple, interdisait les revendications féministes qui pouvaient s’avérer centrifuges et menacer l’unité. D’ailleurs, en fait, dans ses mémoires, Hoda ne semble pas vouloir révolutionner l’islam : elle reste prudente et ne réclame des droits - très légitimes - que dans le cadre religieux (de la loi chariatique). Ce sont ainsi probablement les prémices de ce qu’on appelle aujourd’hui le féminisme islamique, tant réalité tangible et cohérente que chimère douteuse et extravagante, selon les différentes visions.
Hoda, inspirée et aidée par d’autres femmes célèbres (comme May Ziyâdé, 1886-1941 ; Qût al-Qulûb, ou Out el-Kouloub selon la graphie française, 1892-1968 ; etc.), fonda le journal L’Égyptienne, comme dit supra, pour la promotion de la femme, la cause du panarabisme et la défense de la Palestine. On le voit bien : les différentes luttes se conjoignent dans son action, l’une légitimant l’autre, non parfois sans équivocité. Dans le même esprit (progrès social et émancipation nationale), une trentaine de revues du même acabit parurent entre 1892 et 1957, comme le rappelle C. Lochon. On notera que pour certaines femmes activistes de l’époque, comme Durriyya Shafîq (1908-1975), Hoda évoluait dans un milieu trop élitiste pour répondre aux aspirations des femmes égyptiennes du peuple…
Pour conclure, les mémoires de Hoda Charaoui (selon la graphie qu’elle adopta elle-même) sont intéressants car ils montrent de l’intérieur l’évolution du mouvement politique et social. Toutefois, certains détails semblent moins utiles que d’autres, surtout quand l’auteur parle de sa jeunesse, de ses déceptions, de ses problèmes conjugaux, etc., car cela éclipse la description des événements concernant toute la nation égyptienne. Mais en même temps, ces détails montrent une femme qui souffre, comme enfant, jeune fille, jeune femme mariée, mère, et permettent dès lors de comprendre dans une certaine mesure la structure mentale du patriarcat.
Quoi qu’il en soit, le rédacteur de ce modeste compte rendu estime que, malheureusement, la forme déplorable de l’écriture du livre constitue une avanie à l’encontre d’une personnalité très attachante et aussi une humiliation vis-à-vis de la lutte de tout un peuple contre une occupation étrangère inique.
Il est impérativement nécessaire qu’une nouvelle édition, vraiment digne de ce nom, soit rapidement entreprise pour que la qualité formelle soit à la hauteur des engagements de Hoda et que l’on oublie à jamais ce travail négligé !