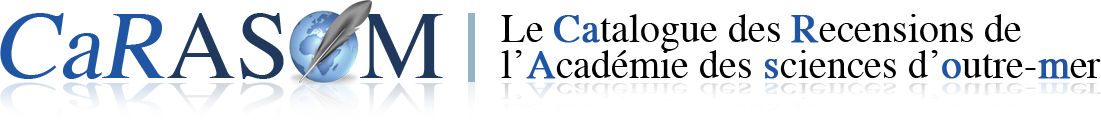
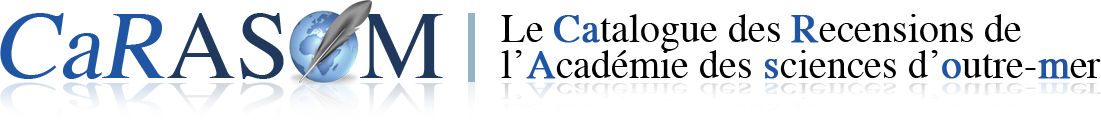
| Auteur | Philippe Martin |
| Editeur | Tallandier |
| Date | 2024 |
| Pages | 313 |
| Sujets | Pèlerinages chrétiens Jérusalem Histoire Pèlerinages juifs Jérusalem Histoire Pèlerinages musulmans Jérusalem Histoire |
| Cote |
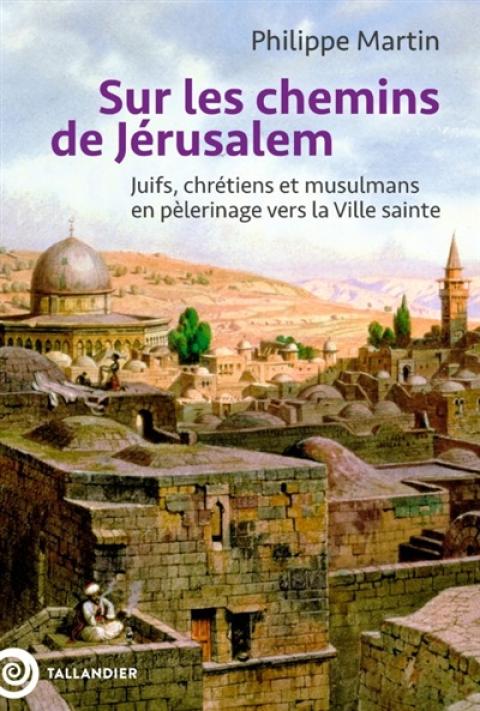
L’auteur, professeur d’histoire à l’université de Lyon II, en évoquant le séjour à Jérusalem de 26 « pèlerins » dont deux femmes seulement, trois hommes d’État et dont 5 étaient juifs, 16, chrétiens, 5, musulmans, met en lumière l’attrait mondial pour Jérusalem située sur une élévation de 768 m., occupée à l'âge du bronze autour de la source de Gihon. Néanmoins, chacun y découvre ce qui peut conforter sa foi et soutenir ses convictions (p.194) là où, en 1620 av. J.C., Saül aurait fondé le premier royaume d'Israël (p.12).
Benjamin, étudiant ou commerçant juif, né à Tudèle, ville reconquise aux musulmans en 1121, quitte sa Navarre natale autour de 1170 (p.105) pour se rendre à Jérusalem qu’il atteint vers 1170. Son Livre des Voyages, écrit en hébreu, traduit en latin et en français, mentionne 300 villes traversées.Jérusalem s’est christianisée très vite ; 200 Juifs y habitent près de la Tour de David (p.107).
Sabbaa Tsevi, kabbaliste, est né à Izmir d’une famille ayant fui les pogroms d'Ukraine à la fin de la guerre de 30 ans qui ont conduit 200 autres familles juives à Jérusalem où lui-même parvient en 1662 (p.164). Devenu leader écouté de sa communauté, il est menacé par les Turcs, abjure et disparait (p.170).
Moïse Montefiore, banquier anglais lié aux Rothschild, visite Jérusalem en 1827 (p.191). Il comprend que cette ville, où les puissances européennes ont installé des consuls, est devenue le point de crispation des nationalismes arabe et juif. Il s’y installera et financera la rénovation du Quartier juif en 1860 (p.196).
Arthur Koestler, né à Budapest, devient correspondant de presse à Jérusalem en 1927 (p.270). Le sacré le fascine et l’inquiète (p.272). Il y reviendra en 1948 pour couvrir la naissance d’Israël (p.277).
Moshe Dayan, ministre de la Défense israélien, conquiert le quartier oriental de Jérusalem (p.279) ; il imposera un statu quo garantissant les sites historiques et religieux, confirmé dans le traité de paix israélo-jordanien de 1994 (p.286).
Un des premiers chrétiens, Paul de Tarse s’investit dans la mission de prêcher en « Arabie » et 5 fois à Jérusalem avant d’être décapité à Rome vers 67 (p.60).
Egérie, présumée abbesse galicienne, ayant résidé à Jérusalem de 381 à 384, a laissé un récit de son pèlerinage Peregrinatio Aetheriae (p.61) dont il manque l’original. Elle décrit l’Anastasis, érigée au-dessus du rocher du tombeaudu Christ, puis le site du Golgotha et le Martyrium, grande basilique édifiée en 335. Cet ensemble sera détruit en 1009 (p.67). La ville est un gigantesque couvent où la ferveur est constante et l’émulation permanente (p.71).
Le pèlerin italien de Plaisance, demeuré anonyme, déambule sur les traces de Jésus vers 570 (p.73) en visitant l’Anastasis, le Golgotha, Sainte Marie la Neuve et Sainte-Sophie, édifiée sur le prétoire. Jérusalem est alors l’écrin des objets de la Passion qui seront ultérieurement dispersés ou détruits (p.75). Des milliers de pèlerins veulent y rencontrer le souvenir vivant de Jésus (p.80).
L’Higoumène Daniel, ukrainien ou russe, apparait à Jérusalem en 1105 après avoir débarqué à Jaffa (p.97). Il passe sans cesse de l’émotion religieuse à l’étonnement esthétique (p.98). Le cœur de son pèlerinage est le Saint-Sépulcre où il est conscient de la place qu’occupent les orthodoxes grecs ou russes (p.100). Son récit est imprimé en 1475 et en 25 ans, réédité cinq fois (p.103).
L’Archimandrite Grethenios parcourt 2100 km depuis son couvent de Smolensk pour atteindre Jérusalem en 1400 (p.123), peu satisfait de voir les hérétiques latins et arméniens célébrer leurs offices (p.126) ; les juifs également gênent ses dévotions (p.127) et les musulmans multiplient les interdictions (p.128).
Dom Nicole Loupvent, bénédictin, entreprend en 1531 avec des nobles lorrains, le pèlerinage à Jérusalem (p.142). Il s’y déchaîne contre les Jacobites, les Nestoriens, les Arméniens et les Turcs et Sarrazins (p.147). Son récit décrit 102 sites. Le moment le plus fort est la nuit passée au Saint Sépulcre (p.149). Il aura cependant découvert que les musulmans préservent les lieux saints chrétiens et que les deux religions partagent les mêmes lieux de prière (p.151).
Jean Zuallart, 1586, maire d'Ath en Wallonie, accompagne le fils du baron de Mérode à Jérusalem en 1586. Il en rédigera un guide apprécié Il Devotissimo Viaggio di Gerusalemme (p.154), édité en italien, français et allemand où il recommande de se munir d’une petite pharmacie, de s’habiller sans luxe tapageur et d’éviter de parler de religion avec les musulmans (p.161). Pour ce nouveau Chevalier du Saint-Sépulcre, ce voyage est une école de foi (p.163).
Richard Pococke, de Southampton, aura été plus un touriste qu’un pèlerin (p.180). Il découvre Jérusalem qui compte 15 000 habitants dont 10 000 musulmans, en 1737, avec désappointement (p.174). Il se désole des populations qu’il rencontre et croise peu de pèlerins européens (p.178).
Chateaubriand trouve en 1806, en Terre Sainte, le sujet qui allie l’exotisme des grands espaces et l’exaltation du christianisme (p.182). Au Saint Sépulcre, il réfléchit à l’évolution du site. Il est bien éloigné de la religion. Mais le jour de son départ, les Franciscains le font Chevalier et il écrira dans sonItinéraire de Paris à Jérusalem « On croira sans peine que je devais être ému »(p.188).
Pour Alexandre Neyrat, prêtre lyonnais venu à Jérusalem en 1866 et dont le Journal est resté inédit (p.200), la déambulation dans la ville hésite entre imagination, regrets et ravissement (p.206). La déception vient de la cohabitation religieuse, de la division de la chrétienté et du recul des catholiques en ces lieux saints (p.208).
Le Prince Joseph Lubomirski en 1879, page du Tsar Nicolas Ier, installé à Paris en 1861, vient en pèlerin à Jérusalem (p.212) mais au Saint Sépulcre, il ne trouve ni le mystère, ni la grâce (p.217). Grâce aux bakchichs, le Prince se rend au Mur des Lamentations, réservé aux juifs puis aux Mosquées du Dôme et d’El Aqsa. Il conclut : trois hauts lieux de culte, trois désillusions ! (p.219). Il repartira sceptique en constatant : « la religion même la plus absurde dirige les hommes tout en les abusant » (p.222).
Victoire Cochet de Vaubernard également en 1879, en compagnie de 15 prêtres, est logée à la Casa Nova, (p.223). Avide de tout voir, elle prie au Saint Sépulcre, à Sainte-Anne, offerte à la France par le Sultan en 1856, à Bethlehem. Pour elle, la Terre Sainte est vouée au Christ (p.231).
Pierre Loti, protestant, arrive à Jérusalem en 1894, privilégiant les foules en mouvement dans les rues, les processions de pèlerins qui prient dans toutes les langues. Le religieux est l’essence des bruits de la ville (p.234). Il est donc là pour ressentir l’éventualité de sa propre foi (p.236). Quelque chose craque en lui quand il voit Le comportement extatique des pèlerins russes (p.240).
Lewis Larson, en 1904, photographe suédois, est membre de l'American Colony fondée à Jérusalem en 1881 par un avocat américain (p.250). L’institution est célèbre pour son idéal chrétien et la vie collective de ses colons. Les photos de Larson ne montrent pas un monde pluriconfessionnel mais des personnes affichant une identité spécifique (p.257).
Stephen Graham journaliste d'Edinburgh, intègre une caravane de pèlerins russes, venue à Jérusalem en 1911 (p.259). La diplomatie russe essaie de rallier les milliers d’orthodoxes vivant sous puissance musulmane (p.260). 200 000 pèlerins orthodoxes seront venus à Jérusalem de 1853 à 1873 et seulement 600 Français dans le cadre de la Société Sint-Vincent de Paul. Graham décrit la ferveur orthodoxe pour cette ville qui est le cœur de la vie chrétienne (p.269).
Michel Delpech, en 1985 et son épouse Geneviève partent à Jérusalem en voyage de noce. Ils enchaînent les sites juifs, chrétiens, musulmans. Mais Michel rencontre Jésus devant la pierre du tombeau (p.302). « Il est des lieux où souffle l’esprit » pense-t-il avec Maurice Barrès (p.303).
Parmi les musulmans, le Calife Omar serait venu à Jérusalem en 637, d’après un récit tardif ; il aurait refusé d'entrer dans l'Anastasis pour qu’elle ne soit pas transformée en mosquée. Sur le Mont du Temple, la Mosquée d'Omar a été érigée en 691 et celle d’Al Aqsa en 719 (p.83).
Saladin reconquiert Jérusalem en 1183, ce que célèbre son secrétaire Iman al Dîn, dans son livre Eloquence sur la conquête de la ville sainte (p.113). Les mosquées du Dôme et d’Al Aqsa sont purifiées à l’eau de rose pour avoir servi d’église (p.119). Une madrasa destinée aux pèlerins est ouverte dans l’ancienne église Saint-Jean. Le Saint-Sépulcre est fermé mais les chrétiens, pense-t-on, ne cesseront pas d’y venir (p.120).
Mujir al Din al Ulaymi, né dans une famille de notables de Jérusalem, est connu pour sa Glorieuse Histoire de Jérusalem et d’Hébron qui date de 1496. La ville n’a guère que 6000 habitants mais l’auteur est fier de la Mosquée du Rocher et des 750 lampesdisséminées sur le site d’Al Aqsa (p.139). La ville demeure un des principaux lieux de la piété musulmane (p.141).
Youssouf Al Khalidi (1842-1906), également natif de Jérusalem (p.242), est un musulman libéral qui deviendra le premier Maire de la ville en 1870 et conscient des particularismes confessionnels, il milite pour l’amitié judéo-christiano-musulmane (p.245).
Il aura fallu beaucoup de courage au Président Sadate en 1977 pour faire une prière à la Mosquée d’Al Aqsa (p.288) avant de prononcer devant la Knesset son discours de paix dans lequel il assurera que « Jérusalem sera toujours l’incarnation vivante de la coexistence entre les fidèles des trois religions » (p.293). Il le paiera de sa vie le 6 octobre 1981 (p.294).
Pour l’auteur qui rappelle qu’au XXIe siècle, les rixes autour du Saint-Sépulcre existent toujours (p.129), la présence en Terre Sainte des chrétiens qui se disputent des lieux qui leur sont communs est le gage de leur existence légitime dans l’histoire (p.130).
Le lecteur appréciera le glossaire (p.305), la chronologie consacrée au pèlerinage (p.307), une bibliographie sélective (p.309), les utiles sources des citations (p.311) ; le plan du centre de Jérusalem (p.15) et six cartes consacrées à des voyageurs de différentes époques.