

| Auteur | sous la direction de Wolfgang Asholt et Lise Gauvin |
| Editeur | Classiques Garnier |
| Date | 2017 |
| Pages | 198 |
| Sujets | Djebar , Assia 1936-2015 Critique et interprétation Actes de congrès Transgression Dans la littérature Actes de congrès |
| Cote | 61.900 |
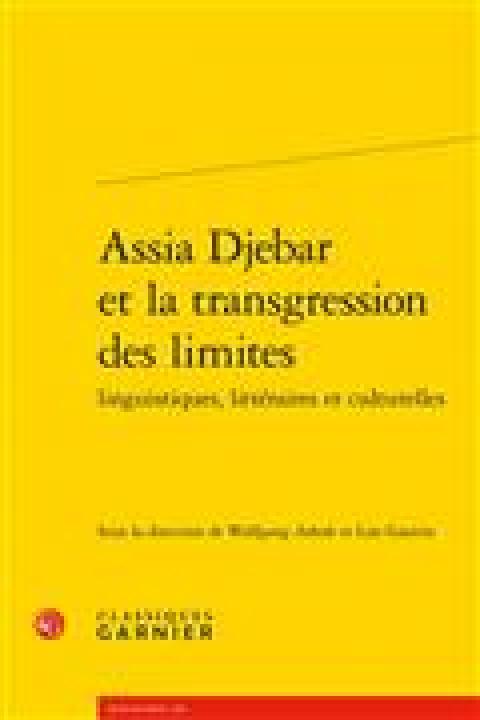
Pour bien situer cet ouvrage, il est nécessaire de rappeler en quelques lignes qui fut Fatma-Zohra Imalayène tôt devenue, son nom de plume et de cinéaste, Assia Djebar. Un prénom et un nom qui résument bien ses choix de vie, intellectuels, politiques, culturels : Assia est la consolation, Djebar la détermination ou l’intransigeance. Ce pseudonyme choisi pour ne pas choquer sa famille et d’abord son père, acte si l’on veut de « transgression » à des mœurs traditionnelles contraignantes pour notamment les femmes.
Fille d’instituteur, dans sa jeunesse d’écolière puis de collégienne, il lui fut impossible d’apprendre l’arabe classique, malgré un passage par l’école coranique. Excellente élève, elle apprit donc le français, le latin, le grec, l’anglais, comme beaucoup d’enfants doués à l’école de la République. Ses succès scolaires lui valurent, avant ses vingt ans, d’entrer en khâgne à Paris puis d’être reçue à Normale Sup (celle de Sèvres). Mais résolument engagée dans une grève de l’UGEMA (Union générale des Étudiants musulmans algériens) – nous sommes alors en 1956 – elle en fut renvoyée. Elle enseigna alors au Maroc et écrivit son premier roman La soif, sous un nom qui lui vaudra par la suite une bonne renommée.
Elle fut reçue à l’Académie française en 2006, au siège laissé vacant par Georges Vedel. Elle y était, par ordre chronologique, la cinquième femme et la première personnalité issue du Maghreb, quinze ans après Marguerite Yourcenar, autre « transgressive » et première académicienne de l’histoire en 1980. Auparavant, elle était devenue membre, en 1999, de l’Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Au fil des années, elle accumula les prix étrangers ou internationaux, les chaires d’enseignement en Algérie, en France, aux Etats-Unis. Plusieurs associations ont entretenu de son vivant un véritable culte (le cercle des amis d’Assia Djebar par exemple). Elle fut largement traduite de par le vaste monde, et après sa mort, à Montréal fut instituée une journée « Assia Djebar ».
Elle s’est elle-même exprimé sur son parcours, aussi bien que sur son œuvre. Dès 1986, par une lettre publiée à Alger dans une revue Présence des femmes, elle déclarait : « « Pourquoi écrire ? J’écris contre la mort, j’écris contre l’oubli… J’écris dans l’espoir (dérisoire) de laisser une trace, une ombre, une griffure sur un sable mouvant, dans la poussièrequi vole, dans le Sahara qui remonte… j’écris parce que je ne peux faire autrement, parce que la gratuité de cet acte, parce que l’insolence, la dissidence de cette affirmation me deviennentde plus en plus nécessaires. J’écris à force de me taire. J’écris au bout ou en continuation de mon silence. J’écris parce que, malgré toutes mes désespérances, l’espoir (et je crois : l’amour) travaille en moi. ».
À l’occasion de son discours de réception, en février 2006, après avoir, conformément au rite, rendu un solennel hommage à son prédécesseur Georges Vedel, elle s’exprima en termes dénués d’inutiles précautions sur le passé colonial de l’Algérie : « Il y a une autre Histoire, Mesdames et Messieurs, qui succède à celle-ci… », étant entendu qu’elle aborda alors un sujet plus vaste que celui des mérites de son prédécesseur : « Mesdames et Messieurs, le colonialisme vécu au jour le jour par nos ancêtres, sur quatre générations au moins, a été une immense plaie !... Il fut vécu, sur ma terre natale, en lourd passif de vies humaines écrasées de sacrifices privés et publics innombrables, et douloureux, cela sur les deux versants de cedéchirement. ». Mais d’ajouter ce qui ressemble à un clin d’œil, revendiquant François Rabelais : « .Dans sa lettre de Gargantua à Pantagruel, en 1532, c’est-à-dire un siècle avant la création de l’Académie par le cardinal de Richelieu, était déjà donné le conseil d’apprendre « premièrement le grec, deuxièmement le latin, puis l’hébreu pour les lettres saintes, et l’arabe pareillement ».
Pierre-Jean Rémy dans son discours de réception n’a pas plus de langue de bois. Il rappelle qu’Assia Djebar a été une militante active du mouvement étudiant musulman algérien en 1956, tout comme son frère, qu’elle fut pour cela renvoyée de Sèvres, sans aucune réaction de ses camarades normaliennes, il rappelle également les « tomates » de Guy Mollet, regrette le choix du Président Coty pour en faire un premier ministre alors que Mendès-France avait su mettre un terme à la guerre d’Indochine…
On voudra bien excuser ce trop long préambule qui n’apprendra probablement pas grand-chose au lecteur « honnête homme ». Il a paru nécessaire car, sauf grave erreur d’appréciation, ces rappels des parcours et des déclarations d’Assia Djebar ne relèvent certes pas nécessairement d’une certaine forme de « transgression » mais d’abord d’une aspiration à dire à travers son écriture sa trace « contre l’oubli ».
Le titre de l’ouvrage en revue indique que son thème majeur est celui de la « transgression des limites». Le bref rappel des premières lignes de la présente note de lecture montre qu’Assia Djebar a su réussir un parcours intellectuel, littéraire, d’enseignement et culturel suffisamment reconnu et honoré pour que ce terme soit explicité. Ce parcours ne peut-il se caractériser que sous le terme de « transgression » ? Le terme de « marge » ne serait-t-il plus approprié ? L’on voit bien qu’entre l’évocation qui vient d’être faite du parcours de cette auteure hors normes et l’approche du titre Assia Djebar et la transgression des limites linguistiques, littéraires et culturelles, il y a au départ une sorte de désaccord de fond. Mais évitons les mauvais procès et examinons maintenant la substance.
Dans l’introduction de cet ouvrage à dix ou onze voix, il est précisé qu’il est issu du XXIe congrès de l’Association internationale de Littérature comparée, tenu à Vienne en 2016, dont le thème général était « la littérature comparée : multiples langages », plus précisément l’un des cinq axes de cette rencontre, « Plusieurs cultures, plusieurs idiomes ».
Dès cette introduction, est utilisé le qualificatif de « transfrontalière », qui serait applicable à Assia Djebar. Être transfrontalier n’est pas synonyme de transgresser, ces premiers mots paraissent donc justes au lecteur. Mais des trois parties à cet ouvrage, deux sont intitulées « Transgressions », les premières étant « esthétiques », les secondes « d’écriture ».
On eût donc souhaité que l’ouvrage s’en tienne à ce terme de « transfrontière » qui – cela n’engage que l’auteur de la présente note – définit bien mieux à la fois les déplacements, une certaine marginalité, voire de la résistance, le passage de frontières en étant l’une des manifestations.
Nonobstant cette remarque de fond et méthodologique, l’ouvrage se lit avec intérêt car il s’agit d’une dizaine de dissertations – sans donner de sens péjoratif à cette appellation – à propos de romans ou de thèmes d’Assia Djebar, et de l’usage d’une langue française parfaitement maîtrisée, illustration d’une certaine francophonie des peuples et des individus.
En outre, comme souvent dans les « Classiques Garnier », pour être restreint, l’appareil critique est solide. On notera en particulier les résumés bilingues français anglais et les notices de présentation des auteurs.
On l’aura compris, les réserves ici exprimées ne doivent pas être un obstacle au lecteur désireux de bien comprendre divers aspects de l’œuvre d’Assia Djebar.
Les recensions de l'Académie des sciences d'outre-mer sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrit.
Basé(e) sur une œuvre à www.academieoutremer.fr.